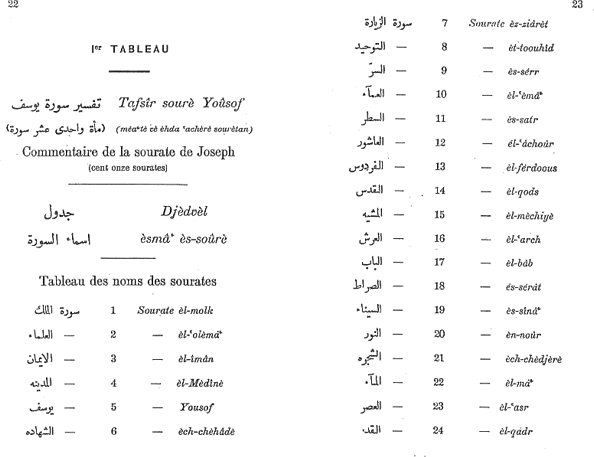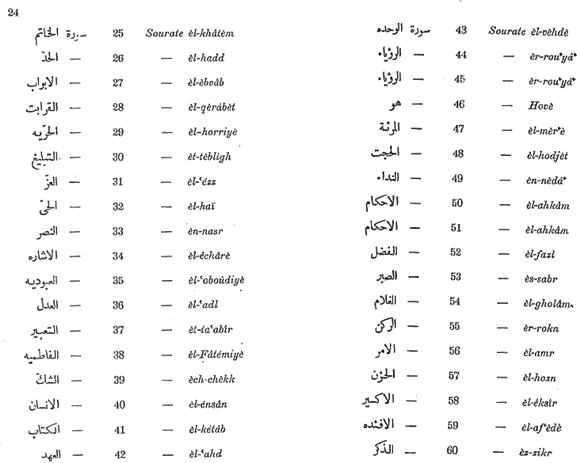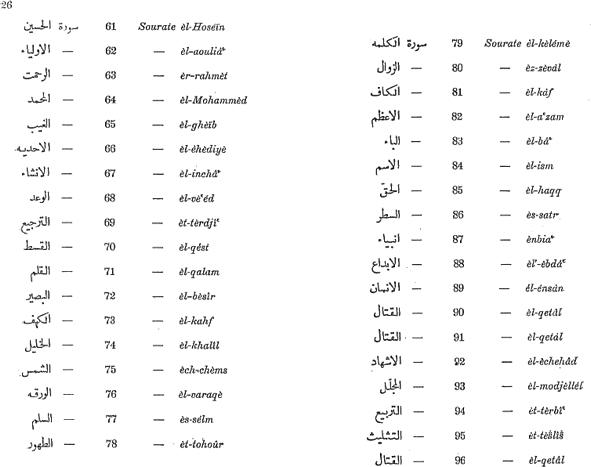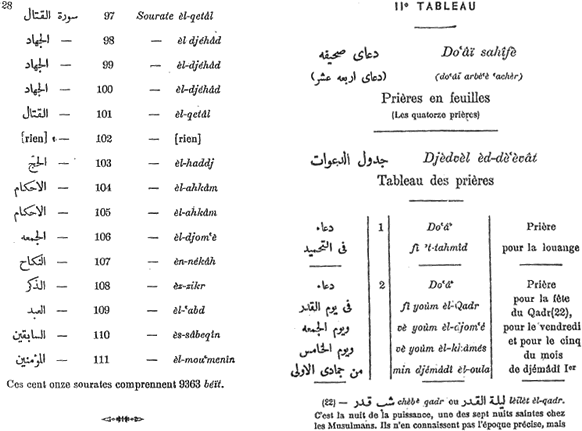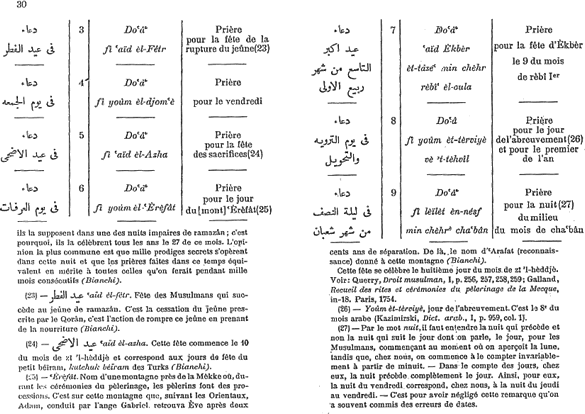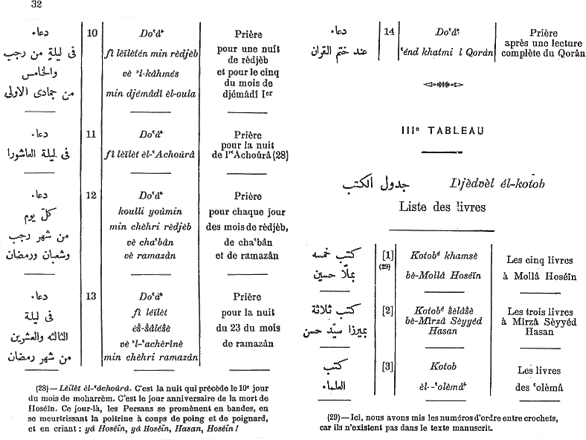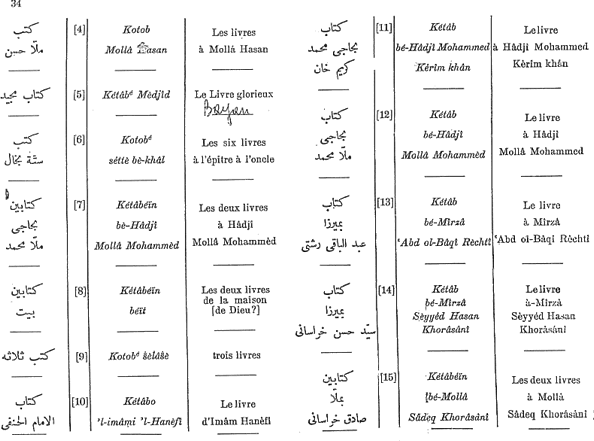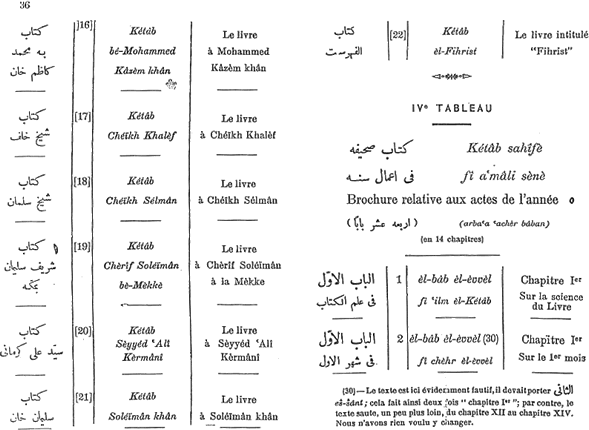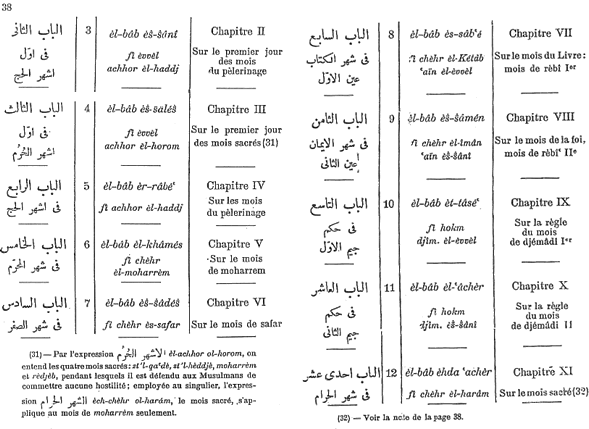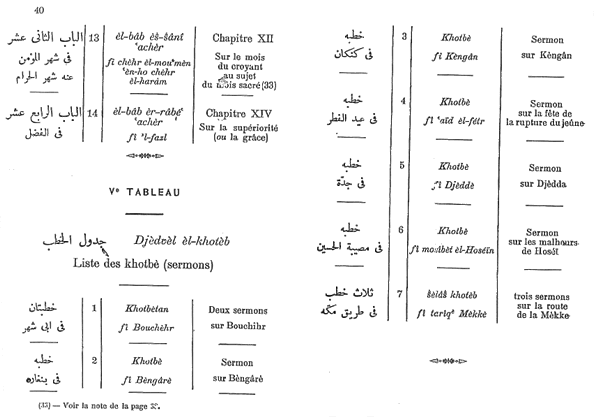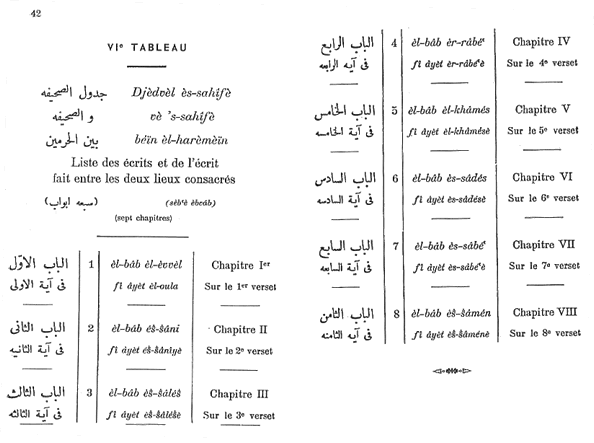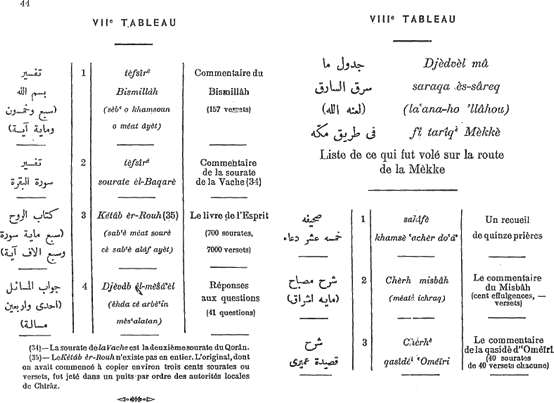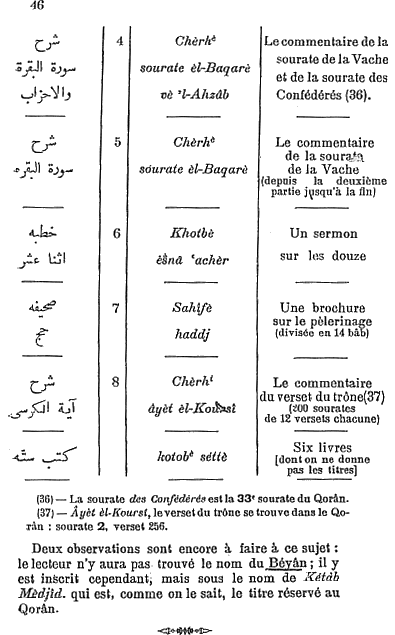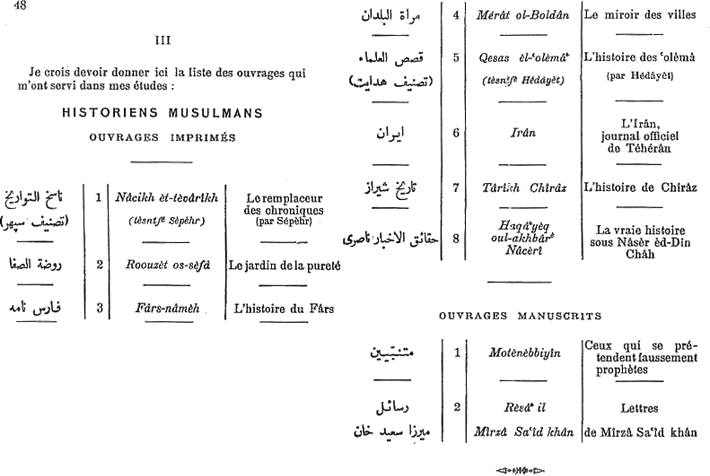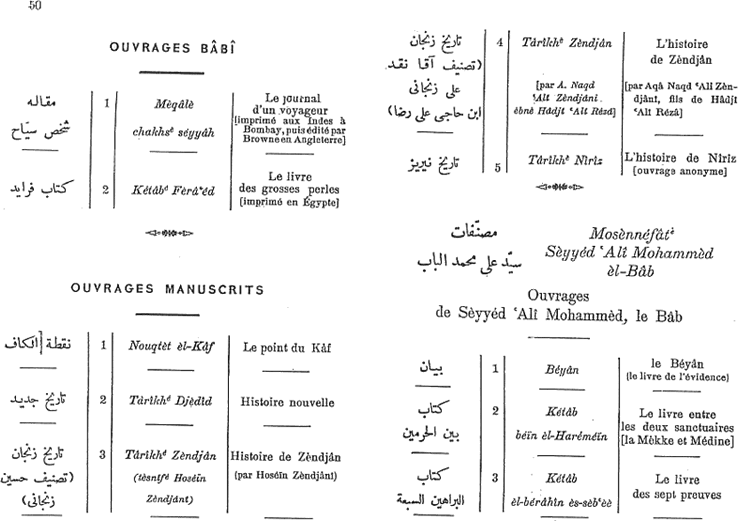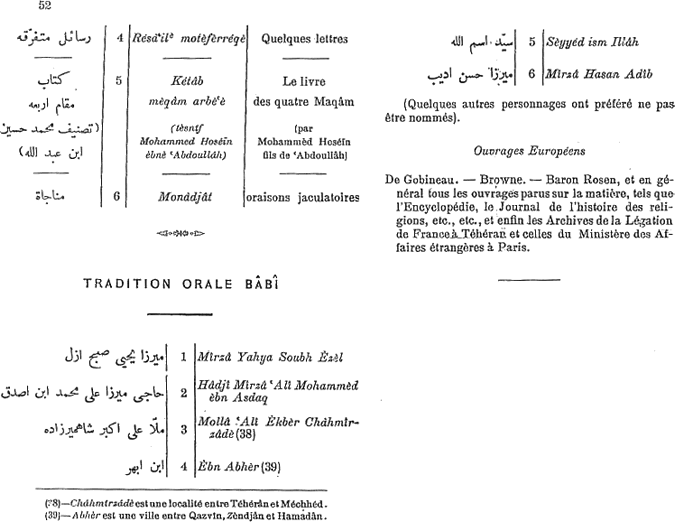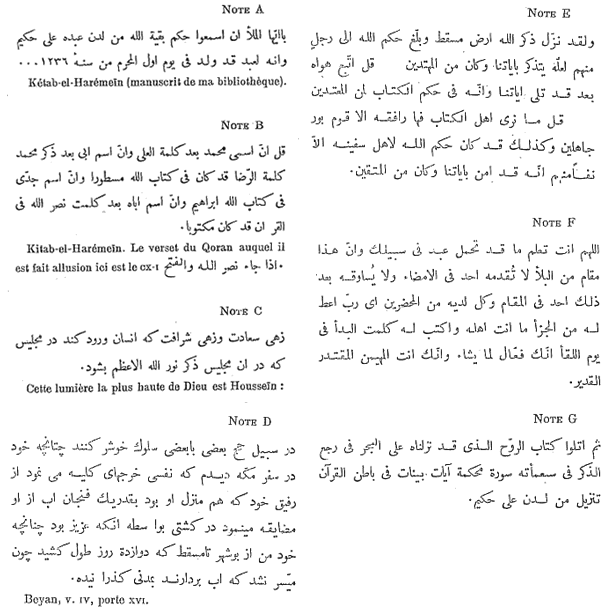Médiathèque baha'ie
Le Bab
A.M.L Nicolas
Orientaliste français en Perse vers 1844
 Médiathèque baha'ie |
Le Bab |
Table des matières
L’ISLAM CHIITE OU ISLAM PERSAN
I - Le Qoran – Ali successeur de Mohammed au titre temporel
II – Les Hadis – Ali associé dans la Manifestation Prophétique de Mohammed auquel il succède comme Imam
III – L’Imam Mehdi – Le Chiisme actuel
HISTOIRE DU BAB
I – Les débuts du Bab jusq’à la Manifestation
II – La Manifestation – Le pèlerinage – Le retour à Chiraz – Fuite à Isfahan – Mort de Manoutcher Khan – Envoi du Bab à Makou
III – Molla Housseïn Bouchrouyéhi le Bab-el-Bab
IV – Qourrèt-oul-Aïne Hazrèt-è-Tahéré – Le Concile de Bèdècht
V – Insurrection du Mazandéran
VI – Insurrection de Zendjan
VII – Le Bab à Makou – Son exécution
VIII – Le cadavre du Bab
IX – Evènements de Yezd et insurrection de Neïriz
X – Attentat contre Nassr-ed-dine-Chah Qadjar
XI – Exécution de Babi après l’attentat contre le Chah en 1852
XII – Exécution de Qourrèt-oul-Aïne
AVANT-PROPOS
M. de Gobineau nous affirme dans son livre qu’il existe trois «Biyyans» composées par le premier Bâb.
L’affirmation a eu lieu de surprendre, et l’on ne comprend guère un Prophète multipliant les rédactions d’un livre à la composition duquel il n’a d’ailleurs aucune part, le texte étant entièrement l’oeuvre de Dieu ; car, ce que Celui que Dieu doit manifester écrit de sa main, est un livre écrit de la main de Dieu, par la raison que Celui que Dieu doit manifester vient de Dieu (1).
Dieu serait-il donc un si mauvais compositeur ? Saurait-il si peu les bases et les fondements de la doctrine qu’il a résolu d’établir, pour se voir obligé à remanier, à deux reprises, dans l’espace de sept années, le Livre dans lequel il a tout d’abord tracé les règles de la nouvelle religion ? Supposition vaine et blasphématoire, car si d’un côté, en ce qui concerne son attribut éternel, il n’y a, de toute éternité, aucun changement en Dieu (2), de l’autre, le Béyân est incréé et existe de toute éternité.
Qu’est-ce à dire ? et que signifient les trois «Biyyans» de M. de Gobineau ?
Veut-il nous dire, qu’ayant lu le commentaire de la 17ème Porte de l'Unité III, qui dit : Le résumé de cette Porte est tout ce qui subsiste du Nouqtè se nomme Béyân. Ce même nom de Béyân, dans sa vérité première, est spécial aux versets; dans sa vérité seconde, il est spécial aux oraisons; dans sa vérité troisième, il s'applique aux commentaires; dans sa vérité quatrième, aux questions scientifiques; dans sa vérité cinquième, aux paroles en langue persane. Mais, ce nom est spécial aux versets et non à autre chose, il entend appeler Béyân tous les versets, c'est-à-dire tous les ouvrages en arabe de Sèyyéd(3) `Ali Mohammed. Mais d'abord, rien ne dit qu'il ait lu ce commentaire, puisqu'il ne l'a pas traduit, et ensuite, ainsi que nous le verrons plus loin, les oeuvres du Bâb sont bien plus nombreuses.
Si nous prenons le nom de Béyân au sens strict que l'on attache d'ordinaire à ce mot, nous devons penser qu'il s'agit de l'ouvrage connu généralement sous ce nom ou sous celui de Qorân des Babî, et que le Bâb nomme ou intitule lui-même Kétâb Mèdjîd, - ce qui probablement a donné lieu à quelque confusion, ce nom étant réservé au Qorân par les musulmans de toutes les sectes.
Dans ce cas, à mon sens, ces trois livres doivent être ramenés à un seul et unique ouvrage, le Béyân. Celui-ci contient 9 chapitres intitulés Unités, renfermant chacun 19 Portes (ou bâb), à l'exception de la dernière Unité qui ne contient que 10 bâb.
Cet ouvrage, relativement court, est souvent obscur, mais non, comme le pense M. de Gobineau, «parce qu'il est écrit d'une manière énigmatique» ou «que chaque mot ait un sens détourné nécessitant un commentateur». A part quelques termes spéciaux, - peu nombreux d'ailleurs, - qui demeurent incompréhensibles pour le lecteur, même très lettré, qui n'en possède pas la clef, le texte n'est ni plus ni moins obscur que celui des livres de philosophie dont les docteurs et les soufï font leurs délices. Je reconnais volontiers, cependant, que la majorité des lecteurs persans n'y verraient que du feu, - exactement d'ailleurs comme s'ils lisaient tel commentaire raffiné du Qorân ou tel traité de philosophie transcendante - ce qui revient à dire que le Béyân est écrit dans la langue spéciale usitée parmi les savants au courant des profondeurs du sens intime de ce monde d'apparences.
Or, par un singulier phénomène, ces savants, ces détenteurs des vérités éternelles n'éprouvent en aucune façon le besoin de faire connaître à la foule les acquisitions qu'ils ont faites dans leur voyage «vers Dieu - en Dieu - avec Dieu - de Dieu». Ils ont, en effet, détourné bien des mots de leur sens apparent primitif, et il est hors de doute que la lecture de leurs ouvrages nécessite un long entraînement.
Or, s'il est exact qu'il y ait pour parvenir à Dieu autant de routes que de pensées humaines, il s'ensuit nécessairement que les avis doivent différer, tant sur la meilleure route elle-même, que sur la station suprême à laquelle on est parvenu. Il en découle immédiatement que ce même mot, détourné de son sens original par tel docteur, sera compris avec une acception différente par tel autre faisant partie d'une autre secte. En apparence, les ouvrages écrits par nos deux philosophes seront semblables, mais en réalité ils seront différents quant au sens et aux conclusions pour celui qui possédera le dictionnaire spécial de l'un et de l'autre. Cela est tellement ancré dans les cervelles persanes qu'on ne peut admettre un auteur n'enveloppant pas sa pensée la plus subtile sous une forme banale, s'il est prosateur, et quelquefois vulgaire et grossière, s'il est poète, tel `Omar Khèyyâm. On trompe ainsi le vulgum pecus, et l'on réserve les trésors de son esprit pour ceux-là seuls qui sont dignes de les apprécier.
Le Bâb, dans le Béyân, n'a pas échappé à cette loi inéluctable, mais du moins, a-t-il employé les termes arabes dans leur acception la plus générale et la moins détournée, en philosophie, s'entend. De là, un danger immédiat pour sa doctrine : tel groupe de philosophes n'admettant pas cette simplicité relative de langage, pouvait - et il n'aurait pas manqué de le faire - donner à ces termes la signification spéciale qu'il y attachait et arriver dès lors à des conclusions bien différentes de celles que désirait le Bâb.
Le danger était pressant, il fallait y parer. Adjoindre un glossaire à son ouvrage, il n'y fallait pas penser. Outre que cela s'est rarement fait en Perse, la 15e Porte de l'Unité II nous apprend que tout ce qui sort de la bouche de Celui que Dieu doit manifester est le Livre de Dieu. Les mots que Dieu fait descendre, quel qu'en soit le degré, viennent de Dieu; les versets sont une onde imputrescible qui descend du ciel, les oraisons sont un lait qui ne se gâtera jamais, les commentaires des versets sont un vin éternellement rouge, les réponses, les explications, les prières sont, un miel toujours pur. Le glossaire eût donc été oeuvre divine, et il semble difficile de faire descendre Dieu au rang de lexicographe.
Le Bâb a donc pris un moyen terme, et il a commenté - je n'en veux pour preuve que les mots commentaires des versets de la citation ci-dessus - les versets du Béyân. Il les a commentés d'une façon générale, il a développé dans ses commentaires sa pensée trop brièvement exprimée dans le texte arabe, et il l'a fait de telle sorte, que cette pensée apparût claire à qui sait lire, je le répète, les ouvrages spéciaux des philosophes de la Perse.
Ce Béyân commenté est donc le second «Biyyan» de M. de Gobineau ; reste à savoir si le premier existe ? je veux dire, si le Bâb a écrit les versets arabes de son livre sans les faire suivre immédiatement de ses commentaires? Cela me paraît difficile, car outre qu'il s'exposait ainsi à voir dénaturer sa pensée, il a eu soin, dans la 2e Porte de l'Unité II, de nous dire: Personne ne peut comprendre toute la science enfermée dans les versets du Béyân, si ce n'est Celui que Dieu doit manifester ou Celui que ce dernier aura instruit; car personne ne peut commenter le Béyân comme il doit l'être, personne n'a le droit de le commenter, car il n'a ni commencement ni fin.
Devant cette défense absolue, devant le danger dont nous avons parlé, devant cette affirmation que personne ne petit comprendre toute la science enfermée dans le Béyân, il faut bien que le Bâb ait commenté lui-même et divinement l'oeuvre divine, puisqu'il voulait être compris des gens auxquels il s'adressait. Et ce commentaire a dû être immédiat, inhérent pour ainsi dire à la rédaction même des versets, car il ne fallait pas laisser à l'erreur le temps de se faire jour.
Je ne crois donc pas, je ne crois en aucune façon, que le Bâb ait d'abord publié les versets arabes du Béyân, pour les commenter dans une seconde édition.
D'où provient donc l'exemplaire traduit - avec plus ou moins de succès - par M. de Gobineau ? Il se peut que l'ouvrage qu'il ait eu entre les mains ait été complet, c'est-à-dire, renfermât les commentaires persans, mais que, n'en pouvant comprendre le sens, il en ait négligé la traduction (4). Cela est inadmissible, car, dans ce cas, M. de Gobineau se fût abstenu de traduire un seul des versets de l'ouvrage du Bâb. D'autre part, il est remarquable que notre ancien ministre à Téhéran traduise des commentaires persans. Dans la Première Unité, par exemple, à la page 473, il nous prévient, dans la note 7, que ce qui suit les mots : O lui, l'essence absolue! est écrit en persan. Il a même bien soin d'ajouter que «ce persan est fortement arabisé, non seulement par la nature des mots, mais aussi par la tendance des formes grammaticales». Or, si le lecteur veut se rapporter à ce passage écrit en persan fortement arabisé, il se rendra compte - si inintelligible soit-il en la forme française dont M. de Gobineau l'a revêtu, - qu'il s'agit ici d'une démonstration s'appuyant sur la science de la valeur numérale des lettres. Voici ce passage :
«Dans l'année 1210 après l'élection de l'apôtre de Dieu, il a donné dans des livres d'exposition et dans des preuves à l'appui (l'explication de) la nature des sept lettres, et il a établi dans l'unité première de l'unité, l'unité de substance, d'attribut, d'action et d'adoration, et il a décidé également que l'indicateur de la bonne direction est Celui que Dieu manifeste et dont le nom est fourni par le calcul des lettres du mot hyy (le vivant), et avant l'apparition (de ce personnage), il a fait sortir la nature des sept lettres du sein des lettres primitives, dont l'antériorité est comprise dans l'unité même, puis (il faut savoir que) dans la source de cet unique repose l'unique du Koran, qui est à la fois manifesté et caché, le premier et le dernier, et (il faut savoir encore que) le document postérieur est (indicatif) de l'essence de l'unique, de même que l'est aussi le document antérieur qui est le Forgân (5)» (Traduction Gobineau).
Quoi qu'il en soit de la traduction française, il est du moins certain que le texte persan se base, je le répète, sur le fin du fin de la science des chiffres.
Ne pourrait-on pas penser qu'un missionnaire bâbî, pressé de se rendre dans la province assignée pour ses prédications, ayant d'ailleurs eu auparavant le loisir d'étudier le Béyân, tant au point de vue religieux que philosophique, se soit contenté de copier à la hâte les versets arabes, et en certains passages, soit qu'il ne les eût pas bien compris ou plutôt peut-être qu'il n'était pas familiarisé avec la science des chiffres et la talismanique, il se soit empressé de copier les commentaires persans ? Ce serait cet ouvrage incomplet qu'aurait possédé M. de Gobineau. Il est vraiment regrettable qu'on ne l'ait pas retrouvé dans sa bibliothèque.
Le troisième Béyân m'embarrasse singulièrement, et je crois devoir me borner à nier purement et simplement son existence que rien ne prouve et rien ne justifie.
Pour en revenir au Béyân de M. de Gobineau, je dois expliquer pourquoi la traduction m'en paraît suspecte et me fait douter du texte même que le traducteur a dû avoir entre les mains. Je serai bref et ne ferai valoir que deux arguments:
M. de Gobineau nous dit lui-même dans sa note 2, page 469, - et cette fois il a raison, - que les Bâbî ont un respect particulier pour le nombre 19. «L'année a 19 mois, le mois 19 jours, le jour 19 heures, etc. Un livre dogmatique d'une aussi haute importance que le livre actuel (le Béyàn) ne peut manquer d'être divisé en 19 parties, dont à la vérité il n'existe que 10, et on en verra la raison. Quoi qu'il en soit, chaque partie est encore divisée en 19 paragraphes.»
Je le répète, tout cela est parfaitement vrai, et nous devons posséder dix Unités divisées chacune en 19 Portes. Or, dans la Première Unité de la traduction de M. de Gobineau, où se trouvent les 19 paragraphes (portes) ? Il n'y en a pas trace. Tandis que dans les autres Unités, notre auteur a bien soin de traduire: «Dans le 3e paragraphe (porte) il est dit..., dans le 4e paragraphe (porte) il est dit...» D'où vient cela? J'avoue n'en rien savoir. Mais, il n'en est pas moins vrai que M. de Gobineau traduit d'abord, page 469, le titre de son livre par ces mots: le Livre des Préceptes, puis il fait suivre ce titre du sous-titre : la Première Unité. Ces deux titres sont inattendus, et je ne puis les expliquer que par ce fait qu'en réalité le Béyân est le livre contenant les préceptes, les dogmes des bâbî. Dans la conversation, on dit couramment que le Livre des Préceptes des bâbî est le Béyân; de là à intituler ainsi, de sa propre autorité, le nouveau Qorân, il y a loin sans doute, mais nous verrons par la suite que notre traducteur n'a pas craint, en certains endroits, de se montrer plus fantaisiste encore, car enfin, il n'y a pas de doute que M. de Gobineau n'ait voulu nous donner la traduction du Béyân.
Or, le Béyân contient théoriquement - 19 Unités contenant chacune 19 Portes, tandis que la traduction dont nous nous occupons ici est divisée en - 19 Unités divisées chacune en 19 paragraphes. Il semble que la différence ne soit pas grande; elle est essentielle, et elle nous donne la base même sur laquelle s'est appuyé Sèyyéd `Ali Mohammed pour revendiquer le titre de prophète, ou, si l'on préfère, celui de Celui que Dieu doit manifester.
En effet, l'auteur des Religions et Philosophies dans l'Asie centrale a l'air de penser que la nouvelle doctrine est éclose spontanément dans le cerveau du Bâb et qu'il la publia, en invitant les gens à croire en lui, simplement parce qu'il affirmait venir de la part de Dieu.
Il n'en est pas le moins du monde ainsi, et ce n'est pas non plus sans raisons et sans raisons sérieuses que le Réformateur prit successivement les titres de Bâb et de Nouqtè Béyân, ou plus simplement de Nouqtè.
Il n'est pas exact non plus que le titre de Bâb, devenu vacant, - Sèyyéd `Alî Mohammed prenant celui de Nouqtè - ait été donné à Mollâ Hoséïn Bouchroùyèhî (6).
De pareilles affirmations ont le double tort d'être contraires à la vérité, et de démontrer ensuite que celui qui les met en avant n'avait pas la moindre idée, ni de la doctrine bâbî, ni de la valeur de ces titres.
Que veut donc dire exactement ce titre de Porte ou bâb ? - Il s'appuie sur les traditions chi'ites et voici comment:
Dieu a envoyé sur terre les prophètes afin que ceux-ci guident les hommes sur la route de sa connaissance. Le dernier, le plus parfait de tous, Mohammed, a donné le Qorân qui contient la science universelle. Il nous ferait connaître Dieu, si nous étions capables de comprendre son enseignement. Cette incapacité est due à la faiblesse de notre intelligence, et cette intelligence est mise à rude épreuve, puisque Mohammed a dit lui-même : Quand je prononce un mot, je pense aux soixante-dix sens qu'il possède (hadîs).
Donc, nous sommes incapables de comprendre le Qorân qui, je le répète, contient en substance et sous une forme condensée toutes les sciences humaines et divines.
Mohammed, lui, les comprenait ces diverses significations, et les comprenant, il était la synthèse des sciences mêmes dont il imprégnait le Qorân. Mais, si le sens nous en devait rester obscur, à quoi nous eût servi le livre divin ? Ici, pour les Persans, interviennent les imâm (7), et le premier d'entre eux, `Alî, gendre du Prophète (8), au sujet duquel Mohammed a dit: Je suis la Ville de la Science et 'Alî en est la Porte(9) (hadîs).
Nous voici donc en face d'un premier Bâb, et ce Bâb n'est rien moins qu' `Ali, l'égal de Mohammed.
Si nous ajoutons que les imâm sont a leur tour des Portes, si nous citons le texte qui dit qu'après les imâm, la porte de la science a été fermée et qu'elle ne sera rouverte que par le 12e imâm, disparu, mais toujours vivant, et qu'on nomme Sâhéb èz - Zèmân, ou Mahdî, ou Qâ`ém (10), etc., etc., si nous nous souvenons que Sèvyéd `Alî Mohammed a annoncé sa doctrine en s'écriant : La Porte est ouverte et je suis cette Porte, on comprendra aisément que le Réformateur accepte en bloc les traditions chi`ites, qu'il se déclare le continuateur des imâm, bien plus, le 12e imâm lui-même, le Sâhéb èz-Zémân, l'héritier direct et divin de Mohammed.
Est-ce là un titre qui puisse se céder? Dépendait-il de la volonté de Sèyyéd `Alî Mohammed d'en décorer qui que ce fût au monde?
Nous venons donc de voir qu'`Ali a été le premier Bâb, nous allons voir aussi qu'il a été le Point ou nouqtè. Ici, il y a lieu de prévenir le lecteur que ce mot doit être expliqué de deux façons : l'une courante, générale, fort connue dans l'orthodoxie musulmane, l'autre nouvelle, particulière au bâbîsme. Nous laisserons actuellement de côté la seconde que nous retrouverons plus tard.
`Alî a dit: Tout ce qui est dans le Qorân est contenu dans la première sourate, tout ce qui est dans la première sourate est contenu dans le Bismillâh èr-Rahman èr-Rahîm, tout ce qui est dans le Bismillâh èr-Rahman èr-Rahîm est, contenu dans le B de Bism..., tout ce qui est contenu dans le B de Bism... est contenu dans le point qui est sous le B, et moi, je buis ce Point.
Les autres imâm l'étaient également, et le Bâb l'est à son tour.
Donc, rien que de très ordinaire, que de très connu dans ces titres : le Bâb, le Point. Ils pouvaient surprendre les ignorants, ils pouvaient étonner un Européen peu au courant de l'islam persan, ils devaient paraître naturels à tout homme un peu instruit.
Cela étant donné, passons rapidement en revue les textes du Béyân qui viennent à l'appui de ce que nous disons : La 9e Porte de l'Unité III nous dit que tout ce qui est dans le Béyân se synthétise dans un des verset du Béyân, la l0e Porte nous explique que ce verset est le premier. Dans le commentaire de cette Porte, le Bâb nous annonce que : Si quelqu'un se reporte aujourd'hui au début de la manifestation de Mohammed, qui est le lieu où s'est fixée la Primitive Volonté (11), il verra que toute chose qui, dans le Qorân, est chose, est chose par lui, bonne ou mauvaise. Elles ont été manifestées de la mer de sa manifestation, car toutes s'appuient sur lui. Or, le but du 1er verset était l'être même de Mohammed dans le Qorân. Or, toute chose découle du B de Bismillâh, signifie simplement que Mohammed est lui-même ce B. Eh bien, que celui qui s'est ainsi reporté au début de Mohammed, se reporte aussi au Béyân ! Tout ce qui s'y trouve, croyant à Dieu ou croyant qu'il est une existence en dehors de Dieu, tout cela n'existe qu'à cause du Nouqtè Béyân; et c'est Lui qu'indique ce verset. Tout ce qui est dans le Béyân se synthétise en l'un des versets, et c'est Lui le B de Bismillâh, et ce B le prouve lui-même. Or, de même que les mots et les lettres sont vrais de par le Nouqtè, de par lui également se manifestent et se multiplient les esprits des êtres.
Peut-être, avant de continuer et pour mieux me faire comprendre, est-il bon de rappeler au lecteur européen que Dieu était un trésor caché, qu'il voulut être connu, et qu'il créa la créature pour être connu d'elle. Ce désir est la Primitive Volonté, et c'est cette Primitive Volonté qui créa le monde. Le monde sort donc tout entier de ses mains et doit retourner à elle, c'est-à-dire que sortant du désir d'être connu il rentre dans ce désir. La création est le voyage de descente de la Primitive Volonté vers la créature, le retour est le voyage de montée de la créature vers la Primitive Volonté. Si l'on représente graphiquement ce voyage par un cercle vertical, qu'on coupe ce cercle par un diamètre perpendiculaire à la ligne d'horizon, on aura en haut: le point de départ de la Primitive Volonté, et son arrivée sera à l'intersection inférieure du diamètre avec la circonférence, ce point d'arrivée étant précisément le point de départ du voyage ascensionnel qui se terminera exactement à l'intersection supérieure du diamètre avec la circonférence ; or, ce point d'intersection est le point de départ de la Primitive Volonté, c'est ce qu'exprime cette formule : Nous appartenons à Dieu et c'est vers Lui que nous devons retourner (12).
Nous tirerons de cela une conclusion qu'il ne faudra pas oublier : c'est que l'essence de Dieu a bien agi sur son attribut, mais que c'est son attribut qui a créé l'univers.
Or, nous l'avons vu, Dieu, ou si l'on préfère, la Primitive Volonté - le Verbe - a créé le monde dans le but d'être connue. D'où, nécessité absolue de créer, avant la créature qui doit connaître, les moyens par lesquels elle arrivera à cette connaissance. Ces moyens sont les livres révélés, dont le Qorân seul - suivant les musulmans - est resté en ce bas monde. Or, Mohammed est inséparable du Qorân; il a donc été créé avant toutes choses, et bien mieux, puisque les créatures n'ont été créées que pour connaître Dieu, que le seul moyen de connaître Dieu est de connaître Mohammed, elles n'ont été créées que pour connaître Mohammed. Celui-ci devient donc et la cause première de la création et sa cause finale.
Nous avons parlé ici le langage de l'islam pour qui Mohammed est l'incarnation de l'Intelligence universelle; le Bâb conserve cette doctrine, mais avec une modification de la dernière importance sur laquelle je ne puis m'étendre ici: Pour lui, la Volonté Primitive, la première création de Dieu, la créatrice du monde, le prophétisme, s'est réfléchie dans le coeur miroir des différents prophètes qui se sont succédé et entre autres dans le coeur de Mohammed.
D'autres vont plus loin encore - et le Bâb les suivra aussi; - ils prétendent que le Qorân, étant la vérité de Dieu, n'a pu être créé. En effet, Dieu étant, sa vérité est. Or, du moment qu'elle est par le fait même de l'existence de Dieu, elle ne peut être créée, non plus que Mohammed, qui est l'incarnation - le miroir - de la vérité de Dieu, en même temps que de la Volonté de Dieu.
Dans les deux cas, nous le voyons, Mohammed est l'origine même de la création des choses, et de même que les mots Bismillâh èr-Rahimân èr-Rahîm - la seule formule qui résume la connaissance de Dieu - découlent de la lettre B (13), de même Mohammed est la lettre B d'où découlent, en même temps que l'univers, la vérité et l'existence de la formule même qu'il a révélée au monde.
Or, qu'est-ce que la lettre B? - Un seul trait horizontal. Ce qui la différencie des autres lettres, également formées d'un trait horizontal, c'est le point diacritique placé au-dessous de la ligne Ce point constitue le B, il en est l'essence; Mohammed est ce point, car il est l'essence du B, qui est l'essence du Bismillâh, qui est l'essence de la connaissance de Dieu; or, cette connaissance étant l'origine et la cause finale de la création, Mohammed est le Point de ce bas- monde et de l'autre (14).
Cela dit, nous pouvons continuer l'examen de cette question en étudiant les 11e et 12e Portes de l'Unité III.
La 11e Porte nous annonce que tout ce qui est dans ce verset qui synthétise le Bé,yân est dans le " Bismillâli èl-Amna` èl-Aqdès:" (15).
La formule est changée : si celle de Mohammed suffisait à son époque, elle ne suffit plus actuellement, et les attributs divins de Rahman et de Rahîm sont inférieurs à ceux indiqués par les noms de Amna` et de Aqdès. Le commentaire nous apprend que toutes les lettres matérielles n'existent et ne découlent que du point - un trait n'étant qu'une succession de points; - or, l'esprit des lettres n'existe et ne se développe que du Point de la Vérité. Ce point, dans le Qorân, est Mohammed, dans le Béyân, le maître des sept lettres (`Alî Mohammèd) et dans la manifestation de Celui que Dieu doit manifester, c'est la Vérité divine, l'être divin, le camphrier en essence, l'essence même car, par sa propre lumière, il est le soleil de la vérité.
Cela revient à dire que les mots ont une forme et une âme : la forme dérive de la répétition ou de la prolongation du Point, et le souffle dérive de la prolongation, de l'émanation du Point de la Vérité: or, ce Point de la vérité était Mohammed dans le Qorân, il est actuellement le Bâb dans le Béyân, il sera Celui que Dieu doit manifester quand il sera manifesté. Qu'est-ce à dire et qu'est cette prolongation ? C'est uniquement la relation qui existe entre la Primitive Volonté, les prophètes et la création nouvelle à chaque période prophétique.
Remarquons encore en passant que, si le Bâb est obligé de s'appuyer sur l'islam pour étayer sa doctrine, il change cependant jusqu'aux formules mêmes d'adoration pour arriver à la réforme qu'il a entreprise. Qu'on n'en sourie pas, car il est certain que si la Perse oubliait le Bismillâh èr-Rahman èr-Rahîm, elle se lancerait dans le progrès.
Enfin, la 12e Porte nous annonce que le Point est comme le soleil, et que les autres lettres (16) sont comme des miroirs mis en face de l'astre resplendissant, ce qui revient à ce que nous disions plus haut, que le Point de Vérité se reflète dans les mots qu'il emploie pour s'exprimer, autrement dit que ces mots participent de la Vérité elle-même.
Donc, et pour nous résumer, la Volonté Primitive ou la Vérité est un Point; elle se réfléchit dans l'être d'un personnage qui, par ce fait même, devient le miroir de ce Point et est, par conséquent, Point lui-même. Comme il est le Point, on concevra, - pour peu que notre démonstration ait été assez claire, - qu'il synthétise toutes les sciences; il est, par suite, la ville de la science. Or, il y a une route pour parvenir à cette ville, et cette route est le bâbîsme, ou, si l'on veut, le Béyân ; il y a des portes ou plutôt une multiple porte qui donne accès dans cette ville, ce sont les personnages de l'Unité ; et, parvenu dans cette ville, le voyageur y contemple le Point de la Vérité, qui n'est autre que l'Unité de Dieu.
Nous voulions donc démontrer que le Béyân devait contenir 19 Unités, contenant chacune 19 Portes (17). Or, sans entrer dans les arcanes de la science cabalistique de la valeur des lettres, - dont nous pourrions bien ne pas sortir, - reconnaissons avec l'auteur des Religions et des Philosophies dans l'Asie centrale que le mot vâhéd, c'est-à-dire «unique» représente dix-neuf, que ce chiffre 19 joue un grand rôle dans le bâbisme; ayons présent à la mémoire que la formule musulmane Bismillâh èr-Rahman èr-Rahîm est composée de dix-neuf lettres, aussi bien que la formule bâbî Bismillâh èl-Amna` èl-Aqdès.
Souvenons-nous que dans la 4e Porte de l'Unité II, 1e Béyân nous rappelle ce verset du Qorân, qui dit : Au-dessus se tiennent dix-neuf (18).
Souvenons-nous encore que les Portes de Lumière sont au nombre de 19, que les Portes de Feu sont aussi au nombre de 19 (Béyân, passim.), et nous constaterons que ces 19 Portes doivent se retrouver dans le Béyân, qui a précisément le même but que les 19 Portes de Lumière. Ce sont en effet ces 19 Portes qui se retrouvent dans l'ouvrage en question, car chacune de ces Portes conduit à l'Unité de Dieu, c'est-à-dire à 19.
Or, ces 19 Portes sont les 19 paragraphes de M. de Gobineau. Mais, qui dit paragraphe dit division, alors que l'Unité est une et ne peut être divisée. Si nous appelons Unités et Portes les diverses stations du Béyân, nous n'aurons porté aucune atteinte à l'apparence de l'Unité, ce qui est fort important; nous ne l'aurons pas fragmentée en paragraphes, elle qui est indivisible, et qui de plus, est inaccessible.
Pour tout dire, j'avouerai que M. de Gobineau a eu le sentiment qu'il devait en être ainsi quand il dit, page 332 : «Le Biyyan étant le livre divin par excellence, doit nécessairement être constitué sur le nombre divin, c'est-à-dire sur le nombre 19. Il est donc composé, en principe, de 19 unités ou divisions principales qui, à leur tour, se subdivisent chacune en 19 paragraphes.»
Mais, les termes employés dans cette citation feraient pâlir Séyyéd `Alî Mohammed. 19 Unités! divisées en 19 paragraphes! Il n'y a pas 19 Unités, il y a une unité qui est 19, comme pour les chrétiens il y a une Unité qui est trois. On accède à cette Unité 19 par dix-neuf fois dix-neuf Portes, ce qui est la condensation, si j'ose m'exprimer ainsi, de 19 (l'Unité) en 19 (Unité} fois 19 (Unité), ou l'Unité dans l'Unité de l'Unité qui est l'Unité absolue.
Ne pas avoir compris ce principe, - quand on a lu les ouvrages du Bâb, - démontre qu'on n'en a pas compris grand'chose et fait naturellement douter de la compétence du traducteur. Mais, poussons un peu plus loin l'étude de cette traduction.
Nous verrons que, tout en affirmant la division du Béyân en 19 Unités, subdivisées en 19 Portes, le traducteur nous donne une Unité première sans subdivision. Cette Unité commence, en effet, par un long préambule et se termine à la première Porte qui débute ainsi : Et nous certainement, nous avons établi dans ce premier paragraphe, que certainement Dieu atteste qu'en vérité Lui, il n'y a pas de Dieu sinon Lui, etc., etc.
Cette première Porte se continue longtemps sans interruption pour ne prendre fin qu'à l'Unité deuxième.
Où sont les 19 Portes? et d'ailleurs, la première Porte de l'Unité première de tous les textes que j'ai pu réunir s'exprime ainsi : Du nombre de toutes choses, celle que Dieu a rendue obligatoire est cette parole: " Il n'y a pas d'autre dieu que Dieu, en vérité! en vérité!
Cet exemple pourrait peut-être suffire, mais je tiens cependant à insister sur la question qui nous occupe.
A la page 473, au paragraphe qui commence par ces mots : Et certes, en vérité tous les nombres sont contenus dans cette unité, on rencontre ce passage : C'est ainsi que Dieu explique la valeur de toutes choses dans le Livre.
Cette phrase est commentée ainsi à la note 6: «Dans le livre du Bâb intitulé le Biyyan, on a «l'explication», ou plutôt dans le livre actuel, que le Biyyan ne fait que commenter.»
Ce n'est donc pas le Béyân que traduit M. de Gobineau? Mais alors, que devient son affirmation de la page 312 : «Outre les deux Biyyans que je viens de nommer, il y en a encore un troisième composé également par le premier (?) Bàb. Sans être ni plus difficile, ni plus facile à comprendre que les deux autres, il les résume dans un format relativement court. On trouvera la traduction de ce catéchisme à la fin du volume.»
D'autre part, on lit à la page 521 du même ouvrage: «Ensuite, le deuxième paragraphe après le dixième (dit) : En vérité (c'est.Dieu qui parle au Bâb), j'ai vu, pendant qu'on te martyrisait (comparaître devant moi) toute la douleur (du monde).»
Ce passage est commenté de la façon suivante page 521, note 1: «C'est ce passage qui me fait douter que le livre soit du Bâb.»
Voilà donc, suivant les affirmations mêmes de. M. de Gobineau, un «Biyyan» qui n'est pas un «Biyyan» composé par le Bâb, qui n'en est pas l'auteur.
J'avoue qu'il faut être très «savant diplomate» pour s'y reconnaître, et, n'étant ni l'un ni l'autre, je me borne à constater, - sans comprendre.
II.
La production littéraire de Sèyyéd `Ali Mohammed, le Bâb, est très considérable et est à peu prés complètement inconnue au monde européen. La chose est d'autant plus regrettable que la religion bâbî ayant, presque aussi tôt après la mort du Bâb, subi des variations considérables, les nouveaux sectaires, Bèhâ`î ou Ezèlî(19), ont eu à s'occuper de bien autre chose que du Bâb et ont complètement négligé ses oeuvres qui sont tombées dans l'oubli le plus profond et le plus complet.
La chose se conçoit assez facilement pour les Bèhâ`i qui ont vu dans Mirzâ Hoséïn `Ali Noûrî Behâ Oullâh le personnage promis par Sèyyéd `Ali Mohammed, c'est-â-dire Celui que Dieu doit manifester.
Mais, je ne conçois pas très bien le rôle joué par Mirzâ Yahya Noûrî Soubh Èzèl, le demi-frère de Mîrzâ Hoséïn `Alî Noûrî Bèhâ` Oullâh. Que ce Mirzâ Yahya ait été considéré par tous les bâbî comme le khalîfe du Bâb défunt, cela ne peut faire de doute pour personne et les Bèhâ`i sont de mauvaise foi quand ils le nient. Mais que, simple khalîfe, Mïrzâ Yahya ait complété le Béyân, - oeuvre réservée par le Bâb lui-mëme à Celui que Dieu doit manifester, - cela me paraît impossible. Or, il l'a fait, puisqu'il me l'a affirmé lui-même. Faut-il donc voir en lui un concurrent de Mîrzâ Hoséïn 'Alî ? - Je ne le sais, et il y a là un point que j'ignore.
Toujours est-il, que ces luttes, qui sont allées jusqu'à l'assassinat et au suicide, ont absorbé toute l'attention des frères ennemis et de leurs partisans.
Séyyéd `Alî Mohammed, le Bâb, ou plutôt ses écrits, ont été si bien oubliés que je n'ai pas rencontré un seul Béhâ`î, pas un seul Èzëlî qui ait lu, par exemple, le Kétâb béïn èl-Haréméïn.
Les seuls livres qui soient restés du domaine courant, je veux dire qui soient lus par quelques bâbî, sont : le Béyân, le commentaire, de la ,Sourate de Joseph (20), le livre des sept Preuves , et le commentaire, de la Sourate el -`Asr (21).
C'est peu, eu égard au nombre considérable d'oeuvres qui sont sorties de la plume du Réformateur et dont je donne ci-après les tableaux:
<< Photo : voir tableau des pages 22 à 53 >>
PREFACE
L'ouvrage que j'offre aujourd'hui au public n'a rien de définitif et ne comporte, pour ainsi dire, qu'un canevas, sur lequel il y aura lieu d'ajouter bien des détails, de corriger bien des incorrections, de relever peut-être des erreurs.
Depuis la date où j'ai remis mon oeuvre à l'éditeur, qui a bien voulu l'accepter, je ne suis pas, en effet resté inactif, et mon travail a consisté surtout à réunir le plus que j'ai pu de manuscrits bâbî, - et .j'entends par manuscrits bâbî les ouvrages de Séyyéd 'Alî Mohammed lui-même, - à les traduire, et à tacher de rétablir, d'après quelques données assez nettes, d'après quelques allusions, le plus souvent très vagues, que j'ai pu recueillir dans ses textes, la physionomie de mon héros.
Jusqu'à présent, la chance qui m'a accompagné dans la réunion de ces livres a été plus grande que mon bon vouloir à les traduire ; et je reste avec, devant moi, une grande quantité de documents à dépouiller.
Je n'ai pu donner dans ce volume toutes les raisons de mes dires; je n'ai pu expliquer toutes les causes des événements auxquels j'ai essayé de faire assister le lecteur ; je n'ai pu, en un mot, même tenter de soulever le monde persan vieux de douze cent soixante ans, et le monde nouveau, si jeune soit-il, mais qui pénètre d'une façon si intime cet assemblage de croyances hétéroclites qui composaient et composent encore aujourd'hui la vie sociale de la grande secte des chi`ites. Ma position à la légation de France, les nombreuses amitiés que j'ai su acquérir dans le pays, mon incompétence d'écrivain m'obligeaient à ne pas déchirer tout d'un coup, tous les voiles. Mon oeuvre est donc largement incomplète et j'en demande pardon aux lecteurs.
Je sais quelles objections on pourra soulever contre moi au simple point de vue de l'histoire. On me fera, par exemple, remarquer que M. V. Rosen, dans les Collections scientifiques de l'Institut des langues orientales, tome VI, fascicule 2, donne comme date de la naissance du Bâb, le 1er moharrem 1235 [=20 octobre 1819], tandis que dans mon ouvrage, je donne la date de 1236 [= 9 octobre 1820]. La seule raison qui m'ait fait choisir celle que j'ai donnée, est que je l'ai trouvée inscrite toute au long dans un de mes manuscrits.
Que ce manuscrit soit l'oeuvre du Bâb, cela ne saurait faire l'ombre d'un doute; mais, qu'il ait été mal copié, ici, je désire insister un peu.
M. V. Rosen, dont la compétence en ces questions est aussi évidente que mon insuffisance est notoire, dit à la page 3 du tome III des Collections scientifiques de l'Institut des langues orientales, tome traitant des Manuscrits persans:
«Quant aux fautes innombrables de grammaire que l'on trouve à chaque pas dans le texte arabe aussi bien que dans le commentaire persan, elles proviennent sans doute presque toujours de l'auteur lui-même et il serait ridicule de les corriger.»
Il insiste au même endroit sur ce point et finit par dire:
«Le lecteur devra donc se défaire de toute velléité grammaticale, oublier un peu la logique et le bon sens et alors il réussira peut-être à comprendre les mystères de ces monuments littéraires, que les adeptes de la vraie foie (sic) appellent avec une ironie involontaire l'exposition claire èl-béyàn.»
Je ne sais pas ce qu'il faut penser de cette dernière affirmation, et je respecte trop toutes les convictions pour aller à l'encontre. Mais le lecteur pourra lire la traduction de l'exposition claire, que je donne dans le deuxième volume, et il se formera directement une opinion. Je dois dire, cependant, que s'il ne comprend pas certains passages, c'est à moi qu'il devra s'en prendre, et non à l'auteur lui-même.
Quant aux fautes grammaticales «tant en arabe qu'en persan», je ne puis m'empêcher de soumettre quelques observations à. M. V. Rosen.
Peut-il vraiment penser que l'auteur d'une infinité de volumes écrits en arabe ne connaissait pas cette langue? Ne croira-t-il pas que, pour une raison quelconque, le Bâb ait volontairement émaillé ses textes de quelques fautes de grammaire, là où le sens ne pouvait prêter au doute ? N'admettra-t-il pas que cette raison soit, par exemple, celle-ci :
Il est de toute évidence, pour quiconque n'a pas de parti pris, que le Qorân contient quelques erreurs, qu'on a essayé de justifier depuis, mais qui n'en ont pas moins prêté le flanc aux railleries des puristes arabes de son époque. N'a-t-on pas écrit des grammaires entières pour justifier quelques-unes des expressions du Qorân? Et tout cela, en fin de compte, pourquoi ? Pour démontrer précisément le contraire de ce à quoi on s'essayait, c'est-à-dire pour prouver que «les règles doivent être tirées des versets des livres révélés, tandis que les versets ne sont pas construits d'après ces règles». Car enfin, deux faits s'imposent :
1° Au point de vue purement humain, le Qorân contient des fautes;
2° Il est la parole même de Dieu (40).
Que les copistes des textes bâbî aient exagéré ces erreurs, il n'y a plus dès lors qu'à se reporter aux documents originaux. Je ne les possède pas plus que M. Rosen, mais je pourrais cependant lui donner l'opinion d'un personnage, anonyme il est vrai, mais qui cependant m'a tout l'air d'être Mollâ Hoséïn Bouchroûyèhî lui-même.
Entre autres manuscrits dont je me suis rendu acquéreur, il s'est rencontré des feuilles volantes qui m'ont été procurées par Mîrzâ Fakhr od-Dîn. Parmi ces feuilles volantes, se trouve le manuscrit que j'ai intitulé AG, qui n'a ni commencement ni fin, mais qui débute, cependant, après la fin d'une pièce quelconque, parce mot Istiftâ. - Cette pièce est suivie de plusieurs autres qui sont certainement du Bâb, on ne peut conserver le moindre doute à ce sujet. La pièce commence ainsi :
«Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux.
O homme! quand tu le veux, demande et dis : En vérité, dans l'islam, un ordre nouveau et grand s'est présenté; un personnage considérable s'est rencontré, qui prétend à un rang très élevé...
Ce personnage, depuis le jour où il a prétendu à ce rang élevé jusqu'au moment où il est revenu du pèlerinage de la Mèkke, en outre des livres qui lui furent volés sur la route de Médine, a écrit quatre grands livres et dix traités (41).
Je vis que tous ces écrits étaient rédigés avec la plus grande et la plus pure éloquence. Ses paroles me parurent si sublimes et si éloquentes, que parfois, quand je suis seul, je me dis à moi-même : «Certes, un homme ne peut prononcer de telles paroles.»
Je vis, chez quelques personnes, plusieurs textes pleins de fautes et qui n'avaient nul rapport les uns avec les autres. Je fis des efforts pour chercher d'où venaient ces fautes, et il me fut bien vite connu qu'elles étaient imputables aux copistes.
Puis, je considérai que même si les copistes écrivaient tous ces livres avec la plus extrême attention et la plus grande circonspection, il se présenterait encore des hommes de parti pris et de nature calomnieuse qui ne manqueraient pas de prétendre que ces livres sont fautifs et mensongers.
Je réunis alors ces quatorze textes dans leur rédaction originale, et du début à la fin de ces livres, je ne pus rencontrer une seule faute, je ne pus trouver une parole qui ne fut à sa place, bref, je n'en pus faire ressortir un mot qui ne fut en règle avec la grammaire et la syntaxe.»
Je pourrais certes, si je ne craignais d'ennuyer pousser ma citation plus loin car le morceau est assez long, mais je pense que cela suffira, si j'ajoute que l'inattention des copistes persans est inouïe, leur ignorance crasse et leur laisser-aller stupéfiant. Qu'on examine le manuscrit 1070 de la Bibliothèque nationale de Paris et les observations indignées qui se trouvent en marge de la page 285 et l'on me donnera probablement raison.
Je demande pardon à M. V. Rosen d'avoir peut-être un peu trop insisté sur ce sujet, mais je pense qu'il m'accordera que le Bâb était libre de dire ce qu'il pensait être la vérité, de même que les musulmans étaient libres de le renier. Il ne faut pas, je crois, se laisser entraîner par l'hostilité des ennemis de la nouvelle doctrine, de façon à finir par dire avec ceux qui suivent les errements des auteurs musulmans fort suspects en la matière, que le style du Bâb est froid, incorrect, lourd et de beaucoup inférieur à celui du Qorân. D'autres ont été d'un autre avis, et ceux-là étaient peut-être compétents.
Le Bâb lui-même a écrit dans le Béyân que, pour se rendre compte de sa doctrine, il fallait lire tous ses ouvrages d'un bout à l'autre. Se doutait-il de la difficulté qu'il réservait à ceux qui seraient désireux d'étudier réellement sa pensée ? J'en doute, car autrement, il eût préféré écrire dans un seul volume et son histoire et son dogme (42). Je sais bien que, de diverses allusions de ses oeuvres, il ressort que quelqu'un écrivait le martyre auquel il était en butte; je sais bien qu'on m'a affirmé qu'il existait des lettres même du vivant, des écrits racontant par le menu les divers incidents terrestres de l'ascension au ciel du nouveau prophète, mais où les trouver ? Comment venir à bout de la défiance d'un esprit oriental avec lequel on n'est pas en relation directe et auquel votre appui est inutile tant qu'il n'est pas directement réclamé?
Nous en sommes donc réduits aux ouvrages du Bâb lui-même et je n'en connais pas un seul qui ait été traduit dans une langue quelconque, si j'en excepte le Traité des Sept Preuves. Là, certes, la mine doit être riche, mais combien difficile à creuser, et surtout combien difficile à trouver, au milieu des disputes des Bèhâ'î et des Ézèlî (43)! Combien l'esprit de ces gens est difficile à pénétrer et à quelles protestations indignées ne s'expose-t-on pas malgré la bonne foi dont on fait preuve, à la moindre question qui peut paraître indiscrète, à la moindre objection qu'on leur soumet ! L'histoire a peu de poids à leurs yeux, comme à ceux de tous leurs compatriotes d'ailleurs, et ils s'empressent avec un zèle ardent, de faire dévier la conversation sur Hoséïn `Ali ou sur Mîrzâ Yahya, suivant qu'ils sont Èzéli ou Béhâ`î. Il est d'usage de dire qu'en Perse, ceux qui n'ont pas de patience en acquièrent et ceux qui en ont la perdent; que faut-il donc dire de ceux qui cherchent à connaître le moindre point de vue religieux en ce pays !
Quoi qu'il en soit, mon but était, en commençant ce propos, de dire qu'il y aurait peut-être beaucoup à refaire à ce que j'appelle mon ouvrage, faute de trouver d'autre mot moins prétentieux et mieux approprié à la circonstance. J'en vais donner un exemple tiré de ce même manuscrit AG dont j'ai parlé tout à l'heure et qui pourra de nouveau venir à mon secours dans d'autres circonstances. Il s'agit des débuts de la prédication de la religion nouvelle.
Je dis ici, c'est-à-dire dans le cours de ce volume, que le Bâb publia urbi et orbi sa mission, puis qu'il se rendit au pèlerinage de la Mèkke. Or, il n'en est pas le moins du monde ainsi. Le Bâb émit bien la prétention d'être l'imâm Mahdî, mais il ne le fit que vis-à-vis d'un très petit nombre de fidèles, qu'il conjura de ne pas le trahir, mais qui ne surent pas garder le secret qui leur avait été confié. Je citerai la pièce tout entière (moins la préface), car elle est certainement du plus haut intérêt. Elle est adressée à un certain Chéïkh `Alî, qui certainement était un des prédicateurs de la nouvelle doctrine, qui habitait Mèchhèd et qui se plaignait amèrement à son maître des tourments auxquels il était en butte.
Voici cette pièce :
----------------------------------------------------
O toi qui es triste ! j’ai lu ta lettre, et ta tristesse et tes larmes m'ont attristé! Mais, comme je suis aujourd'hui dans le paradis, j'obéis à l'ordre de Dieu et je dis: «Gloire à Dieu ! qui a détourné de moi le tourment ! Ce Dieu est sublime et bien au-dessus des qualificatifs que les hommes veulent lui attribuer.
Donc, toi, comme moi, glorifie Dieu qui a détourné de toi aussi les tourments. En vérité, notre Dieu est celui qui pardonne, celui qui donne le salaire.
Donc, ô homme, ne te laisse attrister par rien, car la tristesse m'affecte ! Ne pleure de rien car tes larmes font couler les miennes, et désormais, je ne pourrais plus donner d'ordres à ton sujet, car moi, je t'aime.
Sois donc ferme dans l'obéissance à Dieu! n'aie peur de rien ! En vérité ! tu es ferme dans l'amitié de Dieu! Patiente donc dans les malheurs qui t'assaillent, car la route de la fortune est celle que tu vois. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que de pareils tourments assaillent les amis de Dieu; il n'y a rien de surprenant à ce que les hommes accolent au nom de Celui qui est la cause de la création de tous, qui est la Volonté Primitive elle-même, le nom de Mohâviya, Fi! sur la fortune, fi ! sur la fortune.
J'en jure par ce Dieu qui tient mon esprit entre ses mains, tout le courage des hommes est le néant absolu auprès de mon courage à moi. Et, il en est de même pour tous mes attributs et tous mes rangs, malgré cela, je patiente dans les malheurs à cause du contentement de Dieu ! En vérité, ces malheurs qui m'assiègent, comparativement à tes malheurs à toi, sont comme la mer Caspienne comparativement à une goutte d'eau. Toi tu ne te plains pas, car Dieu, dans le Qoràn, a fait descendre ce verset :
Il nous a promis qu'il est obligatoire pour nous que nous venions en aide aux croyants (Qorân)
J'en jure donc par le Dieu qui tient mon âme dans ses deux mains, si vraiment toi, tu regardes la vérité avec un oeil qui comprend l'intime, tu seras désormais content que, dans la route de Dieu, on fouille tes chairs avec des ciseaux. En vérité ! tout ce qu'il y a sur la surface de la terre, fut-il tué par la tyrannie dans cette religion, que son sang n'équivaudrait pas au prix d'un verset descendu de Dieu !
L'ordre de Dieu est très grand. Ne pense pas qu'il en soit pour lui comme pour celui d'Ahmed (Ahsahî) avant Kâzèm (Réchtî). Si tu penses ainsi, tu es bien loin de la question et de la vérité! Si tu veux comprendre, lis le Livre de la Justice qui est composé de sept cents sourates, puis contemple alors la lumière de Dieu dans les versets de ces sourates.
Non! Est-il possible dans ce monde qu'un homme arrive au degré sublime auquel je suis parvenu, sans que quelqu'un l'ait instruit, ou qu'il se soit instruit ?
Mais, tous les hommes dorment et ils ne comprennent pas!
Si quelqu'un réfléchit et comprend la grandeur de Dieu, la magnificence des versets de Dieu, jamais celui-là ne sortira de la religion de Dieu, découpât-on son corps avec les ciseaux de la tyrannie. Réfléchis un peu, fais attention.
Les vingt-neuf lettres (de l'alphabet) se trouvent entre les mains de tout le monde et voilà que personne n'a la puissance de s'exprimer en des versets semblables aux miens!
Or moi, mes versets je les ai fixés comme témoignage sur l'universalité des êtres de la terre !
As-tu jamais entendu dire que, depuis le début de la création d'Adam jusqu'à aujourd'hui quelqu'un ait tracé quelques lignes sur une feuille de papier et que cette feuille de papier devienne aussitôt un témoignage sur tous les êtres des cieux et de la terre?
Tu ne l'as jamais entendu dire, j'en jure par Dieu, et les autres esclaves de Dieu n'ont jamais rien entendu de pareil. En vérité, c'est ceci même le fruit de la création de Dieu et ce fruit est le plus haut degré de la sublimité.
Oui, c'est là un point fort défectueux; que les lettres de l'alphabet soient entre les mains de tous les hommes, et que tous, s'ils se réunissaient et se mettaient d'accord, ne pourraient faire descendre un verset semblable à mes versets.
Or, cette descente des versets n'est pas l'oeuvre d'un homme, mais les hommes sont morts et ne comprennent pas l'oeuvre de Dieu ! Ils pensent que c'est là oeuvre humaine !
Ceux qui accusent cette oeuvre de Dieu de mensonge, après qu'ils ont lu une feuille de mon livre, ceux-là sont des animaux aux yeux de Dieu et des gens de Dieu.
Il est même dommage de se servir à leur égard de termes d'animaux. Ce sont des ânes, peut-être plus égarés que des ânes car l'âne, au moins, glorifie soixante-dix fois par jour la grandeur de Dieu !
Éloigne-toi donc de ces gens qui sont semblables à des animaux; ne t'attriste pas de leurs oeuvres mauvaises, car, quand ils meurent, alors ils comprennent, si Dieu le veut !
Ne te contriste pas de ce que tu es humble et méprisé; ne prête pas attention à leurs railleries ni à leurs injures, car l'islam est redevenu étranger comme à son début (44).
J'ai juré par le Dieu qui m'a créé: Sèlmân (le salut soit sur lui!), malgré la grandeur qu'il avait auprès de Dieu, était plus méprisé aux yeux des gens de Médine que tu ne peux l'être toi-même. Pense au jour où quelqu'un lui saisissant la barbe, lui dit ce qu'il lui dit (45). Si tu as lu le ziârêt de Sèlmân, que l'imâm a écrit à son sujet, alors tu comprendras quel rang il avait; et si tu ne l'as pas lu, je t'en citerai ces quelques passages:
Salut à toi, ô toi qui t'es séparé des troupes des démons !
Salut à toi qui as parlé avec vérité !
Salut à toi qui n'as pas eu peur du châtiment des rois !
Salut à toi qui as dit vrai, mais qu'on a accusé de mensonge !
Salut à toi qui es sorti sur la route de Dieu, qui as voyagé sur ce chemin !
Dieu, à cause de tes actes, s'honore au milieu des anges des cieux! Ah! si les hommes te connaissaient, s'ils savaient ton rang, comme ils t'aimeraient !
Mais, en vérité, ceux qui t'insultent, ceux qui t'injurient, n'insultent et n'injurient qu'eux-mêmes! Ils ne se raillent que d'eux-mêmes ! Quant à toi, sois ferme sur les sièges de la connaissance de Dieu et ne considère toute la surface de la terre que comme un souffle de chien; car le chien est tantôt dans le feu de la colère, tantôt dans le feu de l'avidité.
Le mépris [de ces hommes] tourmente ton Dieu, car s'ils t'eussent considéré comme grand, ils eussent obéi à Dieu et non à d'autres ! O toi, considère-toi toujours grand, comme tu l'es. N'aie pas peur de la colère et de l'inimitié des démons, car les gens de cette terre doivent nécessairement être tels qu'ils sont. C'est ainsi que [Sèyyéd] Kâzèm [Rèchtî] (que je sois son sacrifice !) l'a dit dans le commentaire de la Khotbè Tutundjiyèh au sujet de l'explication de la terre bénie (Nèdjèf) et de ses habitants: " Ils sont fermes dans l'hypocrisie ! Que Dieu les punisse deux fois à cause de leurs actions mauvaises !"
Vraiment, je ne donne de devoir à personne, si ce n'est d'aimer, s'il le peut, les gens de sa patrie; mais toi, tu es libre ! Mais moi, comme je t'aime, je te dis que quiconque t'aime, c'est pour lui-même; et moi, si je t'aime, je t'aime seulement pour toi-même. Donc, que Dieu t'accorde ton salaire! Qu'il te donne la patience dans les malheurs qui t'assaillent sur la route de Dieu ! En vérité, ton existence avec la foi est plus dévorante pour la famille que le feu de l'enfer, car ta famille connaît ton rang et ta science, mais d'autres qu'eux ne connaissent pas ta valeur. Et si le savant qui est à Thoùs (=Mèchhèd) et ses semblables parmi les chefs de la secte chi`ite, et bien d'autres que ces chefs, savaient combien serait grand leur rang près de Dieu, s'ils croyaient, ceux-là ne se fussent jamais séparés de moi jusqu'à ce que leur esprit eut quitté leur corps ! - Il est obligatoire pour tous les hommes que, s'ils trouvent la sécurité, ils viennent vivre autour de moi. Et si moi je m'asseyais sur le siège de la sécurité, tu verrais tous les `olèmâ, fuir devant moi comme des ânes épouvantés fuient devant un lion (46).
Si tu considères comme plus utile de sortir de ta ville, sors-en et rassure ainsi ton coeur autant que faire se peut. En mon nom, fais le pèlerinage de l'imâm [Réza]. Va voir les tiens de ma part et salue pour moi ton père. Mais n'oublie pas la ville où je me trouve; n'oublie pas ma situation; n'oublie pas que mon ordre est étranger! n'oublie pas la multiplicité des démons.
Si tu le crois bon, va à Êsfahân et emploie tes efforts à mettre les fidèles en sécurité avec l'aide de tes frères en religion, car apaiser leurs tourments est la plus grande des choses aux yeux de Dieu !
Regarde la force de mon coeur, la puissance de ma politique : Dans une ville où personne n'avait donné sa foi à[Sèyyéd].Kâzèm [Rèchtî], mon ordre se leva. Et moi, je me suis gardé moi-même en cachant mon nom, alors cependant que je savais que les grands de cette religion [chéïkhî] avaient élevé leurs têtes dans le désir de cette place (celle de successeur de Kàzèm, en qualité de quatrième colonne). Et j'ai établi cet ordre, que moi, après Kâzèm, je suis la Porte de Dieu, par un livre, un traité et l'acceptation d'un certain nombre de personnes. Puis, de cette ville [donc: Chîrâz] je me rendis au Béït Oullâh èl-Harèm [= la Mèkke]. Or; si après mon départ, personne n'avait manifesté mon nom, personne n'eût été tourmenté ! Mais, mes fidèles ont péché vis-à-vis de Dieu, et alors, il arriva ce qui arriva.
Comprends donc qu'il, faut agir avec politique dans l'ordre de Dieu ! car, parmi les esclaves de Dieu, il en est qui, dès qu'ils entendent un verset, donnent leur foi, comme l'a fait 'Alî Bastamî, sans demander d'autre témoignage.
Fais parvenir le salut de ma part au premier qui a cru au Livre (47) et dis-lui ce qui est arrivé.
Je suis fort triste que mon professeur se taise, quoiqu'il soit en son pouvoir de calmer les choses. Malgré cela, il persiste dans le silence ! Si moi, j'étais aujourd'hui un de ses élèves, comme je l'étais autrefois, j'eusse attendu son aide qu'il lui est obligatoire de donner maintenant. Et cet honneur doit lui suffire dans ce monde et dans l'autre.
O mon Dieu! donne ton aide, car tu n'oublies jamais tes promesses.
Fais ce que je dis et ce que je t'ordonne comme il faut le faire, car rien n'est caché à mes fidèles. Eloigne-toi de la guerre civile et des troubles, fais attention à cacher ta religion si ce n'est là où tu n'as rien à craindre.
Si tu te trouves dans cet endroit (?), emporte avec toi le livre intitulé " Kétâb èr-Rouh "(le Livre de l'Esprit) parce que ce livre est le plus grand des livres de Dieu (48). Fais parvenir ce livre à tous les `olémâ au moment où tu sortiras de la ville.
Aie toujours cet ordre devant toi, et si quelqu'un te demande une prière, ordonne-lui de dire la prière de Vahhâb. Ajoute que s'il la dit, il y aura de l'espoir que Dieu lui pardonne ses péchés et lui accorde ce qu'il désire.
Fais parvenir, de ma part, le salut à tes amis, à ceux qui sont avec toi et à celui dont j'ai écrit le nom dans ce livre [à 'Alî Bastamî]. Envoie la lettre relative à Esfahân, cette lettre que tu as écrite de ta propre écriture. Envoie à Yèzd les écrits dans lesquels tu vois quelque chose d'utile en même temps que le livre Hasaniyèh. N'ignore pas les autres livres divins...
Cette sensibilité du Bâb se retrouve dans chacun de ses ouvrages ; le Béyân nous en donnera des exemples nombreux. Mais, quelle belle page j'extrais ici d'un autre manuscrit (49) que j'ai dans ma bibliothèque !
Réponse de Mâkoû au père de A. Sèyyéd Hoséïn (50)
Et ensuite: En vérité, j'ai lu la lettre que tu avais envoyée à ton fils. Que Dieu te récompense de ton grand malheur et de ta grande patience dans ce malheur !
Pendant que j'étais à Esfahân, j'appris ce qui t'était arrivé, et c'est là un malheur auquel personne ne peut échapper(51).
Que Dieu augmente ta patience 1
Et moi, parce que j'aime la mort, je dis ces quatre vers :
O mort, qui ne lâches jamais personne, viens me délivrer aussi des difficultés de ce monde !
Tu es, ô mort, celle qui m'as pris tous mes amis.
Vraiment, c'est en toi que je vois le salut de tous ceux qui m'aiment !
O mort ! toujours tu te diriges vers un de mes amis comme si on te le désignait !
Dès que je sus le malheur qui t'avait frappé, je permis à ton fils d'aller te retrouver, mais lui n'y consentit pas à cause de son amour religieux pour ma personne.
Et voilà que j'entends de ceux qui sont venus sur cette terre (52) que ton désespoir est profond et que tu as beaucoup vieilli. Aussi, ai-je donné à la lumière de mes yeux, à Hasan (53) la permission de s'en aller vers la terre bénie (54).
Je prie Dieu de l'avoir en sa garde durant la route, et de le faire parvenir jusqu'à Harèm Djelîl (?)
Comme cela te satisfait, je n'ai pas permis ce voyage à son frère aîné, qui restera avec moi, s'il plaît à Dieu, en présence de l'Éternel. Ne sois donc pas contristé à son sujet, car sa présence auprès de moi est plus utile pour toi que s'il allait te retrouver,
Je prie Dieu d'écarter dans sa bienveillance la tristesse et le désespoir du coeur des croyants et d'accorder dans sa faveur un heureux voyage (55) à la terre bénie.
En vérité, sur ce mont où je suis emprisonné, je loue Dieu d'une louange très élevée, plus haute que toute louange, de même que l'ordre de Dieu est plus haut que toutes les invisibilités des cieux et de la terre.
Toi, quand tu entreras dans le harem, salue, de la part des prisonniers, les imâm de la justice, et demande-leur leur bienveillance, car Dieu est garant qu'il répondra à toutes les prières faites sous ces voûtes. Il n'y a pas de doute que Dieu soit fidèle à ses promesses.
Quand la mère de Ahmed voudra aller visiter la maison de Dieu, confie-lui ton plus jeune fils, afin que cet enfant lui rassérène le coeur...
----------------------------------------------------
Mais je suis obligé de mettre un terme à mes citations qui m'entraîneraient trop loin.
D'autre part, j'aurais voulu dire quelques mots au sujet du Béyân (56) qui forme le second volume de mon livre, mais je me vois dans la nécessité de remettre mes explications, jusqu'au moment où je publierai la traduction du Béyân arabe.
II ne me reste donc plus à remplir que la partie la plus agréable de ma tâche : celle de remercier dans toute la sincérité de mon coeur mon bon et brave camarade Jules Gantin de la peine infinie qu'il a bien voulu supporter en corrigeant les épreuves de cette publication. Certes, cela n'était pas facile, et lui seul et moi savons par quel calvaire il a passé. Mais, plus grande a été sa peine, plus grande est ma reconnaissance et celle-ci est infinie.
=====================================
A. L'islam chi'ite (ou Islam persan)
I. LE QORÂN. `ALI SUCCESSEUR DE MOHAMMED (AU TITRE TEMPOREL)
Ce n'est pas seulement dans l'étude de la production littéraire de Sèyyéd `Ali Mohammed et de ses sectateurs qu'il faut puiser, pour se rendre un compte bien net et bien déterminé de la réforme accomplie par le Bâb, de la hauteur de sa doctrine et de sa prescience, miraculeuse pour un Persan, en ce qui concerne les idées générales sur les rapports des peuples entre eux, l'idéal d'une fraternité universelle et l'application désormais sincère de la maxime «Aimez-vous les uns les autres n.
On ne peut avoir une vue d'ensemble, on ne peut se rendre un compte exact du merveilleux effort tenté par le Rénovateur, qu'au prix d'une connaissance approfondie des conditions morales au milieu desquelles évolue actuellement la religion musulmane chi'ite.
C'est avec intention que je souligne ces trois derniers mots, car, s'il est devenu classique de dire que le schisme musulman est dû à ce que les Persans ont considéré Aboû Bèkr, `Omar et `Osmân comme des usurpateurs, alors que les «sonnites» les reconnaissent comme les véritables successeurs du Prophète, ce serait une erreur de croire que là s'arrête la différence qui sépare aujourd'hui si profondément les deux branches issues d'un même tronc.
On a trop souvent dit que le Qorân est un livre universel, dans lequel les musulmans trouvent réunies toutes les lois nécessaires à la bonne marche et à la juste administration d'une société humaine. Cette formule, séduisante surtout par le succès qu'elle avait obtenu, ne résiste pas à un examen un peu attentif, à une connaissance un peu pratique, tant de l'histoire que des moeurs de l'islam.
S'il est vrai que la religion sortie des lèvres du Christ et recueillie par ses apôtres ait eu cependant besoin pour s'affermir, - pour devenir catholique, pour éclaircir bien des points de détail d'une importance capitale, pour marcher d'accord avec les progrès de l'esprit humain, pour poser les bases de ces dogmes qui sont devenus la condition sine qua non de l'existence de la foi, - de réunir une infinité de conciles chargés de trancher les questions embarrassantes d'où souvent dépendait la vie même de la chrétienté,- il est beaucoup plus vrai encore que la religion musulmane, enfermée dans les bornes du Qorân, est loin d'être parfaite ou même suffisante et de présenter dans son texte l'ampleur et le développement nécessaires pour répondre à tous les besoins et prévenir toutes les demandes.
Comme toute oeuvre humaine le Livre par excellence a oublié bien des détails, a laissé dans l'ombre bien des questions, s'est trouvé obscur en bien des points. Mohammed ne laissa pas après lui un clergé hiérarchisé ; il n'y eut donc pas comme chez nous des évêques, des cardinaux, des papes, une échelle ascendante de savoirs et de dévouements. On ne put avoir recours à ces intelligences d'élite, on ne put les rassembler en un même lieu pour leur soumettre les difficultés du moment, on ne put demander aide à ces assises solennelles qui ont si souvent assuré la paix du monde chrétien.
Le Qorân a, en principe, deux sens : un apparent, celui que le vulgaire ou le croyant strictement orthodoxe peut comprendre à la lecture des mots assemblés qui forment une phrase et un sens intime que peuvent seules pénétrer les intelligences supérieures.
Ne peuvent comprendre les versets que Dieu seul et celui qui est doué d'une science solide (57). Et encore, ce sens intime peut-il présenter une infinité de significations : 70.000, dit-on, pour exprimer qu'elles sont en grand nombre. D'ailleurs, le Prophète lui-même a dit :
Quand je prononce un mot, je songe aux soixante-dix significations qu'il possède (58).
Or, si l'on veut bien se pénétrer de la conception musulmane d'après laquelle le Qorân est la parole de Dieu lui-même, on saisira aussitôt toutes les conséquences qui découlent d'une façon immédiate de cette affirmation.
Parole de Dieu, le Qorân est une émanation directe de Sa Sagesse et de Sa Science ; il se confond avec elles, il est elles. Or, Dieu n'est ni plus savant, ni moins sage à un moment de son existence plutôt qu'à un autre et le Temps, n'existe pas pour lui. Il en découle que Sa Sagesse et Sa Science sont coéternelles avec Lui, et par suite que le Qorân a existé de toute éternité; seule, sa manifestation, ou plutôt sa publication, a été localisée dans le Temps. Etant la science de Dieu, il contient toutes les sciences, il les embrasse dans leur ensemble, il en est la synthèse. Aussi, faut-il les posséder toutes pour le comprendre.
Logiquement, une pareille conception eût dû conduire les adeptes de l'islam dans la grande voie des découvertes scientifiques ; ils eussent dû chercher, les uns dans les sciences mathématiques, les autres dans les sciences naturelles, physiques et médicales, d'autres encore dans la chimie ou l'astronomie, les secrets qui nous sont encore cachés, quittes à s'apercevoir après, soit que le Qorân s'est trompé, soit, ce qui eût été plus facile, qu'ils s'étaient trompés dans l'interprétation qu'ils en donnaient.
Mais, les cerveaux asiatiques ne sont pas faits comme les nôtres : avant tout, ils ont voulu percer les mystères divins, ils ont torturé les textes, martyrisé les mots, et manquant même des éléments de ce que nous appelons les sciences, ils sont arrivés aux résultats les plus étranges et les plus imprévus.
Il est vrai que les termes mêmes employés dans le Qorân indiquent bien que Mohammed partageait les idées de son siècle dans les diverses branches des connaissances humaines : telle découverte nouvelle d'une loi astronomique, jusque-là insoupçonnée, eût pu jeter à bas l'édifice de la cosmogonie qoranique, mais c'était précisément à ce moment qu'il s'agissait de faire concorder la science humaine avec la science divine, et une interprétation habile fût vite venue à bout de ce problème. N'a-t-on pas expliqué, - avec beaucoup de raison, - les sept jours de la création du monde, par les diverses périodes qu'a dû traverser le système solaire avant l'apparition de l'homme sur la surface de notre globe ? La chose eût-elle été impossible pour le Qorân ? La preuve que cela eût été au contraire très aisé est que la Perse, obligée enfin de reconnaître l'immense progrès scientifique de l'Europe, tente des explications plus ou moins heureuses, et se convainc petit à petit que les chemins de fer, par exemple, ou les bateaux à vapeur ont été prédits par Mohammed.
Les Persans sont donc allés à l'encontre de ce qu'ils devaient faire, arrêtés qu'ils étaient par un respect superstitieux de la lettre. Ils se sont d'ailleurs rapidement convaincus qu'Hippocrate, Avicenne, etc. etc., avaient dit le dernier mot de la science : ils admirent leurs principes et leurs idées comme inéluctables et c'est ainsi qu'ils ont élevé l'édifice qui nous stupéfie aujourd'hui. J'ignore si les oeuvres des savants dont je viens d'écrire les noms ont été bien traduites en persan; j'en puis douter cependant, puisqu'un mollâ, orné du titre ronflant de Zoù 'r-Riâsètèïn, me parlant des prodiges de la nature, me disait: Hippocrate écrit que le lièvre est une année mâle, une année femelle.
Et comme je lui conseillais de prendre un lièvre vivant, de l'enfermer dans une cage, de le nourrir, et de constater par lui-même la vérité ou l'erreur de cette allégation, il parut fort, surpris qu'on pût douter d'une chose qu'il avait lue dans un livre.
Je ne pense pas qu'Hippocrate ait jamais hasardé une pareille affirmation, mais il se peut que mon mollâ l'ait lue en marge d'un de ses ouvrages ou dans un commentaire.
Un autre, partisan sans s'en douter de la doctrine de la génération spontanée, m'affirmait qu'une brique cuite abandonnée dans une cave humide se transformait en souris. Comme j'eus l'air d'en douter, il m'assura que»je ne sais plus qui» avait pu le constater par lui-même, ayant trouvé dans sa cave une brique dont la moitié déjà. s'était transformée en cet animal. Sans plus répondre, je pris devant lui une brique, la portai dans un coin de ma cave, et le priai désormais, chaque fois qu'il me rendrait visite, d'aller voir si la transformation s'opérait. De ce qu'il retrouva la brique toujours brique, je ne jurerai pas qu'il fut convaincu de l'impossibilité d'une pareille transformation, c' eût été une solution trop simple pour un Persan.; elle n'eut pas lieu, simplement parce que j'étais un chien de chrétien et que les mauvaises influences émanant dé mon impiété pouvaient intervenir fâcheusement dans l' oeuvre de Dieu.
Je ne voudrais pas qu'on crût ici à une plaisanterie; ce que je rapporte est, si j'ose m'exprimer ainsi, la photographie exacte de l'état mental d'une infinité de Persans. Je pourrais, si je ne craignais de fatiguer le lecteur, citer des milliers d'exemples de ce genre (59).
Qu'il nous suffise de dire que le premier de mes interlocuteurs est un philosophe, un théologien fort versé dans la jurisprudence; le second est un médecin.
Voilà donc les sciences qu'on applique à l'interprétation ésotérique du texte sacré ; je laisse à penser comme on les applique, et encore n'ai-je parlé ici que de ce que l'on nomme " les sciences exactes ". Si peu le soient-elles, en Perse, elles n'en sont pas moins l'embryon de la science; mais que dire de la cryptographie, de l'astrologie, de la talismanique et autres inventions de ce genre ? En vertu des calculs de l'abdjèd, on change les lettres d'un mot, on remplace dans une phrase des mots entiers par d'autres, quand on ne modifie pas la phrase elle-même ; des volumes ont été écrits sur l'explication des lettres isolées de certaines sourates du Qorân qui devient dès lors une immense énigme dont on s'acharne de tous les côtés à la fois à chercher la solution.
Et quel guide a-t-on pour se conduire dans ce labyrinthe dont les voies se heurtent et se contournent éternellement sur elles-mêmes? L'imagination seule, accompagnée de la subtilité la plus raffinée, a son libre cours, modifiée par les tempéraments de ceux qui se livrent à ces études. Qui dira les discussions passionnées, les luttes, les guerres intestines, les flots de sang répandus pour démontrer que cette phrase de Mohammed : «Suis-je autre chose qu'un homme comme vous ?» (60) prouve de la façon la plus nette et la plus formelle que Mohammed n'est précisément pas un homme comme nous ! Le byzantinisme le plus outré n'a jamais rien produit qui approchât de cette subtilité maladive.
Dès lors, des divergences d'opinion se produisirent qui ne furent point arrêtées par une autorité supérieure; il se forma un nombre de plus en plus considérable d'interprétations du texte sacré qui valurent surtout par les individus qui les présentaient. Un mollâ, dont la vie austère, les moeurs pures, la pensée désintéressée étaient un exemple de toutes les vertus, réunissait autour de lui un certain nombre de disciples qui acceptaient avec d'autant plus d'ardeur ses explications que son caractère lui avait attiré un plus grand renom. Lui mort, un de ses disciples prenait la direction de l'École. Les choses ne se passent pas autrement aujourd'hui; de là, le nombre inouï de sectes diverses et les conclusions si différentes et quelquefois si inattendues auxquelles elles sont arrivées en travaillant sur la même base.
«Mais, le Qorân n'est pas la seule matière à controverses et le seul objet des discussions de l'Islam. Aussi haut placé que lui dans la vénération des fidèles, aussi divin et aussi sacré se trouve le recueil des hadîs. Et nous touchons ici au second aspect de la question, où la grande et véritable cause de la désunion qui sépare les chi'ites des sonnites et qui empêchera, jusqu'à la consommation des siècles, la réconciliation des deux grandes sectes rivales.»
C'est au chapitre suivant que nous examinerons ce que sont ces hadîs ; nous ne nous occupons en ce moment que des droits d'`Alî à la succession temporelle du Prophète. D'après les chi'ites, ces droits dérivent d'abord du Qorân et ensuite, du choix que Mohammed aurait fait lui-même de son cousin pour lui succéder. Cherchant à rendre compte de la pensée persane, il est bien évident que j'écris cette histoire suivant les idées des chi'ites, sans me préoccuper le moins du monde de la critique historique (61).
Voici donc quelques-uns des versets que Dieu fit descendre du Ciel dans le Qorân au sujet d'`Ali, ce qui veut dire : voici comment Dieu a affermi la prééminence d'`Ali sur les autres musulmans.
«Nos amis sont: Dieu et son apôtre, et ceux qui croient, qui s'acquittent avec exactitude de la prière, qui font l'aumône et s'inclinent devant Dieu» (Qorân, S. 5, v. 60).
Voici dans quelle circonstance ce verset fut révélé : Un jour, Mohammed priait dans la mosquée et ses compagnons l'imitaient. Un mendiant parcourait les rangs des fidèles en demandant l'aumône. Personne ne lui avait donné jusqu'au moment où il arriva près d'`Ali; ce dernier priait et était arrivé à l'instant où l'on s'incline devant Dieu; il détacha la bague qu'il portait à sa main bénie et la jeta au mendiant.
Dans la sourate 5, au verset 71, il est dit :
«O Prophète ! fais connaître tout ce qui est descendu sur toi de la part de ton Seigneur, car si tu ne le fais pas, tu ne t'es pas acquitté de ton message. Dieu te mettra à l'abri des violences des hommes; il n'est pas le guide des infidèles.»
Ce verset est descendu dans les conditions suivantes : Mohammed, revenant du pèlerinage d'adieu, s'arrêta à la station de Ghadîr; il y fit la prière de midi, et se tournant vers ses compagnons, leur dit:
«On m'appelle là-haut et je vais mourir. Sachez que je vous laisse deux grandes choses, dont l'une est plus importante que l'autre : ce sont les versets du Qorân et les gens de ma famille. 'Voyez et réfléchissez comment, après moi, vous agirez avec eux et comment vous les conserverez. Ces deux choses seront jointes ensemble indissolublement jusqu'au jour où elles viendront me rejoindre au bassin du Kôousèr (62). Tant qu'elles seront parmi vous, vous ne pourrez vous égarer»
Le Prophète ajouta :
«Dieu est mon ami, et moi je suis l'ami de tous les croyants.»
Alors, il prit la main d'`Ali et l'éleva si haut que les pieds de ce dernier touchèrent les genoux du Prophète qui s'écria :
«Quiconque me considère comme son ami est l'ami d'`Alî. O mon Dieu ! aime quiconque l'aime et déteste quiconque est son ennemi; viens en aide à quiconque l'aidera et abaisse quiconque voudra l'abaisser.»
Les auteurs des deux livres intitulés Rèbî` oul-Èbrâr et A`alam oul-Vèrâ racontent ce même fait de la manière suivante :
"Quand le Sèyyéd du monde arriva à Ghadîr Khomm (63), il descendit de sa monture et ordonna de déblayer un endroit sous les arbres. Puis, il y fit apporter tous les bâts des chameaux qu'on amoncela en un tas. Il fit signe à un mo'èzzin qui annonça la prière à haute voix. La foule se réunit et le Prophète monta sur les bâts. Sur son ordre, 'Alî y monta aussi et se tint à sa droite. Le Prophète remercia alors Dieu de ses bienfaits et donna aux hommes les conseils suivants :
«Voilà que je vais mourir, parce que le Très-Haut m'appelle, mais il est encore trop tôt pour que je vous quitte. Je vous laisse deux choses qui, si vous vous y attachez constamment, vous maintiendront dans la voie droite: le Livre de Dieu et ma famille. L'une et l'autre sont liées indissolublement jusqu'au jour où elles viendront me rejoindre au lac du Koousèr.»
Puis il ajouta :
«Le Prophète n'est-il pas plus proche des croyants que ne le sont leurs âmes?» (Qorân, S. 33, y. 6.)
«Oui, ô Prophète», répondit la foule.
Il reprit : «Si je suis plus proche de vous que votre âme même, `Alî est aussi plus proche de vous que votre âme même; celui dont je suis l'ami, `Alî est aussi son ami. 0 mon Dieu, aime qui l'aime, et déteste qui le déteste; viens en aide à quiconque l'aidera, affaiblis quiconque voudra l'affaiblir !»
Il descendit alors et se rendit dans sa tente en disant à `Ali d'aller s'asseoir dans la sienne. - Il ordonna aux fidèles d'aller féliciter `Ali dans sa tente, et quand ceux-ci eurent fini, les mères des croyants, sur l'ordre du Prophète, allèrent aussi lui porter leurs félicitations.
Parmi les croyants présents se trouvait 'Omar (èbn Khatthâb) qui lui dit : Bravo, ô fils d'Aboù Thâlèb, car tu es devenu mon Seigneur et le Seigneur des croyants des deux sexes.
Un autre historien rapporte qu'un jour Mohammed ordonna aux Arabes de se choisir chacun un frère. Il unit par les liens de la fraternité 'Omar et Aboû Bèkr, 'Abd our-Rahman (èbn 'Aouf) avec `Osmân et continua ainsi pour tous les rnohâdjèr (64). Alors `Alî baissa la tête et se leva pour partir. Mohammed lui demanda où il allait. `Alî lui répondit :
«Pour chaque mohâdjèr, tu as choisi un frère et voilà que tu n'as même pas prononcé mon nom.
- Je t'ai laissé en dernier, répliqua le Prophète, pour te nommer mon frère. Et c'est Gabriel qui l'a ainsi ordonné. Viens, `A lî, faisons pacte de fraternité, afin que désormais, en fait et en vérité, nous soyons deux frères.»
Il dit aussi à`Alî : Toi, tu es pour moi comme Aaron pour Moïse, mais, (après moi) il n'y aura pas de prophète (65).
Parmi les autres versets du Qorân relatifs à 'Alî, on: peut citer les suivants:
«(Les justes) ont accompli leurs seaux et ont craint le jour dont les calamités s'étendront au loin» (Qorân, 76, 7).
«Ils ont distribué a cause de lui (Dieu) de la nourriture au pauvre, à l'orphelin et au captif» (Qorân,. 76, 8).
«Quelle que soit l'aumône que vous ferez, quel que soit le voeu que vous formerez, Dieu les connaîtra. Les méchants n'auront aucune assistance. Faites-vous l'aumône au grand jour? c'est louable; la faites-vous secrètement et secourez-vous les pauvres? cela vous sera encore plus méritoire. Unetelle conduite fera effacer vos péchés. Dieu est instruit de ce que vous faites» (Qorân, 2, 273).
«O croyants! obéissez à Dieu, obéissez à l'apôtre et à ceux d'entre vous qui exercent l'autorité. Portes vos différends devant Dieu et devant l'apôtre, si vous croyez en Dieu et au jour dernier. C'est le meilleur moyen de terminer vos contestations» (Qorân, 4, 62).
A ce sujet, Djàbèr (èbn Yézîd) èl-Djoù`fî, èl-Koùfî (66) rapporte qu'il a entendu ceci de Djâbèr (èbn 'Abd Oullâh, èbn `Amr) (67) ansârî, quand descendit le verset :
«O croyants! obéissez à Dieu, obéissez à l'apôtre de Dieu et à ceux d'entre vous qui exercent l'autorité (68)».
Je demandai au Prophète : «Quels sont ceux d'entre vous qui exercent l'autorité et au sujet desquels Dieu dit : Obéissez à moi et à eux?
Mohammed lui dit
«Ce sont mes khalifes après moi, ô Djâbèr (èbn 'A bd Oullâh) ! Ce seront eux les guides qui montreront la route. Le premier d'entre eux est `Alî (èbn Aboù Thâlèb); après lui,Hasan, puis Hoséïn, puis 'Alî (èbn Hoséïn); après lui,Mohammed (èbn `Alî), et celui-ci est connu dans la Tourat sous le nom de Bâgher.Il est trop tôt pour que tu lui rendes tes services (69). Quand tu le verras, salue-le de ma part. Son successeur sera Sâdeq Dja`fer (èbn Mohammed). Après lui viendra Mousa (èbn Dja`fèr), puis 'Alî (èbn Mousa), puis Mohammed (èbn `Alî). Après lui : `Alî (èbn Mohammed),et ensuite Hasan(èbn `Ali),`Askèrî. Puis viendra mon homonyme Hoddjèt Oullâh fî'l-arz (la preuve de Dieu sur la terre), le très pur parmi les purs, Mohammed (èbn Hasan) `Askèrî (70). Ce douzième imâm est celui à qui Dieu donnera la victoire du levant au couchant, et c'est lui qui sera caché parmi ses ses sectateurs et ses saints. Pendant qu'il sera caché, personne ne croira à son règne, si ce n'est les privilégiés à qui Dieu aura mis sa foi dans le coeur.»
Je demandai alors, continua Djâbèr, au Prophète si pendant que ce douzième imâm serait ainsi caché, il serait utile à ses sectateurs :
«Certes, me répondit l'apôtre, j'en jure par Celui qui m'a fait son prophète. Ses fidèles seront resplendissants de sa lumière, et son règne caché leur sera aussi profitable que le soleil aux autres hommes.»
Trois autres versets également' descendus du ciel pour `Alî,.sont les suivants :
«Ceux qui feront l'aumône le jour ou la nuit, en secret ou en public, en recevront la récompense de Dieu. La crainte ne descendra point sur eux, et ils ne seront point affligés» (Qorân. 2. 275).
«E t les premiers seront les premiers» (Qoràn, 56,10).
«Ceux-ci [les premiers] seront les plus rapprochés de Dieu» (Qorâ,n, 56, 11).
Au sujet de ces derniers versets, l'auteur du Kèchf oul-Qounaméh dit qu'Èbn `Abbâs demanda. «Quels sont ceux-là?» et Mohammed répéta à trois' reprises 'Alî, Fâthimèh et leurs deux fils.
Oumm Selméh raconte ce qui suit : Le Prophète était un jour assis au milieu de nous quand Fâthimèh entra. L'apôtre lui demanda :
- «Où sont 'Alî et ses deux fils?»
- «A la maison», répondit-elle.
- «Eh bien, va leur dire de venir auprès de moi.»
Fâthiméh alla les chercher et revînt avec eux.
Quand Mohammed les vit arriver, il se leva et les couvrit tous les quatre de son vêtement de nuit, puis il pria en ces termes :
«O mon Dieu ! celle-ci est ma fille, et ce sont là les créatures que je préfère; entre les créatures; éloigne d'elles les impuretés, garde-les pures, ô mon Dieu!»
Alors, du haut des cieux, Dieu fit descendre ce verset:
«Restez tranquilles dans vos maisons, n'affectez pas le luxe des temps passés de l'ignorance; observez les heures de la prière; faites l'aumône; obéissez à Dieu et à son apôtre. Dieu ne veut qu' éloigner l'abomination de vous tous, de sa famille, et vous assurer une pureté parfaite» (Qorân, 33, 31).
Le verset suivant est aussi descendu pour `Alî :
«Tel autre s'est vendu lui-même pour faire une action agréable à Dieu» (Qorân, 2, 203).
Et voici en quelles circonstances : Les infidèles voulaient tuer Mohammed. L'apôtre s'enfuit de la Mèkke après avoir fait coucher `Alî à sa place, dans son propre lit, afin que les infidèles crussent qu'il était resté chez lui. Ce fut au milieu de la nuit que Mohammed sortit de la ville et alla se réfugier dans la grotte de Sor(71) (ghâr bè-Sor), où il se cacha. Aboû Djéhèl, Aboû Lahab, Aboû Sofyân (72) et d'autres mécréants vinrent à sa maison, en brisèrent la porte et pénétrèrent dans les chambres. `Alî se leva du lit et s'avança vers eux. Ils lui demandèrent:
- Où est Mohammed?
- Vous devez le savoir mieux que moi, puisque vous avez couru après lui toute la nuit (73).
Les commentateurs expliquent de la façon suivante pourquoi ce verset :
«Celui qui a cru sera-t-il comme celui qui s'est livré au péché ? seront-ils égaux l'un et l'autre?» (Qorân, 32, 18).
est descendu pour `Alî.
Un jour, pour une raison quelconque, une querelle s'éleva entre ce dernier et Vèlîd (èbn `Aqabé, èbn Abî Mogbirè), le non-musulman. Vèlîd lui dit :
- Tais-toi, car tu n'es qu'un enfant; ma langue est plus acérée que la tienne et ma lance plus aiguë que celle que tu portes.
- C'est à toi de te taire, répliqua `Ali, car tu n'es qu'un méchant.
C'est pour approuver `Alî que Dieu révéla ce verset 32, 18. ,
Le verset suivant concerne aussi `Ali:
«Si vous revenez à Dieu (si vous vous repentez), car vos coeurs (à vous, Hafséh es Aïchèh), ont gauchi, Dieu vous pardonnera; mais si vous vous joignez toutes deux contre le Prophète, sachez que Dieu est son patron, que Gabriel, que tout homme juste (74) parmi les croyants et les anges, lui prêteront assistance» (Qorân, 66.4)
Il est prouvé de plusieurs façons que Mohammed, quand il prononça ce verset, indiqua `Ali et lui dit :
«C'est par toi que trouvent leur route ceux qui se dirigent vers Dieu après moi.»
Mohammed rappelait ainsi le verset sacré suivant :
«Chaque peuple a eu un envoyé chargé de le diriger.» (Qorân, 13,8.)
Voilà donc quels sont les titres incontestables d'`Ali, titres si incontestables que je ne puis m'empêcher de rapporter ici une anecdote personnelle qui montre, sous un jour amusant, la crédulité persane.
Un vieux médecin vint me voir un jour, la figure rayonnante de joie : «Bonne nouvelle! s'écria-t-il en entrant. Je sais de bonne source que le sultan de Constantinople, ayant appris que chaque année de nombreux pèlerins persans se rendaient aux Lieux Saints (75), voulut en connaître la raison. On la lui dit, et il réclama alors une explication détaillée des événements des premiers temps de l'islam. Quand on la lui eut impartialement fournie, il s'écria :
- Mais alors, `Alî est le véritable successeur du Prophète.
- Sans doute, répondirent les `olèmâ sonnites, en faisant la grimace, mais il est inutile de le dire.
- Taisez-vous, chiens ! intervint le sultan, je me fais chi'ite, et j'entends que vous le deveniez.
- Enfin, s'écriait mon médecin, nous sommes les maîtres du monde !»
Malheureusement pour les chi'ites, une évidence pourtant si impérieuse ne frappa pas tous les yeux, même au moment de la mort de Mohammed, où pourtant tous devaient se souvenir des paroles de l'apôtre.
Ensuite, Aboù Bèkr fut élu khalife, puis `Omar. 'Omar mourut des suites de la blessure que lui fit Aboû Loulou, cavalier' de Moghîrè (èbn Chou'bè) (76).
Pendant qu'il agonisait sur son lit de mort, ses compagnons discutèrent autour de lui sur le choix de son successeur. 'Omar déclara que six personnages étaient seuls dignes de ces fonctions : «mais chacune de ces six personnes, dit-il, a un défaut qui m'empêche de fixer mon choix.
Le 1er est `Alî, mais il a une envie trop avide d'être khalife, et c'est pour cela que je ne le choisis pas.
Le 2e est `Osmân (èbn`Affân), mais il aime trop ses ses parents et il les préférerait aux autres musulmans.
Le 3e est `Abd our-Rahman (èbn `Aouf), mais il est le Qâroûn (77), de notre nation.
Le 4e est Thalhè, mais il est trop orgueilleux.
Le 5e est Zobéïr (èbn `Avvâm), mais il est d'un mauvais naturel;
Et le 6° est Sa'ad (èbnn Abî Vaqqâs) (78).
Il faut donc que ces six personnages se réunissent après ma mort et décident du choix de celui qui doit me succéder. Si cinq d'entre eux tombent d'accord sur un nom et que le sixième refuse de s'incliner, il devra être mis à mort. Si quatre d'entre eux sont d'accord et que les deux autres refusent d'agréer le choix ainsi fait, qu'ils soient exécutés. Mais si les avis sont partagés par moitié, il faudra accepter le candidat du groupe dont fera partie `Abd our-Rahman.»
Puis il chargea Aboû Thalhè, ansârî, avec 50 de ses hommes, de tenir la main à ce que ces six personnages procédassent dans le plus bref délai possible à l'élection du nouveau khalife.
Dés qu' `Omar eut été enterré (79), Aboû Thalhé réunit les six électeurs (ashab -èchchoura) dans sa maison (80). Chacun y fit son propre éloge. Alors, 'Abd our-Rahman leur proposa de confier l'élection à trois d'entre eux. Zobéïr déclara qu'il chargeait `Alî de son vote, Thalhè choisit `Osmân et 'Abd our-Rahman fut délégué par Sa'ad (èbn Abî Vaqqâs). Aussitôt 'Abd our-Rahman fit connaître qu'il retirait sa candidature ainsi que celle de Sa'ad, et s'adressant à`Ali et à `Osmân, il leur dit :
- Si vous y consentez, moi seul je donnerai la décision.
- Soit, dit `Alî, mais à la condition que tu ne suivras pas ton propre penchant et que tu te laisseras guider uniquement par la justice.
- C'est ainsi que j'agirai, répliqua 'Abd our-Rahman; mais promettez-moi tous deux de vous soumettre à ma décision.»
Les deux candidats le promirent.
Le quatrième jour après la mort d'`Omar (81), le matin, tous se rendirent à la mosquée. 'Abd ourRahman s'adressant au peuple cria: «O hommes, qui de nous est digne d'être notre khalife?»
`Ammâr (èbn Yâçèr) (82) l'interpella et lui dit : «Si tu veux que dans l'islam il n'y ait pas de schisme, si tu veux que l'esprit de notre Prophète soit content, nomme 'Alî, qui est l'imâm élevé et noble d'entre les hommes.»
Aboû Zèrr èl-Ghifârî (83), Migdâd (èbn Asvèd, èbn `Amr) èl-Kéndi (84) et d'autres grands personnages approuvèrent ces paroles ; mais 'Abd Oullâh (èbn Sa'ad, èbn Abî Sarh) (85), qui était le frère de lait d'`Osmân, - celui-là même qui avait autrefois renié l'islamisme et dont le Prophète avait autorisé le meurtre à la Mèkke après cette apostasie, - s'écria : «Si tu veux que les Qorèïchites ne se séparent pas de l'islam, nomme `Osmân au trône du khalifat.»
Mais `Ammâr prit vivement à partie `Abd Oullâh: «Depuis quand donc as-tu le droit de donner un avis et depuis quand comptes-tu parmi les grands de l'islam ?»
Il y eut une vive discussion entre les Bènî Oméyyèh et les Béni Hâchèm. Enfin, `Ammâr s'écria : «O musulmans, c'est par l'intermédiaire de son Prophète que Dieu nous a grandis et nous a élevés parmi les nations. C'est par sa famille qu'il nous a chéris, c'est par elle qu'il nous a couverts de gloire ! Pourquoi cette opposition et pourquoi voulez-vous éloingner la famille du Prophète du pontificat ?»
Alors, `Abd our-Rahman prit la main d'`Ali (86) et lui dit «O `Alî ! tu es le plus digne du khalifat, mais promets-moi que tu agiras suivant le Qorâ.n et la tradition laissée par les deux chéïkh (87) et non suivant ton inspiration.»
`Alî répondit : «J'espère agir ainsi, quoique ma science personnelle puisse avoir quelque utilité en certaines circonstances. Mais, quoi qu'il en soit, je n'agirai pas suivant ma propre inspiration.»
`Ali parla ainsi parce qu'en réalité il était moujtèhéd, c'est-à-dire parfaitement capable de promulguer lui-même des lois.
'Abd our-Rahman, qui désirait élire `Osmân, eut la fatale idée de lâcher la main d'`Alî pour prendre celle d'`Osmân qu'il interrogea de la même façon.
`Osmân se borna à répondre
«J'accepte ce que tu dis.»
Alors `Abd our-Rahman leva la tête vers le ciel et dit : «O Dieu! tu es témoin que j'ai orné `Osmân du désir de mettre à son cou le collier du khalifat.»
«O fils de `Aouf [c. a. d., `Abd our-Rahman], S'écria `Alî, ton but dans toute cette scène était d'attirer sur toi l'attention publique, et ce n'est pas la première fois que tu te montres mon ennemi. Mais il est encore trop tôt pour qu'on reconnaisse quel est le bon et quel est le méchant !»
Cette élection eut lieu le lundi 20 moharrem de l'an 24(88).
`Osmân avait alors 65 ans. Il régna 11 ans, 11 mois et 19 jours. Ce fut le vendredi 22 zî 'l-hèddjèh 35 (89) qu'il fut assassiné par une troupe de mohâdjèr (émigrés ), d'ansâr (auxiliaires) (90) et de gens d'Égypte, de Koûfa et de Basra. Son corps resta trois jours étendu sur les ordures et exhala bientôt une odeur insupportable. Hakim (èbn Hézâm) (91) et Djobéïr (èbn Mouth'èm) (92) allèrent au milieu de la nuit relever le cadavre qu'ils ensevelirent dans un vieux vêtement, puis sur le refus des ansâr de le laisser enterrer dans un cimetière musulman, ils l'enfouirent au cimetière juif de Baqî' (93), au coin d'un mur (94). (Ici se termine l'extrait que je donne du Zinèt él-mèdjâlès).
Donc, ainsi qu'on a pu le voir, trois points ressortent de ces faits :
1° C'est qu'`Ali a été choisi par Dieu lui-même pour être le successeur de Mohammed, et qu'il doit être le guide de la nation musulmane après lui ;
2° C'est qu'`Ali se croit le droit de modifier au besoin les préceptes du Qorân;
3° Enfin, c'est que déjà un parti hostile se lève contre `Ali
Cette hostilité remonte d'ailleurs au temps du Prophète lui-même.
On sait qu'`Ali, `Omar, Aboû Bèkr, `Osmân et les principaux des compagnons étaient de la tribu de Qoréïch et par suite parents du Prophète. Dès leur enfance, ils étaient liés par la camaraderie, tenus par leur parenté, habitués à avoir confiance les uns dans les autres. C'est précisément cette intimité qui les incita à venir se ranger autour de Mohammed quand celui-ci se déclara le Prophète de Dieu.
`Ali, dès son enfance, avait subi l'ascendant de l'apôtre et lui avait voué une amitié profonde qui ne se démentit jamais; il fut le premier à lui donner sa foi et était, au surplus, son plus proche parent. Mais Aboû Bèkr, lui aussi, se convertit rapidement ; c'était un homme d'un âge déjà mûr et qui n'hésita pas à risquer dans l'aventure sa vie, sa fortune, celles de sa femme et de ses enfants. Il était le père d'`Aïchèh et compagnon de la Caverne; le Prophète lui décerna le titre de Séddiq Èkbèr.
`Osmân (èbn `Affân) était lui aussi, proche parent de Mohammed, dont il fut par la suite deux fois le gendre, ce qui lui valut le titre de Zoù' n-Nouréïn (95).
Il était de plus apparenté avec les Abî Mo`éïth et les Bénî Omèyyèh; lui aussi compte parmi les premiers convertis.
`Omar (èbn èl-Khatthâb) donna sa foi un peu plus tard que les autres ; mais fut tout pénétré d’Islamisme, et peu de personnes peuvent se vanter d'avoir rendu d'aussi éminents services à la religion et de l'avoir répandue sur autant de territoires.
Sa fille Hafsèh (96) devint la femme du Prophète (97) et lui-même, épousa Roqéyyèh, fille d'`Alî (èbn Aboû Thâléb) (98).
Ce fut précisément par les femmes que la lutte fut engagée. - 'Aïchèh et Fâthimèh (bèn `Âïchèh), également chéries du Prophète, s'entendaient fort mal et le laissaient voir. Les hommes subissaient leurs influences, et plus d'une fois Mohammed du user de son autorité pour rétablir le calme et le bon ordre.
Quand Mohammed mourut (99), ce fut un moment critique : l'élévation d'Aboû Bèkr au khalifat dut frapper au coeur `Alî et particulièrement Fâthimèh. Fort heureusement, Fâthimèh suivit de près (100) son
père dans la tombe, et Alî ne marchanda pas son appui au nouveau khalife. En effet, la révolte surgissait de toutes parts; les Arabes que le sabre avait conquis, rejetaient l'islam, des tribus entières retournaient au paganisme.
Devant une situation aussi grave, les chefs de l'islam, dont la plupart étaient des premiers compagnons et des mohâdjèr, ne songeant par-dessus tout qu'à la conservation de la nouvelle religion, se gardèrent, - de peur que leurs dissentiments devinssent une cause de faiblesse pour leur cause, - de révéler les passions qui s'agitaient dans leurs coeurs, ni de se plaindre de leurs espoirs déçus.
Leur union fut si parfaite et si solide, qu'en deux ans et trois mois, l'islam avait conquis toute l'Arabie et une partie de la Syrie.
A la mort d'Aboû Bèkr (101), les choses étaient rétablies, et de nouvelles conquêtes étaient venues s'ajouter à celles de Mohammed.
'Omar, qui lui succéda, montra la plus grande déférence pour `Alî, mais celui-ci commençait à trouver que ses droits étaient trop souvent et trop longtemps méconnus.
L'élection d"Osmân, successeur d"Omar, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase; le coeur d"Alî s'enflamma de colère, et il cria partout qu'il était trompé, bafoué, dépouillé de ses droits.
Fort heureusement pour 'Alî, 'Omar avait bien jugé `Osmân. Les tribus des Abi Mo'éith et des Abi Omèyyèh devenues très puissantes, grâce au gouvernement qu'exerçait, à Damas depuis une quinzaine d'années Mo'âviya (èbn Abi Sofyân) Emèvî, sentirent lors de l'accession au trône, (102) de ce parent, croître leurs prétentions et leur avidité. Leur orgueil insupportable froissa à plus d'une reprise les légitimes susceptibilités des compagnons du Prophète, et la famille des Bénî Hâchèm se vit peu à peu supplantée par, ces envahisseurs trop avides et trop riches.
Les mécontents entourèrent `Alî, qui à ce moment avait quarante-huit ans (103) et qui, chef de la famille des Béni Hâchèm, jouissait de la plénitude de ses forces physiques et intellectuelles.
Les choses en vinrent à un tel point que l'ordre fut troublé à plusieurs reprises- et l'agitation prit un caractère inquiétant. `Alî intervint chaque fois en faveur d"Osmân, son ennemi, jouant ainsi le beau rôle et s'attirant la sympathie des gens tranquilles et soucieux du bon ordre. Mais les événements se précipitèrent, grâce à l'impopularité et à la violence de Mèrvân (èbn èl-Hâkèm) (104), maudit du Prophète, chassé par les deux chéikh et devenu le ministre tout-puissant d’Osmân.
Médine était pleine de plaignants accourus de toutes les provinces de l'Empire. Les gens de [lettre arabe] Basra, ceux de [lettre arabe] Koûfa, ceux d'Égypte venaient réclamer à grands cris la destitution de leurs gouverneurs, tous proches parents du khalife, enivrés de l'éclat da leur parenté et ne conservant plus, dans leur orgueil et leur avidité, ni tact, ni mesure.
Le tumulte fut si persistant, les plaintes si légitimes qu’Alî consenti enfin à se faire le porte-parole des mécontents. Son discours à `Osmân nous a été conservé dans le livre intitulê Kamèl fî ‘t-târîkh par Ebn él-Asïr que nous appelons Ibn èl-Athîr (`olémâ sonnite) et dans le livre chi'ite intitulé Nahadj oul Bèlâqè,. (Les routes de l'éloquence.)
Voici comment `Alî parla à Osmân: «Ceux qui sont derrière moi m'ont prié d'être leur ambassadeur et m 'ont chargé de faire parvenir jusqu'à toi ce qu'ils avaient à te dire. Et, j'en prends Dieu à témoin je ne sais que dire, car je ne sais pas une chose que tu ne saches, je ne Puis t'indiquer rien que tu ne connaisses. Tu sais tout ce que je sais, et je n'ai rien appris de plus que toi pour que j'aie à t'instruire. Tu as vu ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu tu l'as entendu; tu as eu avec le Prophète les conversations que j'ai tenues avec lui. Ni le fils d'Abou Qohàfé (105) ni le fils de él-Khatthâb (106) n'étaient plus dignes que toi de l'oeuvre de Dieu, car ta parenté par les femme avec l'apôtre est plus proche que la leur : tu étais son gendre, eux ne l'étaient pas. Donc, ô Dieu, ô Dieu, garde toi toi-même. J'en jure par Allâh, il n'y a pas à te guérir d'une cécité qui n'existe pas, il n'y a pas à te sortir d'une ignorance qui n'a jamais été ton partage. La route est claire, les drapeaux de l'islam sont levés.
» Sache donc que l'esclave chéri de Dieu, c'est l'imâm juste, qui n'a jamais quitté la voie droite et qui dirige les hommes ; c'est celui qui maintient les lois reconnues et repousse les innovations. Or, les lois, les moeurs agréées par Dieu sont claires et définies par des signes certains; il en est de même pour les nouveautés dangereuses.
» Sache aussi que l'homme détesté de Dieu est l'imâm qui n'est plus qu'un tyran, qui s'égare dans sa route et égare ceux qui le suivent, qui laisse dans l'oubli les lois traditionnelles et laisse s'implanter des nouveautés qu'il devrait étouffer.
» J'ai entendu moi-même le Prophète qui disait : Au jour du jugement: Un imâm viendra qui sera un tyran; personne ne l'aidera, personne ne l'excusera auprès de Dieu; il sera jeté dans le feu de l'enfer et il y tournera longtemps comme une meule de moulin pour être enfin enchaîné au plus profond du lieu maudit.
«Je t'en conjure par Dieu, ne sois pas au milieu de nous celui qui doit être tué car il a été dit :
«Dans cette nation un imam sera tué, par l'intermédiaire de qui seront ouvertes les portes de la guerre et du meurtre. Et le sang coulera jusqu'au jour du jugement, et la vérité sera cachée, l'erreur se propagera, la discorde s'établira à demeure dans cette nation. Alors, ils ne distingueront plus le vrai du faux et seront submergés par les ténèbres et l'aveuglement accumulés comme les vagues de l'océan.»
Ayant rappelé ce hadîs, `Alî ajouta : Ne te soumets pas à tout ce que dit Mérvan èbn él-Hakém (107) et n'assume pas la responsabilité de ce qu'il fait ; prends garde, il se pourrait que, devenu vieux, tu n'aies plus la force de te soustraire à sa domination; alors il pourra te tromper et te conduire dans telle route que lui indiquera sa fantaisie.»
Rien n'y fit, ni prières, ni remontrances, ni menaces ;'Osmân (èbn Affân), le 3e Khalife, fit bien semblant d'accorder aux :Égyptiens ce qu'ils demandaient, mais nous allons voir comment il s'y prit.
Ce fut, en effet à ce moment que, sur les pressantes instances des envoyés d'Égypte et sur le conseil d"Ali, 'Osmân se décida à destituer 'Abd Oullâh, gouverneur des provinces du Nil, pour nommer à sa place
Mohammed (èbn Aboû Bèkr), homme renommé par sa loyauté et sa justice. Le nouveau gouverneur se mit en route avec les députés d'Égypte, accompagné d'un cavalier d"Osmân, porteur d'une lettre notifiant les nouvelles décisions. En cours de route, ce cavalier fut fouillé et l'on trouva cachée, au milieu des objets lui appartenant, une lettre de .l'écriture de Mèrvân et revêtue du sceau du khalife ordonnant à'Abd Oullâh de ne tenir aucun compte de sa destitution et de mettre à mort Moharnmed (èbn Aboû Bèkr) dès son arrivée.
Indignés d'une pareille perfidie, les Égyptiens revinrent sur leurs pas, dénonçant l'horreur d'un pareil attentat et voyant chaque jour un grand nombre de mécontents venir grossir leur troupe. Arrivés à Médine„
ils allèrent immédiatement assiéger la maison d"Osman. Le siège dura un mois, au bout duquel la maison fut forcée, ses défenseurs passés au fil de l'épée et `Osmân massacré (108).
Qu'un évènement pareil ait pu s'accomplir dans la capitale de l'islam, pleine encore des compagnons du Prophète, de musulmans de la :première heure, sans que personne, petit ou grand, songeât à s'y opposer, cela démontre d'une façon éloquente que tous étaient fatigués du règne trop long (109) d'un personnage trop partial qu'ils considéraient comme un tyran indigne de vivre. Car il se rencontra des gens pour déclarer licite le meurtre du 3e successeur du Prophète, et parmi eux Talhé, (ébn `Abd Oullâh) et `Amr (èbn 'Ass). `Âichèh elle-même, qui détestait `Osmân, préchait publiquement la nécessité de tuer le khalife.
Les haines furent déchaînées du jour où 'Abd èrRahman (èbn èl-Aouf) fut la cause directe de la nomination d"Osmàn. Les Bênî Hâchèm entrèrent en lutte avec les Béni Omeyyéh, dont tous les actes tendaient à ridiculiser ou tout au moins à abaisser les compagnons du Prophète, et particulièrement `Ali et ses partisans.
Quoique `Ali eût plusieurs fois rétabli la paix entre les partis, quoiqu'il se fût montré à tous égards digne d'éloges, ses adversaires ne manquèrent pas de l'accuser, d'exciter en sous-main les troubles qu'il feignait d'apaiser. Si ardent qu'il eût été à protéger `Osmân, à le conseiller durant le siège, à chercher à le sauver, puisqu'il envoya même (110) ses deux fils Hasan et Hoseïn garder en armes la maison du khalife, il va bientôt passer pour le véritable meurtrier de son gendre (111) dont les assassins vont exiger de lui le prix du sang.
On conçoit le trouble et la confusion qui durent régner en ville après un pareil événement. L’Islam se divise dès ce moment d'une façon définitive en deux partis qui vont se rejeter tour à tour les pires accusations; les divisions ultérieures souvent graves n'ont rien de définitif, celle-là seule est essentielle et le sang d'`Osmân pèsera éternellement dans la balance.
Les événements qui se succédèrent ne firent qu'envenimer la plaie toujours saignante, et la Perse prenant violemment parti pour 'Ali tombé à Koufa sous le poignard d'un assassin (143), creusera de plus en plus le fossé désormais infranchissable qui la sépare des sonnites.
`Alî (èbn Aboû Thâlèb) était enfin khalife, mais ce n'avait pas été sans de grandes difficultés qu'il put parvenir jusqu'au trône de Mohammed. Sa réputation d'inflexible justice troublait les coeurs de tous les grands fonctionnaires peu soucieux de voir examiner de près les actes de leurs gouvernements. Les grands personnages de l'Empire se croyaient lésés dans les droits qu'ils pouvaient avoir au trône du khalifat, et les Oméyyades ne voulurent point reconnaître le nouveau souverain. Malgré leur proche parenté avec les Hâchémites, ils avaient voué à ceux-ci une haine formidable; l'ambition, l'envie, le désir de l'autorité ravageaient leurs âmes ainsi que l'amour de la vengeance. En effet, Mo'âviya, possesseur de nombreux fiefs militaires, émir d'une puissante tribu, homme remarquable par sa grande expérience, la promptitude de son intelligence, sa pénétrante connaissance des ressorts secrets du gouvernement, chef indépendant depuis de longues années des provinces de Syrie et de Damas, maître d'une grande armée, d'une grande fortune et d'une grande influence ne pouvait pardonner à Ali ses hauts faits dans les batailles de Beder, d'Ohod, d'Alizab, où celui-ci .avait, de sa propre main, tué les plus grands d'entre les Ommeyades. Mais d'autre part, Ali était célèbre à tous les points de vue, aimé de beaucoup, et jouissait, lui aussi, d'une influence énorme. Il fallait un prétexte sérieux pour se révolter contre lui.
Aussi, tout d'abord Tal'hé et Zobéir quittèrent-ils Médine pour aller à la Meqqe où ils rejoignirent Aïchah. D'accord avec elle et quelques grands personnages Ommeyades, ils convinrent d'accuser Ali du meurtre d'Osman - dont il avait profité. Dès lors ils lui déclarèrent la guerre pour une cause sainte et juste, puisqu'ils la faisaient pour réclamer au meurtrier le prix du sang de sa victime.
C'est ainsi qu'on arriva à la fameuse bataille du «Chameau», qui se termina par la mort de Tal'hé et de Zobeïr et la victoire d'Ali.
Cela n'empêcha pas Mohaviah de reprendre le même prétexte avec plus de rage encore que ses complices. Il convainquit les grands de Damas de l'obligation où ils étaient de se joindre à lui pour combattre l'assassin et sortit de Damas avec - dit-on - 96.000 soldats.
Les deux armées se rencontrèrent sur les frontières de la Syrie et de l'Iraq, où elles restèrent durant cinq mois à s'observer mutuellement. Cette guerre déplaisait en effet à bien des chefs- peu soucieux de voir s'élever des guerres intestines alors que la guerre extérieure menaçait de tous côtés. Mais des accidents malheureux vinrent jeter la fureur dans les deux camps. Au cours d'escarmouches sans importance, des personnages considérables furent tués : du côté d'Ali, Ammar fils de Yacer et un Arabe orné du titre de ZouChéhadéteïn; du côté de Mohaviah, Obeid Oullah fils d'Omar et Cherh habil ibn Zélqéla.
Alors eut lieu la bataille de «Leilet el-Harir» où 37.000 personnes auraient trouvé la mort. Le nombre de ces cadavres remplit d'amertume l'âme des Musulmans. Une trêve de quatre mois fut conclue pendant laquelle Mohaviah sut si bien manoeuvrer qu'il tourna presque tous les esprits contre Ali.
Comme on le sait, Hassan, fils d'Ali, remit le khalifat à Mohaviah. Devenu maître du souverain pouvoir, celui-ci comprit fort bien qu'il ne pourrait se maintenir, lui et ses descendannts, qu'à la condition de ruiner le prestige des Alides. Aussi combla-t-il de faveurs tous les ennemis de cette famille et exclut-il de toutes les fonctions ses partisans. Non content de cela, il paya des gens pour faire circuler des «hadis» mensongers, attribuant à Àli à ses descendants des actes inconvenants, ce qui devait détourner des Alides les coeurs des Musulmans. Dès_lors ce fut une pluie de «traditions»: les partisans d'Ali en fabriquèrent à leur tour en faveur de leur chef et, dit l'historien musulman, «la porte de la discussion des hadis fut ouverte, qui ne devait jamais plus se refermer».
On sait que Mohaviah mourut en l'an 60 de l'Hégire, que Yézid, son fils, lui succéda, et que ses généraux vainquirent et tuèrent, - dans d'horribles conditions suivant les chiites - le malheureux imam Housseïn. Ce meurtre qui fit couler le sang même du prophète excita d'autant plus l'horreur que les Ommeyades firent à Damas une fête de l'arrivée de la famille prisonnière, qu'on promena à travers la ville la tête du martyr, qu'on interdit enfin d'ensevelir les infortunés Alides.
Yézid mort, son fils Mohaviah fut obligé d'abdiquer, et l'agitation recommença pour le choix d'un nouveau khalife.
Les habitants de la Meqqe et de Médine élirent Abdoullah fils de Zobeïr, et s'emparèrent de l'Arabie et de l'Iraq. Les habitants de Damas discutaient encore la question quand Moukhtar ibn Abi Obeid'h Çaqafi vint de la Meqqe en Iraq où il réunit autour de lui les partisans d'Ali. Ils nommèrent khalife Mohammed ibn Ali, connu sous le nom d'Ibn Hanéfiyèh. Ceci fait, ils engagèrent les hostilités, réclamant le prix du sang des martyrs. Ils s'emparèrent de Kouffa et des villes entre les deux fleuves, poussant leurs conquêtes jusqu'aux frontières de l'Azerbaïdjan. Moukhrtar fut tué six ans plus tard.
Les habitants de Damas avaient élu Mervan, fils d'Hakem, puis après sa mort, Abd oul Melek, son fils. Celui-ci défit successivement Méc'èb, fils de Zobéïr, puis Abdoullah également fils de Zobéir. C'est lui qui fixa définitivement le khalifat dans la famille des Ommeyades.
Nous ne continuerons pas plus loin notre étude. II serait certes du plus attachant intérêt de rechercher à travers les siècles le développement sans cesse croissant du parti d'Ali, le fanatisme par lequel il se signala, les oeuvres qu'il produisit, mais ce n'est pas ici le lieu de le faire, et nous ne pouvons que signaler les causes de ce grave dissentiment. Le peu que nous en avons dit suffira sans doute à donner une idée de la violence des passions que la lutte développa, et si ces assassinats successifs prouvent d'une façon éloquente et sans qu'il soit besoin d'y insister combien profonde fut la scission, les constatations auxquelles nous nous livrerons par la suite démontreront d'une façon tout aussi formelle combien elle s'est accentuée et combien les haines et les rancunes sont vivaces aujourd'hui.
La Perse prit fait et cause pour Ali pour des raisons multiples: les unes historiques, les autres religieuses, d'autres encore politiques. Il faudrait se reporter au temps de la conquête par les Arabes pour se rendre compte de l'antinomie qui" existait entre le peuple vaincu et les vainqueurs.
En effet, les symptômes de décadence se manifestaient déjà dans l'Empire perse dès la mort de Khosroës le Grand. Trois siècles de guerres presque ininterrompues avaient brisé le ressort de l'énergie nationale pendant que le magisme perdait de sa rigueur au point qu'on pût voir s'asseoir sur le trône des Perses des princesses chrétienné. Si les vieilles traditions subsistaient toujours, l'ancien enthousiasme avait fait place au calme, auquel succéda bientôt l'indifférence. Le pays était mûr pour la conquête, il allait appartenir à qui voudrait le prendre : ce furent les Arabes, peuples grossiers, sans art, sans civilisation, qui parurent.
Yezdèdzerd III régnait alors sur ce pays livré aux horreurs de l'anarchie. Faible, indécis, il lui manquait tout ce qu'il fallait pour lutter contre le formidable adversaire qui se présentait. Aussi, désireux de mourir paisiblement sur son trône ébranlé, entra-t-il en pourparlers avec les généraux musulmans. Ses demandes, ses concessions, ses prières furent dédaigneusement repoussées, et il lui fallut bientôt se convaincre qu'il devrait se défendre les armes à la main. Il était vaincu d'avance, et sa répugnance à engager les hostilités contre un agresseur du sol de l'Empire était un sûr garant de sa défaite future. Son armée fut battue dans les plaines de Qaddéciyèh, et le prince abandonnant toutes les provinces du Sud au vainqueur vint se réfugier à Rei où fut autrefois Raghés et où s'élève aujourd'hui Téhéran. Il y resta cinq ans, considérant d'un oeil morne les progrès quotidiens de l'ennemi. Mais enfin la Perse fut prise d'un frémissement suprême : dans un élan sublime elle se leva tout entière pour chasser l'étranger, ces Arabes pour lesquels elle avait le plus profond mépris et qu'elle appelait déjà des «mangeurs de lézards».
Le prince se montra à la hauteur de sa tâche, et ce fut une lutte de géants que cette bataille de Néhavend: mais le fanatisme des nouveaux Musulmans l'emporta sur l'ardeur des défenseurs de la Perse, et Yezdédjerd fuyant, abandonné ou trahi par les siens, fut enfin assassiné dans le moulin d'un meunier. Sa fille, faite prisonnière, devint la femme d'Houssein, fils d'A1i. Cette union fut l'anneau qui relia la Perse au culte des imams.
Vaincue, la Perse ne fut pas conquise : toute l'énergie nationale réagit contre la religion, contre les moeurs et même contre la langue des envahisseurs : elle réagit .avec tant de force et aussi avec tant de persistance qu'elle finit par triompher et par vaincre ses vainqueurs.
Ceux-ci, en effet, soldats vigoureux et enthousiastes, guerriers sobres et infatigables, étaient incapables, de gouverner, ils ignoraient tout de l'administration, et les règles prescrites par Mohammed pour le gouvernement de quelques tribus, jusque-là ignorantes et sauvages, ne pouvaient plus être de mise pour régir un grand pays arrivé à un degré relatif de civilisation. Outré qu'ils se laissèrent griser par les délices du repos après la conquête et qu'ils commencèrent à modifier leurs moeurs rudes et incultes, ils furent bien .obligés de s'adresser, pour l'administration, à ceux qu'ils y trouvèrent employés. Or, si les habitants des villes avaient accepté assez facilement - en apparence - l'islamisme, ils n'avaient du moins pu faire table-rase de leurs anciennes acquisitions dans le domaine moral et philosophique : aussi dés le début leur conversion fut-elle toute de surface : ils forcèrent les nouveaux dogmes et les nouvelles habitudes à cadrer plus ou moins harmonieusement avec ce qu'ils conservaient de leur éducation première. La classe agricole fut moins soumise : elle était plus attachée au culte de ses aïeux, vivait d'ailleurs demi-indépendante d'ans les districts montagneux : elle formait une opposition tacite, mais tenace. Le Mazandéran, par exemple, ne fut conquis à l'islam qu'au bout de trois siècles.
Or, ceux qui détenaient l'administration du pays étaient les Mobeds, c'est-à-dire le clergé mage. Instruits et policés, ils devaient garder au coeur une implacable rancune contre les barbares sanguinaires qui étaient venus les jeter hors de leurs temples et de leurs privilèges. Mais patients et rusés, ils comprirent tout le parti qu'ils pouvaient tirer de la situation pour redevenir une caste riche et puissante. Ils entrèrent lentement, mais avec une ténacité inouïe, en lutte avec la religion dont ils durent se reconnaître les sectateurs. Si d'un côté le terrain était favorable, puisqu'ils s'adressaient à leurs compatriotes, de l'autre la tâche était difficile, car l'islam ne comporte pas de clergé : aussi fut-ce pour eux un triomphe définitif que d'en constituer un.
Le Qoran écrit dans une langue inconnue à l'immense majorité des Perses, était cependant la pierre angulaire de l'édifice musulman. Il fallait bien le faire connaître, si l'on voulait convertir réellement la nation : mais d'autre part, il fallait se défier de ceux qui ne connaissant qu'imparfaitement l'arabe pouvaient errer dans leurs lectures. Ils posèrent donc en principe que lire le Livre de Dieu sans la participation d'un homme qui en devait faire son métier était une faute grave, un péché mortel. Il fallut dès lors des gens spéciaux, nourris dans cette étude, qui fussent chargés de cette lecture. C’est là. la première hérésie, l'une des plus graves, aux yeux des sunnis.
Cette première victoire en comportait une seconde: l'interprétation du texte sacré. Celle-ci, dès lors, mettait pour toujours la conscience persane entre leurs mains : ils la pouvaient désormais diriger au gré de leurs désirs, au mieux de leurs intérêts. Il fut interdit de traduire le Qoran en persan : il resta. ignoré de la masse du peuple qui devint ainsi «la chose» du clergé.
Cependant les événements marchaient à pas de géant: Ali, devenu enfin khalife, mourait assassiné, Housseïn tombait dans les plaines de Kerbélah, la dissension était partout, les partis se heurtaient avec fracas. Nous avons essayé de faire comprendre la violente répulsion qu'inspiraient les Arabes aux Persans: ceux-ci fatalement devaient entrer avec enthousiasme dans l'opposition, et l'opposition à ce moment était le parti des Alides. De plus les enfants de Houssein, fils d'Ali, étaient les descendants de la vieille dynastie persane : les adopter, c'était réagir encore, c'était protester contre l'invasion et la conquête. Enfin Ali de son vivant même commença à être considéré comme autre chose qu'un simple successeur du prophète. Déjà on le vénérait à l'égal de Mohammed, déjà certains le mettaient au-dessus de son cousin. Nous examinerons cette question dans le chapitre suivant : et nous verrons que c'est sur elle que se base tout le chïisme. Mais ce sentiment de réaction ne fit que s'accroître par la suite, soigneusement entretenu par les gouverneurs, par les princes, par les rois de la Perse désireux de maintenir leur indépendance fatalement compromise si leurs sujets eussent cru devoir obéissance aux khalifes qui se succédèrent par la suite.
Ce ne fut cependant que pendant les IIe, IIIe et IVe siècles de l'Hégire qu'apparurent les diverses sectes par lesquelles l'islam fut divisé en une infinité de petites branches. Au premier siècle, les règles de la dialectique et de la philosophie n'étaient pas encore en usage, on ne prononçait pas encore les mots de Chiites, non plus que celui de Sunnites. Ceux qui considéraient Ali et ses descendants comme les seuls légitimes successeurs du prophète, se nommaient les «amis des gens de la maison», (112) ceux qui admettaient le vote pour désigner le khalife étaient «les amis des deux chéikhs», ceux qui n'admettaient pas de successeurs à Mohammed étaient les «kharedjites».
Aux IIe et IIIe siècles, les livres se multiplièrent: on se lança dans les études dogmatiques, la philosophie fit sentir son influence et l'argumentation commença violente dès le début. Les écrivains, pour faciliter l'expression de leurs pensées, pour désigner d'un seul mot les différences qui les séparaient de leurs adversaires, fixèrent des noms sous lesquels ils se classèrent. Ils s'appelèrent, en tant qu'ils étaient amis des deux chéikhs et partisans du vote, «les gens de la sounna (tradition), les gens de la Djema'at; et, par mépris désignèrent le «amis des, gens de la maison» sous le titre de Revafez.
Par opposition aux sunnis, leurs adversaires les appelèrent Navaceb, pendant qu'ils se donnaient à eux-mêmes le titre de Chiè Ehl Beit. Ceux-ci se divisèrent en plusieurs branches : la plus répandue en Perse se nomme elle-même Chiié ésna 'acheri, c'est-à-dire «les artisans des 12».
Voyons quels sont ces douze, et nous examinerons ensuite quelles sont les diverses sectes qui se sont élevées parmi les chiites, de façon à donner au lecteur tous les éléments d'appréciation dont il a besoin. J'emprunte ce récit au Zinet-el-Medjalis, et je ne reviens pas pour le moment sur la personnalité d'Ali, qui est le premier de ces douze.
Quand celui-ci mourut, les Mohadjers, les Ansars élirent Haçan, son fils, au trône du khalifat. Cette élection eut lieu le 18 Ramazan de l'an 40.
Haçan, de caractère doux et paisible, désireux d'apaiser les querelles et d'effacer la désunion qui régnait parmi les Musulmans, se retira bientôt et remit le pouvoir à Mohaviah. Il mourut à Médine, en l'année 44, empoisonné par sa femme Djooudé, fille d'Ibn Keïs, excitée à ce crime par Mohaviah et Mervan.
On raconte que lorsqu'il se retira à Médine, après son abdication, plusieurs de ses adhérents vinrent le trouver. «Salut à toi, dit l'un d'eux, salut à toi qui as noirci le visage des croyants. Pourquoi as-tu abandonné le khalifat à cet infâme Mohaviah ?»
«Mohammed, dit Haçan, savait que les Ommeyades monteraient l'un après l'autre sur son minber. C'est pourquoi il s'attrista et que Dieu lui fit descendre les sourates du Qooucer et d'El-Kadr, afin de le consoler».
Il laissa, dit-on, une quinzaine d'enfants.
Le 3° imam est Housseïn ibn Ali Mourteza. Il naquit le 4 ou 5 chahaban de l'an 4 de l'Hégire. Il avait 6 ans ,et quelques mois quand Mohammed mourut : au moment du meurtre de son père, il en avait 36. Il fut tué le vendredi ou le samedi, 10° jour de moharrem de l'an 91, à Kerbélah, on sait dans quelles circonstances.
Il avait 6 enfants, et parmi eux Ali Asker, dont la mère était Bibi Cheherabanou : il était donc par son père héritier du trône du khalifat, par sa mère héritier de l'Empire de Perse.
Ali Asker fut le 4e imam. Il naquit en chaaban 38 à Médine, et avait 2 ans à la mort d'Ali. Il mourut en l'an 95 et fut enterré à côté d'Hassan. Amdoullah Moustofi dit que d'après les oulémas chiites, il fut empoisonné par Valid ibn Abdoul-Melek. Dans le Kechf-oul-Qoummèh, il est dit que Taous Yéméni, un ermite du Yémen, raconte : Une année, j'allais en pèlerinage. Quand j'arrivai entre Sefa et Merva, je montai en allant sur un seul pied jusqu'au haut du mont Séfa. J'y vis un jeune homme d'une beauté magnifique, mais faible et maigre et couvert d'un vieux vêtement. Il regarda la Kaaba, alors il éleva les mains vers le ciel et dit : «Je suis nu, tu le vois, ô mon Dieu, je suis à jeun, comme tu le sais! Que vois-tu en moi, ô toi qui vois tout sans être vu (1)»
Je me mis à trembler en entendant ces paroles et surtout quand je vis descendre du ciel deux plateaux, dont l'un contenait de magnifiques étoffes du Yémen et l'autre des bonbons délicieux, comme ceux du Khorassan.
Le jeune homme se tourna vers moi et me dit, quoiqu'il ne me connût pas : «O Taous»-»Oui, répondis-je»-»Veux-tu quelque chose de ces plateaux?» Je répondis que je ne voulais pas des étoffes, mais que j'accepterais quelque chose de l'autre plateau. Alors il me donna deux poignées de bonbons, et je les enfermai dans un coin de mon «ihram». Des deux pièces d'étoffes il se fit un «réda» et un «aba», puis il s'en alla. En route, il rencontra un homme, à qui il donna le vieux vêtement qu'il avait quitté. Je courus après ce dernier et lui demandai quel était le personnage que je venais de voir : «Tu ne le connais pas? me dit-il, c'est le descendant du prophète, Ali, fils d'Houssein.»
Son fils fut le cinquième imam : il se nommait Mohammed ibn Ali ibn Housseïn. Il mourut en l'année 124, empoisonné par Echam, fils d'Abdoul Malek.
Son fils, le sixième imam, fut Djaafer ibn Mohammed, qui naquit le lundi 17 rebi el-ewel de l'année 80, .d'autres disent 83. Il est célèbre sous le titre de Sadeq. Il mourut le lundi 15 redjeb de l'an 148, empoisonné par Abou Djaafer Mensouri Dévanèghi.
Ce fut son fils qui lui succéda en qualité de 7° imam. Il se nommait Mouça, naquit en 128 ou 129, entre la Meqqe et Médine, et reçut le titre de Kazem. Suivant les meilleurs historiens, il fut empoisonné à Baghdad en redjeb 183, sur l'ordre d'Haroun er-Rachid et conformément au fetva de Yahyah ibn Khaled Barmeki : d'autres disent qu'on lui versa du plomb fondu dans la bouche.
Ali er Riza, son fils, naquit soit le 11 zil hedje, soit le 11 rebi el-akher de l'année 153, à Médine. C'est le plus célèbre des imams : il mourut à Senabad de Tous, empoisonné par Mahmoun Abbaci et fut enterré à Mechhed : son tombeau est un célèbre lieu de pèlerinage.
Khadjeh Aboul Cassem Djaaferi dit : Ibrahim ibn imam Mouça Kazem raconte : Un jour je demandai de l'argent à imam Riza. Il me promit de m'en donner. Il alla ce jour-là au devant du gouverneur de Médine : je l'accompagnais. Au milieu de la route, nous descendîmes de nos montures pour nous reposer à l'ombre d'un arbre. Pour lui rappeler sa promesse, je lui dis: «C'est une grande fête aujourd'hui, et je n'ai pas un dinar.» Alors il frappa la terre de son fouet : un vase plein de pièces d'or apparut. «Prends, me dit-il, et tais-toi.»
Le 9ème imam fut son fils Mohammad, surnommé Taghi, né le 17 Ramazan 195. Les Oulémas chîites disent qu'il a été empoisonné par Moh'tacem Billah.
Ali, son fils, lui succéda en qualité de 10ème imam. Il serait né en 222 ou 224: son titre le plus connu est celui de Taghi. Le khalife Mo'tazed ibn Moutavéqqîl le fit empoisonner en djemadi oul-akher ou redjeb de l'an 254.
Haçan Askeri, son fils, fut le 11e imam. Il naquit à Médine en 231. Il mourut empoisonné lui aussi en rebi oul-akher de l'an 260, au temps de Meu'temed l'Abbasside.
Nous nous occuperons du 12e imam dans le chapitre suivant.
J'ai fort abrégé ces données que j'ai extraites du Zinnet el-Medjalis : je tiens à faire remarquer le peu de précision qui règne dans les dates : il y a discussion pour la naissance et pour la mort de chacun d'eux : on n'est pas d'accord sur les noms de leurs mères, non plus que sur le nombre des enfants qu'ils laissèrent. Quant à l'histoire même de leurs vies, c'est un tissu de miracles, de prodiges, d'enchantements. La légende y a la plus large part : rien n'est précis.
Tous, comme on a pu le voir, meurent de mort violente, la plupart empoisonnés en vertu du hadis de Mohammed: Ma minna ella masmounoun aou Maktoul.
Nous verrons par la suite, sans nous en étonner, accoutumés que nous serons à leurs inconséquences, les oulémas chiites déclarer que le Bab ne peut être l'imam Mehdi par la raison bien simple qu'au lieu de conquérir le monde il dut subir la prison et la mort. Et les babis ne manqueront pas, au contraire, d'en tirer un argument en leur faveur en observant qu'une fois encore la parole prophétique de Mohammed s'est réalisée.
Enfin, et ceci est digne d'intérêt: l'avant-dernier imam meurt en 260, et le dernier disparaît avant même d'avoir joué un rôle sur cette terre. La porte de la science est donc fermée à cette date, et il faudra l'espace d'un jour à Dieu pour la rouvrir. Or, comme il a soin de nous prévenir dans le Qoran qu'un jour pour lui est mille ans de notre comput, il faudra que l'ouverture des portes sacrées se produise en l'an 1260. C'est exactement ce qui a eu lieu.
Nous reviendrons avec plus de détails, plus tard. Sur cette question et nous allons examiner dans le chapitre suivant quel est le rôle joué par Ali et ses descendants, d'après les chiites : nous verrons alors les différences s'accentuer entre les Persans et les Sunnis, et nous constaterons facilement l'impossibilité absolue qu'il y a à un rapprochement quelconque entre les deux sectes rivales.
=====================================
II. LES HADIS - ALI ASSOCIÉ DANS LA MANIFESTATION PROPHÉTIQUE DE MOHANMED AUQUEL IL SUCCÈDE COMME IMAM.
A côté du Qoran, avons-nous dit, aussi haut placé que lui dans la vénération des fidèles, se trouve le recueil des hadis.
Les «hadis» sont pour les sunnis les «gesta Mohammedi», je veux dire les paroles prononcées par
Mohammed au cours de son existence : les décisions qu'il donna, les jugements qu'il rendit. Les chîites y ajoutent les paroles, les décisions, les jugements, les prédictions d'Ali et de ses descendants.
Pour les premiers, seuls, les hadis de Mohammed sont un article de foi, pour les seconds, les hadis de
Mohammed et ceux des imams ont la même valeur ou à peu près.
Et nous entrons ici dans lé vif de la question. Seule, une idée précise de l'importance de cette «production littéraire divine» peut nous guider à travers les dédales de l'islam chiite et nous démontrer qu'il existe en réalité deux religions absolument différentes et irréconciliables : l'une qui a le Qoran pour base et les traditions du prophète, l'autre qui néglige le livre de Dieu et qui s'appuie presque tout entière sur les hadis du prophète et ceux de sa famille, ce qui veut dire de la famille issue de sa fille Fatemêh, mariée à son cousin Ali.
Mais avant tout, puisqu'il en est ainsi, puisque la moindre parole prononcée par une personnalité comme celle de Mohammed est une parole divine, une première constatation s'impose, c'est que Mohammed est prophète non seulement quand il professe ex cathedra, je veux dire quand Dieu parle par sa bouche et fait, versets par versets, descendre du ciel le Qoran, livre antérieur à toute création, puisqu'il est la Science même de la Divinité: mais encore il est prophète dans les moindres actes de son existence, il est prophète à table, à cheval, dans son lit, à la mosquée. C'est bien là,, quoi qu'on en dise, une incarnation divine, et c'est chose étrange de voir combien les Musulmans reculent devant cette conclusion cependant inéluctable. Ils ont pour s'appuyer cette parole même d'Allah dans le Qoran : «Dis-leur: Eh! suis-je donc autre chose qu'un homme comme vous», ce qui n'empêche qu'ils considéreront comme un blasphème, surtout dans la bouche d'un chrétien, l'affirmation que Mohammed était un simple animal humain, voué de par son origine même aux souffrances, aux douleurs, aux vicissitudes, aux défaillances de l'humanité. Comme l'Église catholique l'a fait pour le Christ, l'Église chîite sera contrainte, tout en la niant, d'affirmer la divinité de l'apôtre arabe.
Je puis ici rencontrer des contradicteurs qui, se contentant des apparences, croiront devoir rejeter la conclusion à laquelle je suis arrivé après de nombreuses discussions poussées jusques aux plus extrêmes limites, mais cependant que pourront-ils répondre quand j'aurai expliqué que le chiisme a produit les divagations les plus étranges au sujet de la nature même du corps de Mohammed? Je laisserai de côté le fameux vers :
O Prophète, qu'y a-t-il donc eu pour que de ton corps terrestre émanassent les parfums les plus enivrants?
me bornant à rappeler les élucubrations auxquelles ont donné lieu les commentaires sur l'ascension de Mohammed au ciel, ascension connue sous le nom de Mihradj.
Naturellement on a beaucoup discuté autour de cette question et les bases de cette discussion sont assez curieuses pour intéresser le lecteur européen.
La terre, centre de l'univers, est environnée de neuf cieux qui l'entourent de toutes parts. La comparaison la plus universellement admise est celle de l'oignon. Les cieux en effet enveloppent la terre comme les pelures successives, enveloppent le germe de cette plante. Ces cieux sont denses, dit la science officielle, denses comme le cristal par exemple. Ils ne peuvent être, ni compressés, ni dilatés. Ils tournent les uns sur les autres, soit dans le même sens, soit dans un sens contraire, en vertu de lois que nous n'avons pas à expliquer ici.
Incompressibles et ne pouvant être dilatés, puisqu'ils sont denses au maximum de leur densité et qu'ils sont emboîtés exactement les uns dans les autres, il est bien évident qu'ils sont impénétrables et refusent tout passage à un corps matériel, si ténu fût-il. Dès lors, comment Mohammed a-t-il pu les traverser : en rêve, disent les blasphémateurs, en un état d'extase disent certains mystiques, ce qui revient à peu près à ce que disent les premiers : il s'y est transporté en esprit, répondront de pieux Musulmans qui croulent immédiatement sous l'anathème du clergé officiel, car, d'après lui, Mohammed est monté, avec son corps, jusqu'au trône de Dieu, avec ces pantoufles mêmes qu'il voulut quitter quand il arriva au seuil de Dieu; mais une voix l'en empêcha, lui disant qu'elles honoraient le paradis ; il était dans la plus grande partie de son voyage à cheval sur le dos du fameux Boraq, et marchait accompagné de l'archange Gabriel, qui arrivé à un certain point dut le laisser continuer seul son voyage :
O toi, porteur des révélations divines, lui dit alors le chef de la Meqqe, vole donc plus haut.
Puisque tu as trouvé en moi un ami sincère, pour quoi maintenant m'abandonnes-tu? «- «Il ne m'est pas permis, répondit l'Archange, d'aller plus avant, si je suis resté en arrière, c'est que mes ailes n'ont plus la force de me porter. Si, du reste, je volais plus haut, ne fût-ce que de l'épaisseur d'un cheveu, l'éclat de la splendeur divine viendrait brûler mes ailes.»
(Sa`adi, Bostan)
Qu'on n'aille pas crier à l'invraisemblance, qu'on ne prétende pas qu'il s'agit ici d'imagination de poète, car Mohammed l'a dit lui-même : «Il est pour moi, avec Dieu, un moment d'où Gabriel lui-même est exclu» (Hadis).
Nous ne sommes pas fixés sur la matière dont étaient composées les ailes de Gabriel, mais nous savons d'une part qu'elles étaient capables de planer dans le cristal et d'un autre côté qu'elles ne pouvaient plus - sous peine d'être brûlées - porter l'archange au-delà d'un certain point que l'Apôtre dépassa. La conclusion est facile à tirer et ne sera pas d'ailleurs pour épouvanter, - tout au contraire, - bien de vieux Persans de ma connaissance.
Donc, comme on le voit, Mohammed est surhumain, de quelque côté qu'on l'envisage et c'est là, je pense, une interprétation qui ne s'appuie sur aucun verset. Que les hadis lui viennent en aide, c'est autre chose, et c'est précisément là que j'en voulais venir. Il est désormais hors de doute que le Qoran ne nous suffira plus pour pénétrer la pensée chiite.
Or; ces hadis sont plus nombreux que les sables de la mer: ils ont été recueillis par un Persan, Medjlici, qui les assembla en un recueil qu'il intitula le Béhar oul Envar.
Je n'insisterai pas sur la façon dont cet ouvrage a été composé; je suis au surplus loin de faire ici le procès de l'Islam : mon but n'est autre que de montrer comment les incertitudes, les doutes, les inquiétudes des Persans ont pris pour ainsi dire une forme concrète en la personne de Seyyèd Ali Mohammed, dont la mission consistait, précisément à rassurer les consciences et à leur donner une règle définitive. Il me suffira de rappeler que la critique historique est née d'hier en Europe, qu'elle n'existe pas encore en Orient, et qu'elle a modifié nos opinions sur bien des personnages et bien des événements.
Quoi qu'il en soit, Medjlici est actuellement 1a pierre angulaire de l'édifice chiite. Son nom fait autorité, et il suffit qu’un hadis ait eté recueilli par lui pour qu'il soit admis comme indiscutable.
Or, admettre comme «révélations divines» les paroles d'un personnage, c'est évidemment reconnaître à ce personnage un rôle divin. C'est ce que n'ont pas manqué de faire les Persans.
Je regrette vraiment d'être obligé de donner à ma pensée une forme précise et nette alors que la pensée persane est essentiellement fugitive et vague ; mais j'y suis bien contraint, si je veux être bref et compréhensible.
Eh bien, il me semble que pour les Chiites la mission prophétique qui se manifesta en l'an 623 de notre ère ne fut pas réduite à un seul personnage. Il y a là une idée, non formulée, je le répète, mais qu'on peut constater facilement et saisir sur le vif, idée dont l'origine se perd dans la nuit des temps et qui se précisera sous forme de dogme dans le Beyan du Bab.
Le prophète se divisa en plusieurs personnages, la mission, si l'on veut, fut donnée non à un homme, mais à un groupe d'hommes, les travaux furent partagés entre les membres d'une commission.
Mohammed parut le premier presque immédiatement, suivi par Ali, et encore faut-il dire «suivi» ou bien: «accompagné»? «Je suis la ville et la science : Ali en est la porte.» Si l'on veut entrer dans la ville, il faut. bien passer par la porte: si la ville veut rayonner sur la campagne, la porte est nécessaire. L'une ne va pas sans l'autre, elles existent en même temps dans une étroite union. Si la ville (Mohammed) n'avait pas eu de porte (Ali), elle n'aurait pas été connue. Si je ne me trompe, nous trouvons bien ici les deux personnages de l'unité prophétique - pour parler comme les babis.
Comme il faut que l'Orient exagère toujours et ne manque pas d'aller jusqu'aux extrêmes conséquences d’un principe qu'il a .posé, on ne s’étonnera pas de voir des exaltés - 1es.Àli Oullahis - considérer Ali comme Dieu, et d'autres moins logiques, admettre que Gabriel trompé par une ressemblance frappante entre les deux cousins, ait porté à Mohammed les révélations qu'il devait faire parvenir à Ali.
Ces sectes existent encore de nos jours, sont parfaitement organisées, ont encore leurs prêtres et leurs traditions et possèdent, dit-on, des livres fort anciens, qu'elles cachent jalousement aux profanes. Les domestiques de la légation de France à Téhéran sont, pour la plupart, des Ali Oullahis : je regrette de n'avoir pas eu le temps de me rendre à l'invitation qui m'avait été faite d’assister à leurs mystères où le feu joue un grand rôle, leur grand-prêtre jonglant, -dit-on, avec lui et s'asseyant sur des charbons ardents.
Un autre hadis nous indique qu'Ali est le point du B de Bismillah, qui est Bismillah er-Rahman er-Raiim. Cette invocation, essentiellement musulmane, composée de 19 lettres, jouit de toute sorte de puissances et de prérogatives, on l'a retournée sur toutes ses formes, on l'a décomposée de mille et mille façons, on a additionné, multiplié, divisé les valeurs numérales de ses lettres, on s'est livré aux plus hautes spéculations métaphysiques, et les résultats auxquels on est arrivé sont prodigieux - au dire des sectaires. Or, cette formule qui servira à démontrer la fameuse unité de 19 personnes des babis commence par un B ; sans ce B, elle n'existe pas, il en est l'origine, la cause première efficiente et réelle : elle ne peut se passer de lui, alors qu'il peut se passer d'elle, il est le germe sans lequel elle ne peut se développer, sans lequel elle ne peut être. Quand vous la voulez prononcer, c'est lui qui se présente tout d'abord sous les lèvres, si vous la voulez, écrire c'est lui que vous trouverez tout d'abord. Or, qu'est-ce que ce B? c'est essentiellement un point. Ce point est bien suspendu sous un support perpendiculaire à la ligne d'écriture, mais ce support n'a aucune valeur en lui-même, puisque suivant les points dont on l'ornera il deviendra un t, un c, un p, un n. ou un y. Ce qui différencient les lettres entre elles, ce qui par conséquent les constitue c'est le ou les points. Donc le B est essentiellement un point placé sous la ligne d'écriture : ce que nous venons de dire pour lui s'applique donc au point : sans le point la formule islamique n'existe pas, ce qui revient par conséquent à dire que sans Ali il n'y a pas d'islam.
On conçoit la portée et les conséquences du système, et l'on voit que nous sommes loin de la formule classique d'après laquelle la différence qui existe entre les sunnis et les chiites se borne à la protestation de ces derniers contre l'usurpation des trois premiers khalifes.
Nous pouvons continuer brièvement notre étude sur le Bismillah : elle nous donnera la clef de la pensée chiite.
Si le point est l'origine de la formule, si sans lui elle n'eut pas pris naissance, elle n'eut pas été parfaite sans l'adjonction des autres lettres qui la composent. Dans le mot Bism de la formule divine et magique, le B, ou plutôt le point, appelle le Sin. Cette S s'appuie sur ce point, elle n'est rien sans lui, elle est toute avec lui. Est-il inférieur à ce point ? D'une façon inappréciable, car enfin s'il est vrai que sans luï il n’eût pas existé il est tout aussi exact de dire que sans cette s le point n'eût pas produit l'effet qu'on attendait de lui : ce point est donc le générateur de la formule en général, de l's en particulier: en effet Ali est le père d'Haçan et Haçan est l's de Bismillah, et les 12 imams sont les descendants d'Ali.
Que si l'on m'objecte que ces 12 imams représentent seulement 12 lettres d'une formule qui en contient 19, je serai obligé de reconnaître que je ne suis pas assez bon théologien musulman pour avoir bien compris les explications embrouillées qui m'ont été fournies pour dévoiler ce mystère. Cependant, il me suffira de remarquer que le reste est le fameux chiffre 7 qui joue un si grand rôle dans l'histoire des religions, et d'autre part j'espère, dans le second volume de cet ouvrage donner à ce sujet toutes les explications désirables, mais au point de vue babi. Nous verrons en effet le Bab dévoiler ce secret tant en ce qui concerne l'islam - suivant lui - qu'en ce qui concerne la religion même qu'il a fondée.Qu'il nous suffise d'insister ici sur ce point essentiel que c'est de la formule Bism Allah er-Rahman er Rahim, que Seyyed Ali Mohammed a tiré le chiffre 19.
Enfin, la formule confessionnelle de l'Islam persan est la suivante : «Je confesse qu'il n'y a pas d'autre ; dieu que Dieu, que Mohammed est son prophète et qu'Ali est son véli.» Il n'y a pas ici d'accommodement avec le ciel : est musulman quiconque prononce les trois termes de la formule, ne l'est pas quiconque en néglige un quelconque. Aussi les sunnites ne sont-ils pas musulmans, et tout Persan doit les exécrer plus encore qu'il n'exècre les Européens.
Mais de ce fait que le nom d'Ali a été introduit dans la formule confessionnelle, il ressort nettement que la lutte entre les deux sectes rivales n'est pas uniquement circonscrite dans une contestation sans but sur la légitimité des successeurs au pouvoir temporel de Mohammed. On conçoit qu'Ali est désormais plus qu'un homme, plus que le cousin, plus que le gendre du prophète, il est associé à la manifestation divine, et il l'est en qualité de véli.
Qu'est exactement un «véli», que signifie ce rang le «vélayet»? Il ne faut pas ici espérer une réponse définitive et précise; nous sommes au milieu des Persans, et leur intelligence est trop déliée pour n'avoir pas creusé le problème sous toutes ses faces. Aussi en fin de compte arrivons-nous à ces solutions, faciles à concevoir pour qui connaît le caractère de ce peuple : Mohammed est nébi et véli en même temps, disent les Mollas, Ali n'est que véli; et le «noubouwet» est au-dessus du «vélayet» ; point, répondent les soufis, Mohammed n'est que nébi, et par suite bien au-dessous d'Ali qui, lui, est le Véli ; ce n'est pas encore cela, interrompent certains autres soufis, tous deux sont nébis, tous deux son vélis. La qualité de véli est au-dessus de celle de nébi, or, Mohammed est «nébi» avant d'être «véli», et Ali est «véli» avant d'être «nébi». D'autres interviendront encore, changeront les termes du problème mais la solution restera presque toujours la même, je veux dire : la supériorité du «vélayet» sur le «noubouwet».
J'ai donné ci-dessus l'avis officiel du clergé orthodoxe, ce qui ne veut pas dire que ce soit l'avis de la majorité des Persans. On sait le nombre infini de sectes qui divisent les Esna 'Achéri, et l'on peut calculer qu'un cinquième de la population est hostile à cette thèse: si nous ajoutons que les babis, eux aussi, ont opté pour la supériorité du vélayet, nous serons obligés de reconnaître que les défenseurs de Mohammed sont en bien petit nombre. Nous savons désormais ce qu'est officiellement un véli, un imam. C'est au point de vue orthodoxe, un personnage qui accompagne l'individu chargé d'une mission prophétique : il le commente, l'éclaire, le développe: il est la porte par laquelle on arrive à sa connaissance. Élu par Dieu pour remplir ce rôle, il participe en quelque chose à sa divinité : il en est tout au moins le véli, c'est-à-dire l'ami et bientôt le lieutenant. Le noubouwet est la part du prophète, le vélayet celle de l'imam, mais nous voyons que ces deux entités se peuvent confondre et Mohammed est à la fois le nébi et le véli.
Dès maintenant, cela prend une autre figure à nos yeux: Ali n'est pas seulement l'héritier des biens temporels, du prophète, le successeur légitime de son trône, il est avant tout son associé dans la révélation, le dépositaire de ses secrets et de ceux de Dieu. Abou Bekr, Omar, Osman ne sont plus de simples usurpateurs, ce sont des blasphémateurs, des sacrilèges et des parjures ; méconnaissant le vélayet d'Ali, ils se sont, par la violence ou la ruse opposés à l’oeuvre de Dieu, et c'est surtout pour cela qu'ils sont dignes de l'enfer; ayant juré obéissance à.l'islam, ils l'ont renié et bafoué, et sont ainsi demeurés relapses, apostats et menteurs.
Mais, chose curieuse, l'exécration publique s'est reportée sur Abou Bekr et particulièrement sur Omar, en laissant presque tout à fait dans l'ombre, le khalife Osman, dont le vulgaire s'occupe fort peu. Omar joue dans la doctrine chîite le rôle rempli par Judas dans les consciences des premiers catholiques : la haine qu'on lui porte est même supérieure à celle que doit nourrir tout chrétien contre celui qui a vendu le Christ. Le vrai chîite, quand quelque chose le contrarie, quand il fait un faux pas ou gratte une allumette sans pouvoir l'allumer, ne manquera pas de s'écrier: «Malédiction sur Omar!» Ainsi qu'on le fait à Chypre et un peu dans tout le Levant pour Iscariote, les Persans fêtent «la fête d'Omar.» Elle consiste à fabriquer un mannequin destiné à représenter ce khalife ; on le promène à travers les rues de la ville au milieu des injures, des cris, des malédictions de la populace ; on le couvre d'ordures, on le frappe, on crache dessus et la fête se termine par l'incinération du mannequin au milieu des cris de joie et des coups de fusil.
Quiconque lit l'histoire du premier siècle de l'Islam, doit, devant les services éminents rendus par Omar au prophète, rester confondu d'une exécration aussi injustifiée, à notre point de vue, mais légitime en somme devant la nouvelle conception que nous nous faisons d'Ali.
Je sais bien qu'Omar est le conquérant de la Perse, mais les Persans s'en souviennent-ils ? S'en souviendraient-ils même, n'est-ce pas à lui qu'ils doivent l'introduction de leur pays de la «seule vraie religion ?» N'est-ce pas lui qui les a conduits dans la voie du salut? «C'est précisément parce qu'il a fait de nous des Musulmans que nous le détestons», me disait en riant un mirza peu respectueux à l'égard de l'islam.
Cette exécration se manifeste par une série de légendes parmi lesquelles j'en choisirai une comme exemple : Omar jalousait et exécrait Mohammed ; le prophète le savait bien, mais au lieu d'anéantir ce misérable, et considérant sans nul doute que son existence était nécessaire aux desseins d'Allah, il se contentait de lui donner parfois de sévères leçons. Quand Mohammed eut publié dans le Qoran les circonstances de son ascension au ciel, il rencontra l'incrédulité la plus complète chez Omar et résolut de lui faire connaître sa puissance.
Un jour que la femme d'Omar lavait le linge de sa maison, elle pria son mari d'aller lui chercher un peu d'eau au ruisseau qui coulait non loin de là. Il y consentit, prit une cruche et se rendit près du ruisseau. A ce moment, il fut métamorphosé en chienne. Des gamins qui le virent sous sa nouvelle forme lui jetèrent des pierres, et il s'enfuit en hurlant. II vécut ainsi sept années au milieu des chiens, ses semblables, et y remplit toutes les fonctions matérielles assignées à sa nouvelle condition.
Un jour il passa de nouveau près de l'endroit où il était venu puiser de l'eau ; il était accompagné des six petits chiens qu'il avait enfantés, quand soudain il recouvra sa forme naturelle.
Il prit la cruche qu'il retrouva à l'endroit où il l'avait laissée, et fort anxieux de la réception qui l'attendait, se dirigea à pas lents vers sa demeure. Il y retrouva sa femme toujours occupée à laver le linge, et comme il s'excusait d'avoir tant tardé, celle-ci lui fit remarquer qu'il n'avait pas mis plus de temps qu'il n'en fallait pour aller de sa maison au ruisseau et pour en revenir.
Stupéfait, ne sachant que croire, Omar réfléchit longuement et finit par se convaincre qu'il avait été le jouet d'une hallucination.
Débarrassé de son inquiétude, il se rendit à la mosquée, où comme d'ordinaire il retrouva le prophète assis au milieu de ses compagnons : il les salua fort civilement et prit rang dans le cercle,
On causait quand tout d'un coup on vit entrer par la porte de la Mosquée six tout petits chiens qui marchaient encore difficilement. Omar pâlit.
Les compagnons du prophète, indignés de cette intrusion, se levèrent pour chasser les animaux immondes: «Laissez-les, dit Mohammed, et voyons ce qu'ils vont faire.»
Lentement, à pas incertains les petits chiens se dirigèrent vers Omar atterré ; quand ils furent près de lui, ils poussèrent des petits cris de joie et se jetèrent sur sa poitrine pour y trouver le lait dont ils avaient l'habitude de se nourrir. Le malheureux se précipita aux pieds du prophète et reconnut ses torts.
On pourrait écrire de nombreux volumes si l'on voulait réunir toutes les histoires stupides ou scandaleuses qui circulent en Perse sur le khalife Omar : des fabricants de tapis tissèrent son nom dans leurs dessins, de façon à ce qu'il fût foulé aux pieds par les vrais croyants, et certains sunnis indignés du haut rang assigné à Ali par les chiites se faisaient tatouer ou peindre son nom sous la plante des pieds, de façon à marcher continuellement dessus ; le chef de l'Empire persan donna au plus humble des sous-officiers de son armée le titre de sultan, à ses fonctionnaires civils celui de khan, pour montrer le peu de cas qu'il faisait du sultan, khan des Turcs. Celui-ci riposta en nommant Pacha, - abréviation de Padichah, - ses serviteurs et en intitulant imams les fonctionnaires chargés de la garde des mosquées et de la direction des prières. On n'en finirait pas, s'il fallait relever tous les détails -de cette guerre à coups d'épingle.
La légende, au contraire, - chiite, bien entendu, - nous montre donc un Ali désormais digne de son rang de véli.
On raconte qu'un jour un homme, un infidèle vint chez Ali, amenant une femme avec laquelle il était en discussion. Comme il criait très haut, l'émir des croyants, impatienté, s'écria : «Sois chien», et la tête de cet homme se métamorphosa aussitôt en tête de chien. Un des témoins de ce prodige s'écria : «O Ali, un simple mot de toi a suffi pour accomplir une pareille transformation. Pourquoi donc n'en uses-tu pas de même à l'égard de ton ennemi Mohaviah?» - «Si je le voulais, répondit l'imam, on m'amènerait ici mort ou vivant Mohaviah avec son trône. Je suis le gardien du trésor de Dieu, mais ce trésor n'est pas constitué par de l'or ou des pierreries, mais bien de secrets incompris, de desseins arrêtés par Dieu.»
Ishaq ibn Nébatèh raeonte : J'étais un jour assis auprès d'Ali dans la mosquée de Koufa. Des gens y pénétrèrent, amenant un nègre avec eux, qu'ils accusaient d'être un voleur. Ali lui demanda : «As-tu volé?» - «Oui, dit le nègre».- «Ce que tu as volé valait-il un doung 1/2?»-»Oui». -»Prends garde, dit Ali : je vais t'interroger une seconde fois, et si tu persistes dans ta réponse, je me verrai dans l'obligation d'exécuter les lois. Ce que tu as .volé valait-il un doung 1/2?» - «Oui, répéta le nègre». - «Comment te nommes-tu? de quelle famille es- tu?» -»Mon nom est Amr ibn Keri, ma tribu celle des Beni Saalebèh.»
Alors Ali donna l'ordre qu'on lui coupât la main droite. L'exécution eut lieu et le nègre, ramassant la main coupée, s'en alla, semant son sang sur les dalles du temple.
Abdoullah ibn Guéva le rencontra et lui demanda qui l'avait si cruellement mutilé. «C'est, répondit le supplicié, l'émir des croyants, le seigneur des héritiers, le cousin de Mohammed, la meilleure des créatures de Dieu après le prophète, celui que Gabriel venait voir, à qui Michel accordait son aide, mon maître et celui de tous les Musulmans, Ali, fils d'Abou Taleb».
Abdoullah lui dit: «Comment en peux-tu faire de tels éloges, alors qu'il t'a coupé la main?»
«Il m'a coupé la main, c'est vrai, mais il a agi conformément à l'ordre de Dieu.»
Abdoullah courut raconter ce trait à Ali.
«Oui, dit ce dernier, parmi nos ennemis il y a des gens tels que même si nous leur mettions des sucreries dans la bouche, ils ne penseraient encore qu'à leur inimitié contre nous. Parmi nos amis, il est des personnes que nous pourrions couper en morceaux, sans parvenir à arracher de leur coeur l'amour qu'elles ont pour nous».
Puis il fit venir le nègre, remit la main coupée à sa place, la lia avec son manteau et se mit à prier. Du haut des cieux une voix répondit «ainsi soit-il.» Alors il détacha son manteau et la main était recollée.
Des historiens absolument dignes de foi (113) écrivent qu'Ammar Yacer a raconté le fait suivant : Ali, pour une affaire importante, sortit un jour de Coufa et se rendit à Babel. Il y fut tellement occupé qu'il n'eut pas le temps de faire sa prière. Le soleil allait se coucher quand survint un jeune homme qui cria : O Ali, écoute ma prière, aie pitié de moi, hélas! ma femme et mes enfants meurent de faim. J'avais un champ dont les produits nous faisaient vivre, mais depuis trois ans un lion monstrueux est venu s'établir dans ma propriété et personne n'ose plus y pénétrer pour la cultiver.
Alors Ali se tourna vers moi et me dit : «Ammar, va avec ce jeune homme: quand il t'aura montré le lion, tu présenteras à ce dernier cette bague et tu lui diras : O lion, Ali t'ordonne d'abandonner ces lieux.»
Je demeurai fort perplexe, car si le lion me faisait peur, je craignais tout autant la colère de l'émir des croyants. Mais en fin de compte, il fallait obéir, je me recommandai à Dieu et partis. Arrivés à la propriété, le jeune homme grimpa sur un arbre et, tout tremblant, me désigna une élévation de terrain et me dit: «Le lion est derrière.» J'avançai, et je vis un lion gros comme un buffle ; je sentis la peur m'envahir, surtout quand le lion, m'ayant aperçu, s'élança vers moi en rugissant effroyablement.
Je lui montrai la bague et lui criai les ordres d'Ali.
J'avais à peine fini de parler que le lion se prosterna, la tête dans la poussière, puis, s'étant relevé, s'en alla.
Je fus fort surpris de tout cela, et pensai quelque magie à quelque tour de passe-passe, mais je me repentis vivement d'une pensée aussi inconvenante et la cachai au plus profond de moi-même.
Quand je retournai vers Ali, le soleil venait juste de disparaître derrière l'horizon. Ali leva sa main vers le ciel, fit un signe et, docile, l'astre du jour revint sur ses pas et se remit à l'endroit de sa course qu'il doit occuper au moment de la prière. Ali fit alors cette prière qu'il n'avait pu faire jusqu'alors, et celle-ci finie, il se tourna vers moi et me dit : «O Ammar, si ce que tu as vu pour le lion était un tour de charlatan, que diras-tu de l'obéissance du soleil à mes ordres?»
Ces trois anecdotes montrent Ali en pleine possession d'un pouvoir surnaturel que seuls jusqu'alors les prophètes avaient possédé. Et en effet, Ali est plus grand que les prophètes mais non pas que Mohammed. Celui-ci est un Reçoul, les autres n'étaient que des nébis le premier est un envoyé spécial de la Divinité, les autres étaient des inspirés: Ali participe des deux degrés : inférieur de fort peu de chose à Mohammed, il est de beaucoup supérieur à Jésus, à Moïse, à Abraham.
Il nous le dit lui-même»Je suis le gardien des trésors des secrets et des desseins de Dieu n, il participe donc à la science divine, il connaît l'avenir. Il en sera de même pour ses fils, qui seront ses héritiers. On conçoit dès lors l'intérêt qui s'attache à leurs moindres paroles puisqu'elles émanent de la science même du Créateur de l'univers, et l'on comprendra l'empressement que l'on a mis à les recueillir. Malheureusement si respecté, si adoré même qu'ait été Ali de son vivant, ce n'est pas du premier coup que l'islam arriva à cette conception; nous avons pu voir combien sont vagues les données que l'histoire nous offre de la vie des imams, nous ignorons presque tout d'eux et la critique persane n'a recueilli qu'une infinité de légendes plus extravagantes les unes que les autres.
Dès lors bien du temps s'écoula sans qu'on ait songé à réunir ces actes des imams: je sais bien que des règles ont été établies pour leur classification et pour leur acceptation. Le narrateur qui les racontait devait donner des références, expliquer de quelle source ils provenaient, en établir la généalogie. Un tel a raconté à son fils qu'il a entendu Ali prononcer telles paroles : ce fils l'a raconté à un tel, qui le dit àà tel autre et ainsi pendant tant de générations. Avec un système pareil, ce qui devait arriver arriva fatalement: les hadis les plus contradictoires ont été recueillis, acceptés, classés, augmentant ainsi la confusion déjà créée par les diverses interprétations du Qoran.
Que nous élevions des doutes sur l'authenticité des hadis qu'on nous présente aujourd'hui, nous en avons assurément le droit. Déjà, du temps de Mohammed, des «Akhbars»- si j'osais, je traduirais ce mot par celui de «cancans» - nombreux circulaient au point que quelque temps avant sa mort le prophète soucieux d'y mettre bon ordre fit réunir les fidèles et leur dit : «Il y a beaucoup de gens qui mentent à mon sujet : tout ce que vous entendrez de conforme au Qoran, acceptez-le, cela vient de moi : mais ce qui est contraire au Livre de Dieu, rejetez-le.»
Par la suite la Perse entière devint «Akhbariyine» c'est-à-dire qu'elle basait presque exclusivement sa doctrine sur les traditions : celles-ci s'accumulèrent en un fatras formidable. Ce fut à l'époque de Chah Khodabendèh que l'on voulut mettre un peu d'ordre et de clarté dans cette rudis indigestaque moles. Ce fut alors que parurent les «Moujtéhédines». Ceux-ci déclarèrent qu'un «hadis»- ne pouvait constituer une preuve définitive, un argument sans réplique par la raison qu'on ne pouvait jamais établir d'une façon péremptoire son authenticité. La Perse suivit ce mouvement, les Akhbariyines diminuèrent en nombre et en puissance sans cependant disparaître complètement.t : ils sont cantonnés dans le sud et principalement à Bahreïn.
La différence qui sépare ces deux sectes est celle-ci : Les «Akhbariyines» disent qu'il existe deux «houdjets»(preuves, arguments) : 1° le Qoran, 2° les hadis de la famille (114).Les «Moujtéhédines» au contraire en reconnaissent quatre, soit: 1° le Qoran, 2°les hadis du prophète, 3° le raisonnement, 4°le consentement universel. Ce à quoi les Akhbariyines répondent que le raisonnement étant oeuvre humaine peut être défectueux, ce qui disqualifie aussitôt le consentement universel. Nous pourrions, si nous étions chargés de plaider leur cause, ajouter qu'un raisonnement qui se base sur une parfaite ignorance de toutes les sciences physiques, chimiques, économiques, sociales et politiques ne peut être qu'un raisonnement faux, et qu'il ne serait pas difficile de trouver dans l'islam lui-même, un consentement universel qui rejette de la façon la plus nette et la plus catégorique les conclusions des Moujteheds.
Quoi qu'il en soit, ce sont surtout ces hadis qui prédisent l'arrivée du Medhi attendu par tous les Musulmans et qui «doit faire régner sur la terre la justice et la liberté après que le globe terrestre aura été rempli d'oppression et d'injustice». C'est cette question que nous allons examiner dans le chapitre suivant.
=====================================
III. L'IMAM MEHDI - LE CHIISME ACTUEL
Nous avons établi que la «Manifestation divine» d'où est sorti l'islam est composée de treize personnalités : un prophète, et douze imams ou vélis ou portes, tous ces titres s'accordant parfaitement avec le rôle qu'ils sont censés avoir joué.
Nous l'avons dit, ces personnages ne se sont pas bornés à donner des explications purement théoriques aux questions qui leur étaient posées sur tel point obscur du Qoran, sur telle question de dogme ou de droit, sur telle difficulté qui se présentait, sur tel différend qui s'élevait entre Musulmans. D'eux-mêmes ou sollicités par l'indiscrète curiosité de leurs contemporains, ils ont prédit l'avenir: et c'est presque uniquement en se basant sur les hadis que l'islam tout entier attend le Mehdi, comme les Juifs attendent le Messie et les Chrétiens le retour de Jésus. Mohammed s'est montré plutôt sobre de détails: il ne précise rien, du moins dans les hadis que j'ai examinés (115). Ses successeurs au contraire ne manquent pas de localiser dans le temps et l'espace et même dans la matière le Maître du temps. Le nom de sa mère, l'âge qu'il aura, la ville d'où il sortira, ses premiers actes, la forme de son corps et de sa figure, rien ne manque, et dès qu'il paraîtra on pourra facilement le reconnaître. Son apparition sera d'ailleurs précédée de celle du Dedjal - Ante-Christ pour employer une expression qui est familière à la pensée européenne. - Ce Dedjal dont on s'efforce de nous faire une description effroyable sera monté sur un âne long de je ne sais combien de kilomètres, orné d'oreilles auprès desquelles la tour Eiffel n'est qu'un jeu d'enfant, qui rejettera continuellement des excréments semblables pour la forme et l'aspect à des dattes fraîches. Les mécréants se précipiteront sur cette appétissante nourriture, mais à peine l'auront-ils portée à leur bouche qu'ils s'apercevront qu'elle n'est que cendre... ou pis encore. Chose bizarre, cette désillusion, cette expérience personnelle ne les convaincra pas : il faut vraiment que les Musulmans nous croient l'impiété et l'incrédulité chevillées à l'âme pour admettre que nous résisterons ainsi aux témoignages de tous nos sens et de notre raison.
Je laisse à penser si les beaux esprits de Téhéran s'en donnent à coeur joie au sujet du dedjal. La plus innocente de leurs plaisanteries consiste à faire remarquer que puisque celui-ci doit parcourir tous les lieux de la terre il serait à tout le moins convenable de se préparer dès maintenant à sa visite, d'élargir les avenues et les rues pour qu'il puisse facilement passer, de surélever jusqu'à des hauteurs vertigineuses les portes des villes pour qu'en entrant il ne s'écorche pas les oreilles.
Je sais bien que les esprits sains, mais doués de foi ont donné les explications les plus rationnelles de cet Ante-Christ, ont voulu y voir une allégorie, et ont publié de nombreux travaux à ce sujet. Mais je sais un certain médecin de Qachan, -et il est très loin d'être le seul, -qui déplore 1’impiété de son fils et la maudit parce que celui-ci a émis quelques doutes sur la réalité de ces dattes et y a cherché un symbole.
Quelque temps après le Dedjal, l'Imam Mehdi , doit paraître. Il existe' d'ailleurs vivant comme Elie, retiré dans la ville de Djab.oul Qa ou Djab oul Ca. C’est Mohammed, fils le l'imam Haçân Ashéri.
Il naquit, suivant la plupart des historiens, au milieu du mois de chaaban 255: sa mère se nommait suivant les uns Soucen (iris), suivant d'autres Nerghez (narcisse). Son nom et son qonièh sont ceux de 1'apôtre de Dieu, ces titres sont : Mehdi, Mountazzer, Sahab ez-zéman, Houajet, Qaem. Il avait deux ou cinq ans lorsqu'il perdit son père. Et l'on saisit ici d'une façon bien curieuse le singulier manque de logique de l'esprit oriental. Les Persans connaissent d'avance, avec une précision mathématique, toutes les circonstances de l'apparition future de ce personnage alors qu'ils ne sont d'accord sur aucun des détails de sa vie passée au milieu ce ses contemporains. Ils ignorent presque absolument les faits et gestes de ces temps reculés ce qui ne les empêche pas d'affirmer l'authenticité des paroles de personnes dont ils ne connaissent presque que les noms.
Dieu, dit le texte (116) auquel j'emprunte ces données, Dieu, le dispensateur suprême des bienfaits, fit dès son enfance un imam de ce bourgeon de la prairie du Velayet comme il orna autrefois de la maîtrise en philosophie Yahya, fils de Zacharie.
En l'année 265, à l'époque du khalife Moh'tazed, Dieu le cacha dans une cave, à Samourah, suivant les chiites, il y restera invisible à tous les yeux jusqu'au moment marqué, et quand Dieu voudra le manifester il retirera de devant sa face resplendissante comme le soleil le masque qui la dérobe aux regards».
Toutes les sectes musulmanes attendent l'arrivée du Mehdi : mais elles diffèrent d'opinions quant à l'individualité même de ce personnage: toutes n'admettent pas le Mohammed fils d'Haçan, dont nous venons de parler : elles désignent quelque autre Fatimite. Les : Sunnis par exemple, croient que le Mehdi naîtra, vers la fin des temps, de la descendance de Fatimèh Zohra.
Ainsi donc des hadis nombreux, de nombreuses prédictions annoncent la bonne nouvelle de la manifestation du Mehdi promis : ils la commentent, la détaillent, la précisent, en décrivent les signes avant coureurs. Cependant les contradictions de ces documents sont telles, ils se détruisent mutuellement d'une façon si continue que Cheikh Ahmed Ahçahi dans son livre Chehr' ouz-ziaré et Alla:mé'Médjlici dans le Qeibèt du Bahar el-Envar ont nettement affirmé qu'il est excessivement difficile de mettre d'accord tous les hadis et de les faire concorder; aussi, soucieux d'en faire un recueil aussi complet que possible, Medjlici les enregistre tous malgré ces contradictions et ces oppositions. Au fond, il serait plus prudent de s'en tenir à la règle décrétée par Mohammed et de n'accepter que ceux dont le sens est conforme aux versets du Qoran: les autres devraient être purement et simplement rejetés.
Il y en a de toutes sortes et pour tous les goûts, et nous en donnerons ici quelques-uns à titre de curiosité.
L'un des plus célèbres est celui d'Abi Lobeïd Makhzoumi - rapporté par Medjlici.
Donc Abi Lobeïd raconte: Imam Abou Djaafer m'a dit: «O Abi Lobeïd, certainement douze des enfants d'Abbas exerceront la souveraineté, mais après le huitième, quatre d'entre eux seront tués, dont l'un par un mal de gorge (?). Ce sont là gens à la vie courte et de mauvais naturel. L'un d'entre eux est le rebelle, l'égareur des hommes qui se nomme Hadi.
» O Abi Lobeid, j'ai une grande science en ce qui concerne les lettres isolées du Qoran. Dieu a fait descendre [lettre arabe] et Mohammed se dressa jusqu'à ce que la lumière de Dieu devînt évidente. Et cette Altesse naquit, et le jour de sa naissance avait dépassé de 103 ans le 7e millier(117).»
«L'explication de ce point se trouve dans les lettres isolées du Qoran. Si tu les comptes sans les redoubler, il n'y a pas une lettre des lettres isolées du Qoran dont les jours ne passent sans que se dresse, au moment de la fin des lettres isolées, le Qaem de la famille des Beni Hachem.
[lettre arabe] est un» [lettre arabe] =30 et [lettre arabe] =40 et [lettre arabe] =90 1e tout =161 et se dressa Houssein, fils d'Ali, il arriva donc au moment de la fin de [lettre arabe] de Allahou la éla lié : quand ce temps fut rempli alors se dressa le Qaem, fils d'Abbas, au moment de [lettre arabe] : quant au nôtre, il le fera au moment de passer le nombre des lettres isolées des premières, sourates, [lettre arabe]. Donc, trouve ce point, calcule et garde le secret {118) .
Ce hadis est confirmé par celui connu sous le titre de hadis Moufazzal fils d'Omar, qui aurait entendu l'imam Sadeq dire: «C'est dans l'année 60 que l'ordre de cette Altesse se manifestera...»
Comme nous pouvons le constater, ces deux prédictions concernent la date de l'apparition du Mehdi : voyons ce qui est prophétisé quant à son âge.
Medjlici dans le chapitre intitulé Keifiyét Zouhour Qaem rapporte qu'Abi Bécer a entendu les paroles suivantes sortir de la bouche d'imam Sadeq :
«Quand le Mehdi surgira, les hommes le renieront car il reviendra vers eux sous les traits d'un jeune homme : alors ne croiront en lui et ne seront confirmés dans leur foi que ceux dont Dieu a pris l'engagement dans le monde des atomes».
Dans le livre Qafi, Mohammed ibn Yaqoub Koleini dit qu'Hakem fils d'Abi Naïm a raconté qu'à son retour de pèlerinage il alla trouver l'imam Sadeq qui se trouvait alors à Médine. «Je lui expliquais, aurait-il dit, qu'à la Mekke, entre Roukn et Maqam, j'avais fait le voeu de ne plus le quitter, à partir du moment où je l'aurais vu avant de savoir si c'était lui le «Maître du temps»
» L'imam ne me répondit pas.»
Je restai à Médine et 30 jours plus tard je le rencontrai sur la route: «O Hakem, me dit-il, tu es encore ici ?»
«Je t'ai dit, répondis-je, quel voeu j'avais fait à Dieu, tu n'as rien dit.»
«Eh bien, viens me voir demain matin».
J'y allai, et il me dit: «Que demandes-tu?»
«Je lui répétai ce que je lui avais dit et lui demandai : Es-tu celui qui tient la main à l'exécution des ordres de Dieu?
» O Hakem, nous autres imams nous sommes tous ceux qui tiennent la main a l'exécution des ordres de Dieu.
»Soit, mais es-tu le Medhi, celui qui montre la route.
»O Hakem, nous tous nous sommes ceux qui montrent la route ?
»Alors es-tu le Maître du sabre ?»
» Chacun de nous est le Maître et l'Héritier du sabre.»
»Enfin est-ce toi celui qui doit tuer les ennemis de Dieu? Celui qui remplira de gloire les élus de Dieu ? Celui qui imposera la Religion ?»
»O Hakem, comment serais-je celui-là, puisque j'ai déjà 45 ans? Il est en vérité, lui plus proche de sa nourrice, il est plus léger que moi sur le dos d'un cheval.»
Hafiz Abou Naïm Ahmed ibn Abd Oullah rapporte quarante hadis relatifs à la manifestation du Mehdi et d'après lesquels ce personnage doit apparaître dans un village nommé Qer'hé. Imam Djaafer annonce que quand il proclamera sa mission il sera à la Mekke, le dos appuyé contre la Qaaba, le sabre haut, environné de 313 personnages. A ce moment, ses premières paroles seront les suivantes :
La plus petite quantité qui vous restera par la grâce de Dieu vous sera plus avantageuse si vous
êtes croyant (119)
Dans le Kechfoul-Qoummèh il est écrit : Rachiq Adjêb raconte :«Moh'tazed me fit venir avec deux autres personnes et nous dit: «Haçan(120) ibn Ali est mort à Samourah. Allez vite cerner sa maison : quiconque vous y trouverez, tuez-le et apportez-moi sa tête.»
-»Obéissant à son ordre, nous nous hâtâmes vers Samourah et pénétrâmes secrètement dans la maison
» d’Haçan Askéri. La maison était fort belle, et semblait nouvellement construite. Un rideau cachait une porte; nous levâmes le rideau et nous vîmes que la porte donnait accès dans une cave. Nous y pénétrâmes et, y vîmes une mer à l'extrémité de laquelle flottait une natte. Un homme d'une grande beauté priait sur cette natte sans que le bruit de nos pas lui fit lever les yeux sur nous. L'un de nous voulant être le premier à le saisir se jeta à l'eau mais faillit se noyer : je l'aidai à sortir de ce mauvais pas. Mon autre compagnon fit la tentative à son tour, mais lui aussi faillit se noyer. Stupéfait, je criais : O maître de cette maison, je demande pardon à Dieu et à toi : quand j'ai voulu obéir à l'ordre du khalife, je ne savais de quoi il s'agissait.
» Il ne fit aucune attention à tout ce que je pus lui dire : confus, je retournai auprès de Mohtazed à qui je fis un rapport de ce qui s'était passé. Il m'ordonna, sous peine de mort, de ne dévoiler à âme qui vive ce secret.»
La tradition chîite distingue deux disparitions de Mohammed ibn Haçan Askéri, l'une, le «qéibet soughra», l'autre le «qéibet koubra». Durant l'époque de la «petite disparition» l'imam se fit représenter par quatre ambassadeurs (121) qui parcouraient le monde musulman chîite. C'est par leur intermédiaire qu'on écrivait à l'imam et qu'on en recevait réponse, c'est eux, - et ceci serait plus grave, si l’on pouvait prêter une attention quelconque à de pareilles légendes, - c'est eux, dis-je, qui touchaient les sommes quelles qu'elles fussent qui lui étaient dues et qu'ils étaient censés lui faire parvenir. Quand le dernier de ces ambassadeurs mourut, il n'y eut plus d'intermédiaire entre l'imam, c'est-à-dire entre Dieu et les hommes, et c'est alors que fut définitivement fermée la porte de la science, c'est alors qu'eut lieu le «queibet koubra».
Vraiment, j'ai peur de paraître fastidieux, à retomber toujours dans la même ornière: mais enfin j'expose des idées qui ne sont pas les miennes, et je ne cherche qu'à édifier le lecteur, sur le tissus de superstitions qu'est devenu l'Islam entre les mains des Persans. Il semblerait que le Sahab ez-Zéman, retiré dans Djab oul-Qa, ou Djab oul-Sa, une île, ai-je entendu dire au Moujtéhèd Mirza Mohammed Ali Chirazi, du côté de l'Espagne, et que les Européens n'ont pu encore apercevoir à cause de leur cécité morale, dû y rester tranquille en attendant son heure ; il semblerait que ses ambassadeurs, une fois morts et enterrés, eussent mérité la miséricorde de Dieu, et qu'ils dormissent paisiblement de leur dernier sommeil à l'endroit où ils ont été enterrés. Il n'en est point ainsi, et nous revenons encore aux miracles sans nombre qui illustrent l'histoire chiite.
Car le Sahab éz-Zéman sort de son île, car les Nawabs sortent de leurs tombeaux, car ces gens voyagent et se promènent, car ils se montrent aux yeux de leurs fidèles. Je veux bien que les Persans que l'on interrogera à ce sujet, nient, comme de beaux diables, tout ce que je dis ici. Je veux bien qu'eux-mêmes, honteux des superstitions qui assaillent leurs compatriotes, m'attaquent, pour se défendre, avec la dernière énergie. Soit, mais que pourront-ils prétendre quand on leur affirmera d'abord l'existence de leur almanach national, ensuite du Kechf oul-Qoumméh et du Chévahéd eun-noubouvvé?
Voici ce que je lis dans le
CALENDRIER PERSAN
Année 1280 de l'Egire
comput solaire correspondante
au 29 Zilqaadéh 1318
du comput lunaire rédigé par S. E. Mirza Mahmoud Khan Nedjm el-Moulk
Neveu de Son Excellence Nedjm ed-Dowlé
Téhéran
1318
Cet opuscule porte le cachet de Nedjm ed-Dowle et le sceau de garantie de S. E. E'thèmad ès-Saltanèh,
Ministre de la Presse. Il nous offre donc toutes les garanties désirables : il est d'ailleurs l'almanach officiel.
A la page 2, nous y lisons.
«Ceux des esclaves élus que l'on appelle Abdal ou Ridjal oul-Queïb, ou encore les compagnons de Son Altesse le Maître de l'ordre (imam Mehdi) se trouvent chaque jour, ou quatre jours par mois sur un point des points du monde et répandent des bienfaits sur les créatures.»
«Le matin, quand on sort de chez soi, ou bien quand on commence son travail il faut faire attention et examiner de quel coté ils se tiennent: alors il faut dire cette prière (suit le formulaire).» Puis vient ce tableau indiquant les jours et les directions. Les 1er, 9ème, 17ème et 25ème de chaque mois ces êtres bénis sont à l'Orient:
Les 2- 10- 18- 26 entre le Nord et l'Orient.
Les 3 - 11-19- 27 au Nord.
Les 4 - 12- 20- 28 entre le Nord et l'Ouest.
Les 5-13- 21- 29 à l'Ouest.
Les 6- 14 - 22 - 30 entre l'Ouest et le Sud.
Les 7- 15 - 23 au Sud.
Les 8 - 16 - 24 entre le Sud et l'Orient.
Ces personnages sont donc continuellement en mouvement et se transportent avec rapidité vertigineuse d'un point en un autre, et cela en vertu d'un acte miraculeux, le Teï oul-Arz. Et cependant ils voyagent à cheval, quelquefois avec leur maître : ils entrent en relation avec les hommes qu'ils rencontrent, comme nous le prouve cette anecdote prise au hasard entre cent.
Dans le Kechf'oul-Quoumméh de Rachiq Adjeb, et dans le Chévahed oun-noubouwé il est écrit :
«Ismail fils d'Hassan Arqali raconte : Mon fils fut atteint à la jambe d'une plaie telle qu'aucun médecin ne la»pouvait guérir. Chaque printemps, elle s'ouvrait, et une grande quantité de sang et de pus s'en écoulait.»Cette blessure le faisait tant souffrir qu'obligé de lui donner continuellement mes soins je dus négliger mes»affaires.
»Un jour, j'alla,i à Hilla, à la conférence de Sèyyéd Rézi oud-dine Taous, auprès duquel je me plaignis fort de mes tourments. Le Séyyéd fit venir tous les médecins d'Hilla, et l'on examina la plaie. Les hommes de l'art décidèrent que la blessure intéressant la veine médiane de la jambe devait amener une issue fatale, mais que d'autre part la section du membre malade devait entraîner la mort.
» Le Sèyyéd nous amena à Baghdad, mais les médecins de la ville se déclarèrent impuissants à me (122) guérir.»Désespéré, j'allai à Samourah, et après avoir fait le tour des tombeaux des imams, j'entrai dans une cave et je»suppliai, en pleurant, Dieu de me venir en aide, et j'implorai aussi les imams. Je restai là plusieurs jours. Un»jour, j'allais au Tigre pour y faire mes ablutions (123), je me revêtis de vêtements propres et je retournai aux»tombeaux. En cours de route, je vis dans la plaine venir 4 (124) cavaliers qui portaient des sabres à leurs ceintures: «l'un tenait une lance, l'autre était revêtu d'un feredjè.
» Je pensais que ces personnages étaient des chérifs de Samourah. Quand ils arrivèrent près de moi, je les»saluai : ils répondirent à mon salut. Celui qui portait la lance était à la droite, les deux autres, à la gauche de»l'homme au Feredji. Ce dernier m'interpella : Demain retourneras-tu dans ta famille?
«Oui, répondis-je.»
«Approche-toi, me dit-il, que je voie ta plaie.»
«J'obéis et alors il pressa- dans sa main l'endroit malade avec tant de force qu'il me fit horriblement mal.»
«Alors le porteur de lance me dit : Tu es guéri, ô Ismaïl.»
«je m'étonnai qu'il sût mon nom, et je dis : Je suis en paix, qu'elle soit sur vous.»
«Alors il me fit comprendre que le personnage revêtu du feredjè était l'imam Ez-Zèman. Je m'approchai de lui, je baisai son étrier et me mis à le suivre.»
«Retourne sur tes pas, me dit-il. - Jamais je ne me séparerai de vous, m'écriai-je. - Retourne, me répéta-t-il, car c'est là qu'est ton salut! Mais je m'obstinai dans ma première réponse.»
«Alors l'homme à la lance s'écria : N'as-tu pas de honte; ne comprends-tu pas que tu refuses d'obéir à l'imam?»
«Je m'arrêtai. Alors l'imam se retourna vers moi et me dit : Quand tu arriveras à Baghdad, Abou Djaafer Mostanser te fera venir; n'accepte aucun présent de lui.»
«Alors ils disparurent.»
«J'arrivai à Samourah et je demandai qui étaient ces cavaliers. - Des chérifs d'ici, me répondit-on. - Pas du»tout, répliquai-je, c'était l'imam. Ez- Zéman.» '
«Lequel était l'imam? l'homme à la lance ou celui» qui portait un feredjè.»
«Celui qui portait un feredjé.»
«Lui as-tu montré ta plaie?»
«Oui, dis-je, et je montrai ma cuisse sur laquelle il n'y avait plus trace de plaie. Stupéfait, je crus m'être trompé de jambe, et je découvris l'autre, mais elle était saine aussi. On se précipita sur moi et l'on me déchira mes vêtements pour en faire des reliques. Les sèyyéds me délivrèrent de la foule et me conduisirent»au Trésor, où je leur racontai par le menu mes aventures.»
«Le lendemain matin je fis ma prière et retournai à Baghdad. Le récit du miracle m'y avait précédé, et je fus entouré, à mon arrivée, par une foule énorme de gens : je faillis être étouffé.»
«Le ministre de Mostanser, qui était de Qoum, avait entendu parler de tout cela; il fit venir Sèyyéd Rezi ed-dine»et l'interrogea à ce sujet. Celui-ci vint me retrouver dans la foule et, s'étant assuré de ma guérison, il me»conduisit chez le vézir, à qui je racontai ce qui m'était arrivé. Il fit venir les médecins qui m'avaient»examiné, les interrogea sur le remède à mes maux, et ils répondirent comme auparavant : Si on ne l'opère»pas, il mourra, il mourra si on l'opère».
«Soit, dit le ministre, mais si on l'opère et qu'il n'en meure pas, en combien de temps se cicatrisera la coupure?» •
«En deux mois, mais il restera une tache blanche où les poils ne repousseront pas.»
«Combien y a-t-il de temps que vous avez examiné ce malade?» -
«Dix jours.»
«Alors je découvris ma cuisse sur laquelle il ne n restait pas la moindre trace de la maladie. On me mena ensuite chez Mostanser qui, lorsqu'il eut entendu le récit de cette merveille, me fit cadeau de 1.000 dinars, que je refusai pour obéir à l'ordre de l'imam.»
Quoique l'authenticité de cette histoire ne laisse tien à désirer à la critique persane, celui qui la rapporte éprouve cependant le besoin d'y apporter le poids de son témoignage, et il ajoute :
«Je racontai moi-même cette anecdote à ceux qui venaient me voir. Un jour que je la rappelai à la mémoire»de nombreux auditeurs, l'un d'eux me dit : Je suis Chems ed-dine Mohammed, fils de l'Ismaïl, à qui tout ceci»est arrivé. J'étais trop petit pour avoir souvenance d'avoir vu la plaie, mais j'ai constaté souvent qu'à la»place même qu'elle occupait jadis, il n'en restait plus de traces. Mon père ne pouvait, par la suite, se»consoler de n'avoir pas, malgré tout, suivi l'imam. Il retournait à chaque instant à Samourah, dans»l'espérance de le revoir, et il fit ainsi plus de quarante fois le voyage.»
Ainsi donc l'imam Mehdi est vivant, il voyage à travers le monde et nous savons exactement et chaque jour dans quelle direction se trouvent ses ambassadeurs. Il peut arriver que nous les rencontrions et nous pouvons obtenir d'eux des faveurs indicibles. A part les détails, différents suivant les pays, ces rencontres ressemblent étrangement aux apparitions plus ou moins célèbres qui se sont succédé en Europe. L'analogie ne s'arrête pas là, et nous pouvons hardiment affirmer que chaque miracle postérieur au Christ, recueilli chez nous par la légende, a son pendant, souvent identique, chez les Chiites. Jusqu'au miracle de saint Janvier, qu'on a pu constater à Casvine vers le milieu du règne dè Nassr ed-dine Chah, et qui consistait en ceci : Un arbre, un de ces arbres qui, on ne sait pourquoi, est l’objet d'une vénération superstitieuse au point que chaque personne qui passe, dans son voisinage se détourne de son chemin pour y accrocher un morceau de ses vêtements, se mit, dès le premier jour de moharrem, à transpirer du sang. Le 10ème jour, jour de l'Achoura, ce furent des torrents de liqueur rouge qui s'en échappèrent.
La Perse entière se précipita au pèlerinage. Au bout de deux ou trois ans, la cour émue voulut en avoir le coeur net. On envoya un mollah que je connais, avec ordre de surveiller étroitement les choses et de faire un rapport détaillé, tant des mesures qu'il aurait prises que des résultats qu'il aurait constatés. Peu croyant ou peu crédule, le mollah joua son rôle en conscience, et, par un malheur étrange, l'arbre, cette année-là, se contenta de pousser des feuilles parfaitement vertes et des fleurs tout à fait normales.
Il n'en est pas moins vrai que les tours de passe-passe de cette nature se multiplient à l'infini et que la Perse est pleine de grottes divines, de sources miraculeuses : immense Lourdes, elle est presque tout entière un lieu de pèlerinage.
L'ignorance du peuple n'a d'égale que sa crédulité, et c'est une étrange chose qu'une discussion religieuse avec un personnage persan. Ceux-ci, en effet, dès qu'ils sont instruits, dès que leur intelligence s'élève un peu, tout en restant musulmans, rejettent le cortège de superstitions qui accompagnent tout sujet du chah, depuis sa naissance jusqu'au delà du tombeau; ils en. rougissent eux-mêmes et les renient avec une véhémence digne d'une meilleure cause.
S'il y a un dogme invétéré dans l'âme d'un chiite, c'est bien celui de l'impureté légale des chrétiens : ceci n'est pas discutable et je n'en veux pour preuve que l'examen du droit musulman, auquel j'ai assisté il y a deux ans, à l'École des sciences politiques de Téhéran. C'est un fait aussi certain pour eux que pour les vrais catholiques, le dogme de l'Immaculée-Conception. Eh bien, certains personnages avec lesquels j'en parlais voulaient me démontrer, ce qui était facile, Qoran en main, que le prophète arabe avait excepté de la malédiction les «Gens du Livre», et devant mon obstination à constater ce dogme dans le chiisme, les uns détournaient brusquement la conversation, les autres la terminaient par une plaisanterie, d'autres enfin, plus audacieux, concluaient : que seuls étaient impurs ceux qui déclaraient impure une créature de Dieu.
C'est donc au peuple qu'il faut s'adresser, c'est chez lui qu'il faut faire une enquête, seul, il nous répondra .avec une brusque franchise. Car, qu'on n'aille pas s'y tromper. S'il est vrai que certaines personnalités élevées soient délivrées des anciens préjugés, s'il est vrai que la classe bruyante des «mirzas» soit en général assez irrévérencieuse à l'égard de la religion, n'oublions pas que le peuple n'est musulman que de nom, mais sincèrement attaché à une infinité de superstitions baroques, dont l'ensemble constitue la vraie foi du vrai peuple de Dieu.
Loin de l'éloigner de ce chaos de stupidités, le bas clergé l'y enfonce au contraire davantage. Aussi ignorant que le peuple, mais plus intelligent, plus âpre au gain et plus avide, il n'use de son intelligence, du respect qui s'attache au turban blanc ou à la ceinture verte que pour aveugler plus encore ce peuple vif, agile, pénétrant, et qu'il serait si facile d'éclairer. Un de ces farceurs, A. Séyyéd Abou Taleb Khoraçani, mort aujourd'hui, malheureusement pour la gaieté persane, ne s'avisa-t-il pas de proclamer du haut de la chaire que les Européens n'avaient pas le moins du monde accompli de progrès dans les sciences : s'il semblait que leur médecine, par exemple, fût en avance sur la médecine persane, c'est uniquement parce qu'ils avaient retrouvé dans les vieux bouquins d'antiques formules, d'anciennes invocations à des personnages doués d’un pouvoir surhumain. «Ne croyez pas, disait-il, que «acide phénique» et «acide borique» soient des médicaments, le pharmacien vous vend n'importe quel produit qu'il place sous l'invocation de A Seïd Borique et d'A Seïd Phénique, deux descendants de notre illustre prophète, morts tous deux pour la sainte cause d'Ali Mourteza !(125)»
J'ai choisi là un exemple, - peu vraisemblable, - mais absolument authentique et qui, je pense, me dispensera d'en donner d'autres. On pourrait cependant douter de la bonne foi du prédicateur, et j'espère pour lui que ce serait à juste titre: mais que dut penser le bas peuple?
Un autre, Mirza Aced Oullah, médecin, - je ne sais pourquoi je cite son nom, car ils sont des milliers dans le même cas, - se refuse énergiquement à employer la pharmacopée européenne essentiellement constituée de filtres ou de talismans plus généralement composés sous l'invocation de Satan. Seul, le sulfate de quinine a trouvé grâce devant ses yeux, et encore ne suis-je pas bien sûr qu'il ne demande pas pardon à Allah chaque fois qu'il s'en sert pour lui-même ou qu'il l'ordonne à ses malades.
Ce serait une erreur que d'accuser de cet état de choses le peuple seul et son manque d'instruction : livré à lui-même, à ses réflexions, il sortirait assez facilement de l'abîme dans lequel il est plongé car, je le répète, il a l'esprit très vif et très curieux : mais les mollahs veillent jalousement et l'empêchent de réfléchir. Et là la responsabilité retombe tout entière et d'un poids écrasant sur le haut clergé. Effectivement, si peu hiérarchisé qu'il soit, ce clergé unit cependant tous ses membres dans une étroite intimité que créent l'intérêt commun, les relations de professeurs à élèves, le besoin de s'unir pour combattre les pernicieuses influences du dehors. De plus, il y a des degrés dans ce clergé et le simple akhound est bien obligé de s'incliner devant, le Moujtehèd qui à son tour obéira, -ils l'ont bien montré lors des événements de la régie, - à l'un d'entre eux dont la résidence est en général à Nedjef, et qui, sans être officiellement le chef de la religion, n'en est pas moins le personnage les plus considérable et dont l'opinion fait loi. Que pensera-t-on de l'autorité qu'il peut avoir parmi ses égaux; - primus interpares, - quand on saura que Mohammed a dit : «Les oulémas de ma nation seront plus grands que les prophètes des Hébreux» (Hadis) ?
Ainsi donc Jésus, le plus grand prophète après Mohammed est dépassé en grandeur, en puissance par n'importe quel Moujtehed de la Perse.
Et Jésus n'est pas un inconnu ; son nom est là-bas presque aussi souvent prononcé que chez nous: homme incomparable, il possédait le grand nom de Dieu, ressuscitait les morts, accomplissait les miracle les plus beaux ; la littérature est pleine de lui, les légendes succèdent aux légendes qui le dressent sur un piédestal inouï pour un simple mortel. Il était le «Rouh Oullah», l'esprit de Dieu, plus grand que Moïse, plus grand qu'Abraham, plus grand que les 72.000 prophètes réunis. Et voilà qu'il est détrôné par tel prélat, dont le nom obscur ne dépasse; pas les frontières de la Perse !
Qu'est-ce à dire ? et ce prélat est-il donc capable d'éblouir les yeux humains de prodiges et de miracles? Sa puissance dépasse-t-elle celle des simples mortels ? Est-il dépositaire d'une science plus haute que la science humaine? possède-t-il les secrets restés fermés aux autres hommes ? Parfaitement, et c'est bien là le trait le plus étrange du caractère persan. Ne connaissant rien des lois physiques qui régissent le monde, son esprit ne peut être troublé de les voir renverser. Il contemplera simplement quelque chose qu'il' n'a pas encore vu: il y croira trouver une preuve de l'intervention divine, sans se douter le moins du monde cependant de la portée de ce qu'il aura vu. Vivant au milieu de superstitions multipliées, habitué dès sa plus tendre enfance aux récits merveilleux des. miracles les plus étranges et les plus fréquents, il s'attend à chaque instant à en voir produire sous ses yeux. N'est-ce pas cheikh Hasan, le dellal, qui avait recueilli chez lui une bande de derviches éhontés, dans l'espoir de leur voir accomplir un prodige: ne les a-t-il pas hébergés, durant six mois, ne les a-t-il pas nourris, n'a-t-il pas satisfait à toutes leurs fantaisies ; et lorsque ruiné par ces dépenses il se résigna à se séparer d'eux, n'est-il pas demeuré convaincu que si ses hôtes n'avaient pas accédé à ses désirs, c'est ou qu'il ne les avait pas assez bien soignés ou qu'il aurait dû les garder plus longtemps? A-t-il seulement laissé un instant pénétrer en son cerveau cette idée blasphématoire que si les derviches n'avaient rien fait c'est qu’ils étaient incapables de rien faire? Au lieu d'être surpris de voir un miracle, cet excellent homme fut stupéfait de n'en point constater.
On concevra dès lors avec quelle facilité le persan acceptera le récit d'un prodige produit par tel Moujtéhèd : mais le premier qui le raconte, quelle est sa mentalité ? pourquoi le raconte-t-il ? est-ce autosuggestion ? c’est for possible, mais dans ce cas que penser du Moujtéhèd qui laisse dire ? Est-ce simple mensonge destiné à éblouir les masses, c’est plus probable et le rôle de Moujtéhèd est ici encore peu brillant. Quelque explication qu’on en veuille donner, les faits sont là et le Qessas el Ouléma édifiera facilement le lecteur.
La seule différence entre le prophète et le Moujtéhèd est que le prophète produit des Moudjézè (miracles) et le Moujtéhèd des Kéramats (prodiges). Et la Perse désireuse, semble-t-il, de bien faire connaître sa mentalité, dit de ses oulémas qu’ils produisent des actes Kharèdj oul Adat (hors des habitudes), ce qui revient exactement à ce que j’ai dis plus haut.
Eh bien, pourquoi ce haut clergé, qui jouit de si énormes prérogatives, qui pourrait établir les bases de sa puissance sur la moralisation des masses, qui pourrait relever le niveau intellectuel de ses ouailles, permet-il aux mollahs des mensonges aussi flagrants, des affirmations aussi insanes que celles que nous avons relevées plus haut dans la bouche d'A Séyyèd Abou Taleb Khoraçani? N'avons-nous pas le droit nous qui, habitués à d'autres façons de penser, cherchons à établir les responsabilités, n'avons-nous pas le droit de dire que le haut clergé est responsable, que ce qu'il ne dément pas il l'accepte, que cet amas inouï de fables et de superstitions élevé à l'ombre de sa tolérance est son oeuvre propre et qu'il en doit supporter le poids à la barre de la philosophie et de l'histoire?
A ce sujet qu'on me permette de rappeler les fêtes sanglantes du Moharrem : les Moujtéhèds que l'on interroge à ce sujet sont unanimes à déclarer, en principe, que ces massacres sont interdits par les lois de la religion et de la raison : qu'ils constituent un acte impur dont tout bon croyant doit s'écarter. Dès lors, pourquoi ces processions répugnantes se multiplient elles d'année en année? Pourquoi celles de 1901 sont-elles les plus, nombreuses, les plus fréquentes, les plus sanglantes que j'aie jamais vues ? Pourquoi laisser monter cette formidable marée du fanatisme sous laquelle crouleront un beau jour les institutions de l'Empire et peut-être bien, à la longue, la sécurité des Européens? Dans quel but, puisque l'oeuvre est impure? Pourquoi, puisqu'elle est dangereuse ? Et cependant prêtres et civils se disputent l'honneur d'exciter à ces scènes monstrueuses, les uns par leur argent, les autres par leurs prédications. L'année dernière cinq hommes ont succombé à leurs blessures, l'année prochaine ils seront plus nombreux, plus encore les années suivantes et le bon ordre dans la rue est à la merci du moindre incident.
D'autant que les Européens ont pris la mauvaise habitude de monter sur les toits du bazar qui entoure le Sebz Meidan pour contempler ce hideux spectacle qui est là à son apogée. Déjà l'un d'eux, qui avait le tort de rire en causant avec un de ses amis, fut vivement apostrophé par un homme du peuple convaincu qu'il raillait leur piété. Qu'un beau jour un fou, un chrétien fanatique se livre à une manifestation déplacée, qu'un poltron ou un imbécile s'imaginant parce qu'on l'insulte qu'on en veut à sa vie, fasse le geste de se défendre, qu'un hasard quelconque amène une rencontre malheureuse entre l'élément fanatique et l'élément étranger souvent mal représenté à Téhéran, les conséquences de ce hasard, de cette rencontre peuvent être incalculables.
Je ne veux pour preuve des dangers que peut provoquer l'exaspération religieuse savamment excitée pendant ces quelques jours que les précautions officiellement prescrites aux négociants européens dès avant le Moharrem. Ils sont priés de supprimer de leurs devantures les bouteilles quelconques renfermant une boisson fermentée, un alcool, une liqueur.
Si la simple vue d'un article défendu peut provoquer des désordres, des pillages et des troubles, que devons-nous penser des hypothèses que nous exposions tout à l'heure?
Le remède à cette situation est-il si difficile à trouver? Ne peut-on opposer une digue à cette marée montante et furieuse ? La solution du problème nous semble des plus faciles : Mettre en demeure les plus grands oulémas de la Perse de rendre leur fetva sur la légitimité ou l'illégalité de ces manifestations : nous avons vu qu'elles sont illégales et impure, La sentence obtenue, lui donner la plus grande publicité possible et interdire aux fonctionnaires, aux princes, aux grands personnages de donner une somme quelconque, si minime soit-elle, aux chefs de ces processions.
Car elles sont nombreuses et forment ce qu'on nomme des destés qui parcourent les rues de la ville, criant, chantant, se frappant de coups de sabres. Elles ne vaguent pas au hasard, mais ont des buts bien déterminés, se rendant chez les grands personnages, les uns après les autres, qui ont préparé d'immenses salles, ou des tentes, où le peuple a pris place à l'avance. La représentation terminée, le maître de la maison donne au chef un châle ou une somme d'argent. Supprimez ce cadeau, vous verrez le chef de la procession disparaître, l'exploitation devenant onéreuse, et le chef n'existant plus, la procession ne se constituera pas.
J'aurais fort à faire s'il me fallait énumérer toutes les superstitions, toutes les idées bizarres du peuple le plus crédule de la terre; vingt volumes n'y suffiraient pas, et ce n'est d'ailleurs pas là mon but. Je ne fais pas ici, je le répète, le procès du chiisme : je ne le compare en aucune façon au sunnisme ou à quelque religion que ce soit: je ne sais s'il est la vérité absolue, ou s'il n'est qu'une hérésie détestable: je ne me permettrai pas de blesser dans leurs croyances les nombreux amis que je compte parmi les Musulmans de la Perse: je me suis borné à observer que quant à ses croyances fondamentales le peuple ignorant a déraillé de la route droite, qu'il ignore tout de sa religion qu'il a remplacée par une série éparse des idées les plus diverses, flottantes depuis les temps les plus reculés dans l'atmosphère de l'humanité. Je serais désolé qu'on pût s'y méprendre, car j'ai voulu être impartial et je me suis efforcé de l'être. Mais j'ai bien dû reconnaître, comme le font des Persans éclairés, les abus multiples du sentiment religieux en ce pays, que je ne puis mieux comparer qu'à notre France du moyen âge : comme les mollahs, nos prêtres ont abusé de la crédulité de leurs ouailles, comme eux, ils ont âprement défendu leurs prébendes et leurs bénéfices contre l'envahissement des idées de progrès, comme eux, ils ont emprisonné, torturé, mis à mort les gens qui avaient le tort d'avoir d'autres opinions que les leurs. Ce n'est pas en le cachant qu'on peut guérir un mal aussi profond et aussi grave : ne vaut-il pas mieux regarder autour de soi, faire son mea culpa et profiter des souffrances, des douleurs, des amertumes et des vagues de sang à travers lesquelles les autres peuples ont passé, pour arriver enfin à une idée plus juste des choses, à un sentiment plus net de la Justice, de la liberté ; des droits et des devoirs de l'homme?
Au surplus et pour éviter tout reproche, je cède ici la plume à un auteur babi : lui aussi recherche les causes intimes de la réforme du Bab, lui aussi croit les trouver où je les ai cherchées moi-même. Nous la suivrons donc dans son enquête, enregistrant ses opinions, respectant les termes qu'il emploie, lui laissant le mérite, s'il en a, de ses découvertes, mais lui laissant aussi l'entière responsabilité de ses affirmations. Je traduis sans apprécier:
«En matière religieuse, l'imitation servile, l'obéissance passive sont indignés et inadmissibles. C'est là un fait que comprennent par l'ampleur de leur intelligence ceux dont l'esprit saisit les questions délicates; c'est un fait que les savants perspicaces voient avec l'oeil de la certitude et que ceux qui sont intelligents savent, éclairés qu'ils sont par les lumières de la science et de la réflexion. C'est là oeuvre que ne peuvent parfaire ni la passion, ni l'imagination, ni les conjectures et l'aile des analogies ou de l'obéissance à ceux qui recherchent la prééminence en ce monde ne peut soutenir l'envolée en ces espaces immenses. C'est en imitant ce qu'elles tenaient de leurs pères ou de leurs aïeux, c'est en obéissant à leurs docteurs que les nations précédentes ont repoussé les prophètes et ont été précipitées dans le polythéisme. C'est ainsi qu'à l'époque de l'apparition de Mohammed il a été dit (Q., XLIII, 22): «Nous avons trouvé nos pères pratiquant ce culte, et nous nous guidons sur leurs pas.»
L'imitation a jeté au vent la créature.
Que cette imitation soit deux cents fois maudite.'
(MESNÉVI)
«On ne peut poser en aveugle ou par simple imitation le pied sur cette route pleine de dangers, sur ce chemin dans lequel ceux-là mêmes qui sont près du trône de Dieu, ceux-là qui marchent en connaissant les périls du voyage, s'écrient en gémissant de peur de glisser ou de faire un faux pas: «[Viens à mon aide] ô Toi qui montres leur route à ceux qui errent!» sur ce sentier dans lequel les prophètes, les envoyés, les inspirés crient avec la pire angoisse (Q., VII,149) : «O mon Dieu! ne nous fais pas aller grossir le nombre des méchants 1» Que je sois un païen si, tant que tu ne te décideras pas à abandonner l'imitation de tes pères, tu sens seulement le parfum de la religion!»
«Dans ce désert hérissé de dangers, dans cet océan sans limites où le voyage épouvante et dont les routes sont inconnues, il ne faut pas écouter les avis de ceux qui, liés encore par leurs passions et enveloppés dans le filet des plaisirs et de la joie, prétendent diriger les hommes à l'aide des déductions de la dialectique ou des arguments de la philosophie. Il ne faut pas croire aux paroles de ceux qui n'ont acquis la science que dans un but de prééminence (126) en ce bas monde, il ne faut pas les imiter non lus que ceux qui ont fait de l'abstinence et d'un extérieur misérable des rets pour prendre le vulgaire (127). P
«Or, Dieu a placé en chacun de nous le signe de sa connaissance, le miroir de l'intelligence qui réfléchit les rayons du soleil de sa science, de façon à ce que celui qui lutte avec lui-même puisse à l'aide de cette lumière éblouissante, de cet éclat limpide, devenir à son tour l'Orient où se lève l'astre de la connaissance et de l'union, le point où apparaît le soleil de l'Humanité et de l'Unité.»
«Aussi faut-il que chacun de nous se sépare de son moi, de sa sensualité, et se détourne définitivement des joies, des désirs et des passions. Alors, plein du constant désir de s'unir à l'essence de Dieu, l'implorant à tout instant, qu'il fasse la guerre sainte avec lui -même, qu'il saisisse avec vigueur la corde solide de la recherche et de la lutte avec soi-même, et alors qu'il se lance avec courage vers les diverses stations de la route: qu'il pose avec sincérité et loyauté son pied dans le sentier de l'enquête et de la poursuite du but, jusqu'à ce qu'il arrive enfin à un endroit où la Divinité l'aidant et l'assistant le fera parvenir jusqu'à Celui qui est Celui en qui l'on peut voir Dieu, le siège des inspirations du Tout-Puissant.»
«Il n'y a personne d'exclus de cette arrivée au bien suprême, à la station auguste. Tous sont appelés à purifier la créature, et à briller de l'éclat de l'humanité. I l suffit, pour cela, de reconnaître, à l'époque où il se manifeste, le Représentant de Dieu sur la terre. Il faut donc que l'homme qui entreprend la lutte avec lui-même détourne ses regards de tout ce qui n'est pas Dieu: il doit lier son coeur à l'espoir de la miséricorde céleste et se délivrer des instincts animaux et des passions humaines. Qu'il fasse abandon de son moi et plein de courage, qu'il entre dans le terrain de la recherche, afin d'arriver à ce bien élevé ; alors il .comprendra la vérité de ce verset (Q., XXIX, 69) :
Nous dirigerons dans nos sentiers ceux qui auront lutté dans notre cause.
«Quand l'homme est parvenu à cette élévation, quand il connaît Dieu en vérité, il doit, soit en remerciement de la miséricorde qui l'a conduit si haut, soit à cause de la perfection de son humanité, aviser, autant qu'il lui est possible, ceux qui sont sur la route de la recherche, des divers degrés qu'il a parcourus, et les retirer ainsi de l'erreur et de l'égarement.»
«C'est en vertu de ce principe que j'ai cru devoir résumer sous forme d'histoires les connaissances que j'ai acquises au cours de mon voyage en Perse à travers les diverses branches de l'Islam. Peut-être la lecture de mon livre fera-t-elle évanouir les différences et les erreurs absurdes et reconnues qui règnent parmi les Musulmans. Peut-être abandonneront-ils quelques-unes des calomnies et des accusations sans fondement qu'ils se lancent à l'envi les uns des autres, comme par exemple de déclarer impures telles personnes dont le meurtre devient, à leurs yeux, obligatoire; comme encore de considérer, en vertu du même principe, le vol des biens et l'assassinat des personnes comme licites ou bien enfin l'horreur qu'ils s'inspirent les uns les autres quand ils sont mouillés. Peut-être disparaîtront ces hypocrisies et ces discordes causes de leurs inimitiés et de leurs meurtres communs. Puissent-ils comprendre enfin et se réunir dans une discussion où régneront des deux côtés la loyauté et la sincérité: alors. Ils feront disparaître d'au milieu d'eux les différences qui les séparent; alors ils verront renaître la paix et la concorde ; alors ils ne se lanceront plus l'anathème, ne se considéreront plus comme impies, athées et impurs, ainsi qu'ils le font aujourd'hui, sans rien comprendre et sans rien savoir!»
«Après avoir voyagé en Europe et aux Indes, après avoir visité tous les peuples, examiné toutes les religions, je commençai mon voyage en Perse. Je n'avais pas l'intention de rester bien longtemps dans ce pays, mais les événements en décidèrent autrement. J'y restai donc de longues années, entretenant un commerce d'amitié avec des personnes de tous les genres, des docteurs en théologie, des chefs militaires, des savants... ou des ignorants. D'aucuns, me croyant chrétien, m'invitaient à abandonner la religion du. Christ pour embrasser celle de Mohammed, mais d'autres me considéraient comme leur coreligionnaire et ne trouvaient aucune différence entre leurs opinions et les miennes. Je constatai bien des sectes diverses et des branches différentes dans l'Islam, tels que les Chéikhis, les Moutécherréhis, les soufis, les sunnis, les chiés, les contemplatifs, les philosophes. Les derviches, les Nossaïris, les babis. J'eusse penché à embrasser l'une de ces doctrines, mais mon intelligence ne s'y pouvait résoudre. En effet, si le Qoran est un, et s'il contient les ordres mêmes de Dieu, d'où viennent ces diversités d'avis, ces règles différentes, ces sentences contradictoires? J'eus beau chercher, je ne pus trouver deux oulémas d'accord, deux Moujtéhéds du même avis. J'entendais sans cesse répéter : «mon humble opinion est que...» ou bien : «tel illustre savant a décidé que...» sans qu'il fût jamais question de l'ordre même de Dieu !»
«L'onde pure de la loi religieuse islamique a été tellement souillée par leurs disputes et leurs contradictions que le nom seul en est resté. I1 ne discutent plus que sur les menstrues ou les suites de l'accouchement au point de vue rituel. Pureté ? Impureté ? On ne peut leur tirer un mot intelligent, une pensée scientifique. Ah! j'en jure par Dieu, il semblerait que ces lois pures, que cette religion rafraîchissante Dieu les ait, -dans sa miséricorde, fait couler comme une pluie bénie afin que l'humanité pût venir se désaltérer à cette onde de sa connaissance et se délivrer à jamais du feu de l'ignorance. Cette pluie se serait réunie dans un endroit formant une étendue d'eau fraîche et pure. Mais voilà que des grenouilles y sont venues demeurer et y procréer des enfants. Chacune s'est considérée comme propriétaire d'une petite partie de ce lac, comme prince d'une partie plus grande. Puis ce fut la lutte, à qui serait le chef, le souverain ! Petit à petit, cette onde fraîche et cristalline, elles l'ont rendue tellement corrompue et puante que la nature elle-même a un sursaut de dégoût en l'apercevant. Cependant les grenouilles de cette voix charmante qu'on leur connaît invitent de près et de loin les hommes à venir se désaltérer à ce cloaque et leur indiquent la route pour pénétrer dans cette loi dont ils prétendent même donner des preuves. Ils crient, ils envoient des missionnaires partout qui disent: «Là est l'eau de la vie 1 là est le capital de la béatitude éternelle !» Et voilà que de chaque pays; de chaque nation, ceux qui sont à la recherche de la vraie route, les assoiffés du désert de la lutte avec soi-même accourent, pleins d'une espérance frémissante ! Et lorsque arrivés, ils contemplent un spectacle qui est le contre-pied de leurs espérances, il s'en retournent, en criant:
Ah ! si en ce bas monde le véritable islam est ceci,
Que l'infidèle a raison de rire mille fois du musulman 1 (Sénahi).
«Et cependant, s'ils voulaient être sincères et loyaux, oublier leurs discordes; il se pourrait que ce ruisseau coulât de nouveau limpide, désormais purifié.»
«Ils (les Persans) doivent se débarrasser de vices qui sont cachés dans les fibres les plus profondes de leur être, s'ils veulent être agréables à Dieu et à tous les prophètes, s'ils désirent le progrès de leur religion, la splendeur de la loi qoranique, la prospérité, la liberté de leur pays, de leur nation, l'augmentation de la puissance et de la majesté de leur gouvernement. Mais ils sont, tellement habitués à ces vices qu'ils sont devenus pour eux, une seconde nature, au point qu'ils ne les considèrent plus comme le moindre mal dans leurs consciences, alors qu'ils les blâment dans les autres sans se rendre compte qu'ils sont en eux. Ils ressemblent en cela à ce mollah qui disait à l'un de ses amis : «S'il se trouve en moi un défaut dont je ne me rende pas compte moi-même, mais que toi tu peux constater, dis-1e-moi, afin que je m'en débarrasse.» L'autre lui répondit : «Je ne vois en vous qu'un seul défaut : c'est que vous vous serviez trop souvent d'expressions injurieuses.» -»Quel est l'infâme personnage qui prostitue sa femme qui puisse m'accuser ainsi? Quel mari de catin peut prétendre que je l'aie jamais injurié?» répliqua aussitôt le mollah.»
«Quelle chose extraordinaire qu'en parlant ainsi ce mollah, sans s'en rendre compte, démontre trois vices ancrés chez lui ! D'abord l'injure et l'habitude invétérée d'injurier, ensuite le peu de connaissance qu'il a de lui-même; enfin il nie ce qu'il fait, et il accuse de mensonge ceux qui le constatent.»
«Bref, le vice qu'on doit flétrir avant tout, et qui est la tête de tous les vices, c'est le mensonge. Or, le mensonge est le souverain maître en Perse. Il est tellement répandu, il est tellement en usage que la loyauté et la sincérité ont totalement disparu. C'est là la cause de l'abandon de la loi religieuse; c'est par lui que les affaires du gouvernement et de la nation sont dans le plus profond désordre. Le mensonge des hommes de confiance, des chefs et des fonctionnaires du Gouvernement désorganise l'Empire, sape les bases de la grandeur du souverain et ruine le crédit de l'État. Le mensonge des docteurs de l'islam et des oulémas fait disparaître le respect pour la loi religieuse et détruit les assises de la religion et des lois. Le mensonge des sujets, du vulgaire, s'oppose au progrès et avilit la nation.»
«C'est parce qu'ils sont débarrassés du mensonge que les autres peuples et les autres religions, ceux qui vivent en Europe ou aux Indes voient croître chaque jour la prospérité et la liberté dans leur patrie, la tranquillité du peuple, le progrès du commerce, de la richesse et de l'honneur de la nation. Et ces quelques misérables (les Persans), à Pause de leur déloyauté, de leurs mensonges, voient de minute en minute précipiter leur décadence. Et ils sont tellement souillés, tellement tourmentés, si misérables et si préoccupés qu'ils ne peuvent même pas le comprendre...»
«...Enfin, quoiqu'ils aient compris les produits du mensonge, qu'ils les aient constatés, vus et entendus, ils n'en abandonnent en rien l'habitude et n'arrachent pas ce vice de leurs entrailles :
Ceux qui ont agréé les actions mauvaises,
Je ne sais ce qu'ils ont trouvé de mal dans le bien.
(Saadi, Boustan).
«Il est cependant écrit de façon nette et précise dans leurs livres de hadis qu'on demanda un jour à imam Djaafer ous-Sadeq (6° imam) : «Vos sectateurs se livreront-ils par la suite aux actes défendus ?»
«Oui, n répondit l'Altesse.
«Se livreront-ils à la luxure et à la pédérastie ?»
«C'est probable.».
«Boiront-ils du vin et se livreront-ils au meurtre ?»
«C'est possible.»
«Se livreront-ils au mensonge ?»
«Ceci est impossible,» affirma l'imam.
«Et voilà que les Persans se prétendent les sectateurs: de cet imam et ne consentent pas à abandonner le mensonge. Ils savent que dans tous les livres divins et dans le Qoran Dieu a maudit les menteurs : et les petits mensonges de la vie courante ne leur suffisant plus, ils ne craignent pas d'inventer, ainsi que nous le verrons par la suite, les mensonges les plus odieux dans la religion même :
Cette parole sera largement commentée
Dans un autre passage de ce livre. (MESNÉVI).
«Le grand mal du mensonge est qu'il devient une seconde nature chez celui qu'il a pénétré et conquis. Là où il s'est installé ainsi il se multiplie à l'infini et donne naissance à une nombreuse progéniture. L'un de ses produits est l'hypocrisie, qui est en quelque sorte un blasphème et un polythéisme. L'hypocrisie renverse les colonnes d'appui de la religion ainsi que le dit le Sceau des prophètes: «Je n'ai à craindre pour ma nation ni l'impiété ni la foi, mais je crains les hypocrites, dévots en apparence, impies au fond du coeur. Le vrai sens du mot «koufr»(impiété) c'est cacher le droit, la vérité. Cela s'entend cacher même une parcelle, un atome de la vérité de Dieu ou de la vérité de la créature, car cacher Dieu lui-même dont le nom est si élevé et qui resplendit plus splendidement que le globe solaire, il est évident que cela est impossible. L'impie est donc celui qui ne reconnaît pas et ne loue pas la vérité de Dieu, la vérité de l'homme. Or, le germe de l'impiété est disposé en chacun de nous car le musulman sincère est celui qui croit à la Vérité de Dieu, aux maîtres dé la Vérité, et rend, ainsi qu'il le faut, à chacun ce qui lui est dû. C'est-à-dire que ni par paroles ni par actions, il ne doit léser autrui. Mais vraiment ceux-là qui dépouillent grands et petits, qui déchirent le léger tissu de l'honneur de leurs semblables, qui s'emparent des biens d'autrui, qui rendent des sentences iniques et déclarent impies et dignes de mort des esclaves de Dieu, je ne comprends pas comment ils puissent un instant se considérer comment musulmans.
Si l'islamisme est ce que pense Hafez, c'est le fils du mage, c'est le prêtre du feu qui a raison.
«Vraiment si quelques-uns d'entre les hommes s’examinaient d'un oeil loyal et perspicace et s'apercevaient de leur impiété interne, de leur polythéisme intime, ils n'oseraient plus qualifier personne du titre d'impie. C'est la faiblesse et la lâcheté envers soi-même qui engendrent ces vices cachés ou apparents, cette amertume et cette perfidie dans ce monde et dans l'autre. Et c'est l'ignorance parfaite, l'imitation servile qui empêche de constater cet état et d'en saisir les causes.
O mon Dieu montre-nous la voie du salut éternel, Afin que nous reconnaissions le bien d'avec le mal.
O Dieu, donne-nous la force de nous purifier.
Afin que nous distinguions le but de droite d'avec celui de gauche.
«Maintenant que nous avons montré et prouvé que l'impiété consiste essentiellement à ne pas reconnaître les droits et la vérité, il ressort de cette constatation que l'hypocrisie est un polythéisme caché. Les hypocrites sont ceux dont le coeur et la langue, les actes et paroles ne concordent pas. Leur apparence est pieuse, et dans leur coeur règne l'impiété. Ils se vêtissent du harnais de la dévotion pour tromper Dieu et les hommes par leurs ruses et leur astuce.
Extérieurement c'est au sépulcre d'impie tout orné.
Mais à l'intérieur règne le châtiment de Dieu., En apparence il se raille de Bayazid.
Mais en lui-même il approuve Yézid.
(MESNÉVI)
«Si quelqu'un fait remarquer: «Tromper l'homme est facile, mais comment tromper Dieu ?» Je répondrai oui, tromper Dieu est impossible, mais admire ces imbéciles qui par des ruses légales veulent tromper Dieu, le plus habile des trompeurs (Q. III,47;VIII,30). Et comme ils cherchent à modifier les règles et les limites tracées par le sceau des prophètes ! N'as-tu pas entendu dire, n'as-tu pas vu de tes yeux comment et combien des gens à l'extérieur dévôt ont su uniquement s'emparer des biens et des richesses de leurs semblables et ne disent-ils pas que ces richesses sont un bien bien acquis en vertu du contrat d'échange ? «Ab uno disce omnes.»
«Dans mille affaires, dans mille transactions, dans mille discussions ne forcent-ils pas celui qui a tous les droits à les céder contre un bien illusoire ? Si je voulais les décrire tous ces moyens qu'ils emploient; cela ferait des volumes si gros que quarante chameaux surchargés n'en pourraient supporter le faix.
«Avec cette seule formule : «J'ai échangé, - j'ai accepté,» qui a cours aujourd’hui, ils veulent tromper Dieu et les hommes! Ils ruinent, ils tuent le droit des gens ; ils détournent leurs yeux de l'humanité, de Dieu, de la Vérité. C'est là le vrai polythéisme, c'est là donner des compagnons à Dieu.
«Sois franc et examine. Une femme a à réclamer une dot de mille tomans à son époux, ou bien une soeur à son frère, en vertu de droits successoraux. Après mille discussions, de nombreuses séances du tribunal, elle ne peut arriver à obtenir justice. Elle est alors forcée de faire une cote mal taillée et. d'accepter cent tomans pour solde de compte. Est-ce que par hasard les neuf cent tomans restants seraient un bien bien acquis pour le débiteur? Est-ce que, réellement, il ne doit plus rien ? Eh bien, des jugements de ce genre les oulémas les acceptent, que dis-je? ils les sanctionnent. Crois-tu que Dieu les agrée ? Crois-tu qu'ils sont conformes à la justice et à l'équité ?»
«Voici un saint homme qui doit donner un cinquième de son superflu aux descendants du Prophète: mettons qu'il s'agisse de cent tomans. Le voilà qui, met cette somme dans un pot qu'il remplit ensuite de beurre, de lait caillé ou de miel : puis il en fait don à un pauvre Seyyéd. Mais à peine l'a-t-il donné qu'il le rachète aussitôt à vil prix à ce pauvre qui ignore ce qu'il contient! Ils en agissent autrement encore: ils donnent à un pauvre descendant du Prophète un toman, à la condition qu'il l'accepte pour cent. C'est avec ces ruses hypocritement légales qu'ils se moquent de Dieu et se croient quittes envers lui!»
«Ils s'emparent uniquement du bien d'autrui à l'aide de la formule d'échange et ont l'esprit bien tranquille : ils ne croient pas le moins du monde qu'il leur sera demandé compte de ces actes au jour du jugement dernier. Ils se croient sauvés ! Et cependant ils reconnaissent et acceptent cette parole bénie :
«Les contrats doivent être au gré de ceux qui les font.»
«Ils ne peuvent donc dire qu'ils ne comprennent pas l'esprit de cette manière de procéder. Cela ne les empêche nullement qu'ils s'imaginent par leurs ruses légales se rendre licite ce qui appartient à autrui. Ils sont comme ce voleur qui apporta à sa mère un linceul bien acquis.»
«Ce voleur avait sa mère malade: sur le point de mourir, la pauvre femme pria son fils de lui apporter un linceul qui fût bien acquis. Le fils promit de le faire et à minuit sortit de la maison pour aller à la recherche de l'objet en question. Il se mit en embuscade au coin d'une route. Un pauvre diable attardé vint à passer. Le voleur s'élança, sur lui, arrêta son âne et, par la violence, s’empara du bissac. Il l'ouvrit, et au milieu de diverses autres choses, il trouva quelques mètres de toile. Plein de joie, il remercia le Seigneur «Gloire à Dieu qui ne m'a pas désespéré ! qui m'a permis de ne pas rentrer les mains vides à la maison et de ne pas avoir honte vis-à-vis de ma mère !» Puis de toutes ses forces il frappa: sur le malheureux propriétaire de la toile en lui criant: «Du fond de ton coeur, il faut que tu me reconnaisses propriétaire légitime de cette toile.» Enfin, il rentra chez lui porteur de l'étoffe. Il raconta tout à sa mère en ajoutant. «Je l'ai tellement frappé et si fort qu'il hurlait et que plus de mille fois il a crié à travers ses larmes et ses gémissements : Que cette toile te soit licite ! que cette toile te soit licite !»
L'hypocrisie a tellement pénétré la nature intime des Persans qu'il semblerait que la chair qui les compose a été mêlée et pétrie avec ce vice. L'envie, la haine, la fourberie, la trahison sont les quatre éléments constitutifs de l'hypocrisie: voilà d'où vient que la nation est perpétuellement en butte à tous les maux et plongée dans l'abjection, voilà pourquoi deux Persans ne peuvent être d'accord ni liés d'amitié. Leur hypocrisie, leur manque d'union, leur désaccord les jettent en proie aux misères et à l'avilissement. S'ils s'associent par hasard, c'est pour 6 mois, et durant 6 années, c'est la discorde, la lutte, la haine! L'amitié, la concorde, ils les ont rayées des choses de ce monde ne songent qu'à se martyriser, à se ruiner l'un l'autre. Ah ! ils n'oublieront pas un atome de violence et d'injustice. L'injustice découle au second degré du mensonge et descend de l'hypocrisie. Elle boit le lait du sein de sa mère, l'hypocrisie, elle profite de l'éducation de son père, le mensonge: voilà pourquoi l'enfant est si bien venu ! Dès qu'il peut marcher, il marche, ruine et anéantit toutes les provinces sur lesquelles il pose le pied. En Perse, l'injustice règne en maîtresse souveraine et absolue, et les autres vices lui prêtent le serment d'obédience. L'obéissance empressée qu'on lui prête, l'habitude que l'on en a prise font qu'en vertu de ce hadis,
«Les hommes suivent la religion de leur roi, - tous ceux qui lui obéissent l'acquièrent à leur tour, la font leur. Ils y sont aussi intimement liés»
Que le rossignol à la rose,
Que le papillon au flambeau.
Quoique l'intensité de ce feu brûle et anéantisse leurs plumes et leurs ailes, ils ne songent pas à fuir l'incendie : sans peur, sans hésitation, semblables au papillon, ils tournent sans cesse autour de la fournaise - on croirait voir des phénix aimant à alimenter la flamme du bûcher.»
«L'injustice ressemble à la fièvre étique qui s'empare des existences. Quoique la vie de ceux qui en sont atteints s'affaiblisse d'instant en instant et s'anéantisse, ceux-ci, par insouciance, pensent que leur état s'améliore de jour en jour. Les médecins loyaux, les praticiens sincères leur interdisent le mensonge et l'hypocrisie qui sont les causes originelles de leur maladie, mais ils en deviennent d'autant plus avides car, comme le dit le hadis,
L'homme aime ce qui lui est défendu.
«Les prophètes, les saints étaient des médecins sincères et véridiques: ils étaient envoyés pour appeler les hommes à Dieu et n'avaient d'autre but que d'instruire les créatures et de leur montrer la voie du salut. Ils voulaient délivrer l'humanité de cette maladie: aussi les nations ignorantes et stupides ne songèrent qu'à les opprimer, qu'à les violenter, qu'à les martyriser, qu'à les tuer, qu'à les brûler ou qu'à les pendre ! La plume se refuse à retracer les abominations dont elles furent coupables à l'égard de ces êtres si purs.»
«Ces vices produisent donc l'ignominie et l'abjection : ils sont causes de l'amertume en cette vie et dans l'autre: c'est pourquoi je dirai ici quelles sont les qualités qui peuvent être les instruments du progrès du gouvernement et de la nation, en même temps que ceux de la tranquillité du peuple. Ce sont: 1`amitié, l'affection, les moeurs douces, l'union.»
«Et si je voulais énumérer ici, ainsi qu'il le faudrait, les profits et les avantages que procurent ces qualités, ma vie n'y suffirait pas. Qu'il suffise de savoir que la signification vraie du mot «amitié» n'est pas l'amour que l'on peut' avoir pour sa femme, ses enfants, ses proches, ses concitoyens, ce n'est pas non plus la mansuétude et la bonne volonté à leur égard. Être homme, c'est marcher avec les fils d'Adam sur les plus hautes cimes de l'amitié et de l'union ; c'est ne pas fouler aux pieds, ne fût-ce que d'un pas, en ce qui concerne ses semblables, le terrain de l'égoïsme, c'est ne contrister ou blesser soit par geste soit par parole aucun être vivant,
Pas ni ïme une fourmi traînant une graine.
Car elle a la vie et la vie est douce et bonne.
(SAADI)
«Il ne doit mépriser aucun être, n'en considérer aucun comme inférieur à lui. Qu'il ne s'arrête pas à considérer les apparences mauvaises des actes de qui que ce soit : qu'il pense simplement que cette créature sort des mains de Dieu. Car si le mal était absolu, si son existence n'était pas nécessaire dans ce monde de possibilités, Dieu ne lui donnerait pas gratuitement l’aliment et la force, l'âme et l'esprit, et ne le revêtirait pas du manteau d'honneur de l'existence, des vêtements de la création. Celui-là qui connaît et la route et la marche de l'humanité, qui recherche la science et la compréhension des choses, ne repoussera aucune créature, n'en considérera aucune comme mauvaise. Jésus se trouvait un jour sur une route avec quelques-uns de ses compagnons. Ils rencontrèrent une charogne puante de chien: ses compagnons furent dégoûtés de l'odeur épouvantable qui s'en dégageait. Jésus leur dit : «Pourquoi ne considérez-vous que la mauvaise odeur de ce corps mort: voyez comme il a les dents blanches, et songez combien, de son vivant, il était respectueux des droits de son maître et se contentait du peu qu'il avait.»
Soyez bienveillants dans vos regards,
Si vous êtes des gens de coeur.
«Cependant certains hommes au lieu de ne croire aucune partie du monde essentiellement mauvaise, au lieu de chercher à s'amender, à perfectionner les lois, à parfaire leur bienveillance vis-à-vis d'autrui, ne songent dans leur imbécillité et leur ignorance qu'à calomnier leurs semblables. Ils sont prompts à dire : les idées religieuses d'un tel sont perverses, tel autre est impie et maudit, celui-ci est réprouvé, celui-là est damné : il faut se garder d'avoir le moindre rapport avec ce dernier, quand pour une cause quelconque ses vêtements ou ses mains sont humides 1 Pour eux, tuer, torturer, briser les coeurs est obligatoire. Et tout cela ne vient pas d'autre chose que de la violence de leur égoïsme. Ah ! l'injustice est le plus odieux de tous les vices, et chaque nature dans laquelle elle a pénétré perd toutes ses bonnes qualités et ce qui fait l'apanage de l'homme. L'orgueil, la vanité, la fierté, la présomption les remplacent et ce sont là les quatre colonnes qui soutiennent l'injustice : c'est cet égoïsme qui les éloigne des matières intellectuelles et les a rejetés loin, loin du monde divin. Aussi n'ont-ils pas même senti le parfum de la lutte avec soi-même et de l'effort dans la vertu, qui sont les causes du développement de la grandeur de l'État et de la puissance nationale. Leur immense orgueil les a fait rester inébranlables dans leur dédain et leur mépris des autres esclaves de Dieu, et cet égoïsme féroce leur rend amer le séjour en ce bas monde et dans l'autre. Il s'ensuit que, contrairement à ce qui se passe pour les autres États et les autres peuples, les Persans sont dans une décadence perpétuelle. Mais comment accordent-ils leur orgueil avec ce hadis authentique et que chacun d'eux répète à l'envi?»
«Dieu, un jour dit à Moïse : Choisis dans ce monde quelque chose qui te soit inférieur et apporte-le près de moi. Moïse chercha longtemps et partout et finit par rencontrer quelque part le cadavre puant d'un chien. Il pensa avoir trouvé ce qu'il cherchait, prit une corde, l'attacha à la patte de la charogne et la tira l'espace de quelques pas. Mais soudain, éclairé par la pureté intime de son âme, il s'arrêta, réfléchit et songea: «Peut-être pour une cause quelconque, pour une raison que j'ignore; ce chien n'est-il pas inférieur à moi aux yeux de la Divinité ! Quel courage avais-je donc pour me croire supérieur à cette charogne et quelle preuve en eus-je pu donner ?» Il lâcha aussitôt la corde et entendit une voix irritée qui l'interpellait : «O fils d'Imram, disait cette voix, si tu eusses fait un pas de plus en traînant ce cadavre, tu eusses immédiatement été destitué du rang de prophète».
Puis Dieu cacha dans l'âme intime de Moïse
Des secrets que l'on ne peut dire.
Il versa dans son coeur des paroles
Qui confondent et la langue et la vue. Il devint éperdu puis il revint à lui
Et fit un pas, de l'éternité qui n'a pas
De commencement vers celle qui n'a pas de fin.
(MESNEVl)
«Quel mystère qu'un Moïse, l'un des plus grand. prophètes, qui est décoré du titre de Kélim Ouliah, n'ait pas cru devoir se considérer comme supérieur à une puante charogne de chien 1 Et voilà que ces Persans ignares se croient au-dessus de tous les hommes de l'Univers. Ils vont même jusqu'à s'estimer meilleurs et plus hauts que Moïse ! que dis-je ? ils en donnent une preuve en s'appuyant sur ce hadis :
Les oulémas de ma doctrine sont supérieurs aux prophètes des Hébreux.
«Dès lors, ils considèrent tous les autres hommes comme au-dessous de cette charogne et sont entrés délibérément dans la route de l'inimitié et de la haine, volontairement ils se sont privés des fruits de l'amour et de la bienveillance. Mais ce qu'ils ont semé ou sèment en ce moment, ils le récoltent et le récolteront. S'ils ne comprennent pas que chacun supporte les conséquences de ce qu'il fait, que chacun mange les fruits de l'arbre qu'il a planté, Hafiz leur dit :
Comme ce vieux villageois a bien dit en parlant à son fils
O lumière de mes yeux, tu ne récolteras
que ce que tu auras semé !
Ah ! les Européens ont compris ce que veulent dire ces mots : «l'amitié», «l'union» ... «...Le Sadr A'azam voulut faire profiter la Perse de tous ces biens, mais les Oulémas s'y opposèrent- Ils levèrent l'étendard de la révolte et crièrent au peuple : Si les Européens viennent en trop grand nombre dans notre pays, notre sainte religion sera atteinte, et les Musulmans s'imprégneront d'idées européennes,- ce qui est le plus sûr moyen d'être damné. En réalité, ces prêtres craignaient que les yeux du peuple s'ouvrissent et que celui-ci, ayant enfin compris, les abandonnât. Aussi, pour défendre leur cause présentèrent-ils une foule de preuves et d'arguments : de leur arsenal ils firent sortir des hadis comminatoires et anathématisèrent le Sadr A'a~am. Pour rester les maîtres, ils n'admirent pas que cette nation qui pleure et qui souffre depuis mille ans pût enfin trouver un instant de repos.»
«Un Persan intelligent et aimant ses compatriotes, souffrant de leurs douleurs voulut les éveiller et les instruire. Il écrivit une brochure, mais par malheur elle ne s'est pas répandue car la vérité est amère. Les explications qu'il donnait quoiqu'elles fussent douces parurent insupportables aux adversaires. Aussi, sans se soucier du but que poursuivait l'auteur, sans rien examiner, sans réfléchir à l'esprit du livre, ils l'anathématisèrent! Il est plus que probable que la brochure que j'écris aujourd'hui aura le même sort, mais en vérité, je ne suis pas d'ici et me soucie fort peu que l'on m'agrée ou me repousse :
Je ne suis pas disciple d'un cheikh ni élève d'un prêtre.
Gloire à Dieu! je suis loin de toute secte.
«Cependant, si je, blâme des actions basses et viles, si je flagelle l'iniquité du Gouvernement ou l'état de sauvagerie du peuple, si je flétris le fanatisme des oulémas, Dieu m'est témoin que je n'attaque aucune personnalité, que je ne suis l'ennemi d'aucune secte. Mon but est, au contraire, que la lecture de mon livre fasse naître dans l'âme de mes lecteurs le courage, le zèle et la générosité; qu'elle leur démontre l'infamie de vices honteux et d'actions mauvaises : qu'ils s'en éloignent à tout jamais...»
«Bref, l'auteur de la brochure dont j'ai parlé plus haut y expliquait que la nation persane peut comprendre, s'assimiler et pratiquer la science, qu'elle est digne en un mot de se civiliser. Il y disait aussi que malheureusement les chefs, afin de garder leur pouvoir, ne permettaient pas au peuple d'ouvrir les yeux et les oreilles et de reconnaître enfin le bien du mal. Après avoir démontré tout cela dans son livre et en avoir donné des preuves péremptoires, il ajoutait ceci : chaque fonctionnaire du Gouvernement, chacun des oulémas de la nation a dans le corps de l'Empire une sorte de commandement. Or le Ministre des .affaires étrangères est la sentinelle avancée, le gardien des remparts.
Un jour de bon matin, quelqu'un frappa à la porte du royaume et demanda la permission d'entrer.
«Qui es-tu et que viens-tu faire ici? demanda le Ministre des affaires étrangères.
- Je suis, lui répondit-on la justice et la civilisation. Je suis venue pour fonder dans ce royaume la justice, pour y édifier la civilisation. J'y viens détruire les fondements du désordre et de l'iniquité.»
- Grâces en soient rendues à Dieu, dit le Ministre, notre royaume voit fleurir chez lui la justice la plus parfaite, la civilisation la plus avancée. Nous n'avons aucun besoin de l'aide de la justice.»
«L'interlocuteur, de derrière la porte, démontre au Ministre par des preuves et des arguments décisifs qu'il est réellement la justice et la civilisation. «Il y a bien longtemps, ajoute-t-il, que j'ai quitté ce pays pour aller visiter l'Europe où je me suis installée. Il y a plus de mille ans que je n'ai revu la Perse ni ses habitants, et que je n'ai foulé le sol de ce pays. J'ai appris que l'injustice aidée de sa soeur l'hypocrisie ont ici tout bouleversé, tout ruiné. Aussi j'accours par pure bienveillance pour vous faire progresser : je veux mettre tous mes efforts à tout réparer, je veux vous donner ce qui vous manque pour atteindre la civilisation. Ouvrez donc !»
«Mais le Ministre des affaires étrangères verrouilla plus solidement encore la porte et cria: «Notre pays n'a nul besoin de tes réparations. Dieu soit loué, nous avons des constructions solides, des palais élevés.»
-»J'ai apporté d'Europe les éléments des sciences et de l'industrie pour les répandre en ce pays. Je veux délivrer la nation de la misère, des souffrances et de la mendicité. Je veux, ainsi que je l'ai fait en Europe, la faire parvenir au bonheur.»
«Quel besoin avons-nous d'industries? répliqua le ministre. Ce que nous voulons, on nous l'apporte d'Europe et nous l'achetons. Si nos sujets s'enrichissaient, ils deviendraient insolents et rebelles.»
«La discussion fut longue et le Ministre dut s'avouer vaincu, aussi fut-ce avec la plus grande douceur qu'il, dut répondre : «Ce que vous dites est fort juste et bien vrai. Votre présence ferait prospérer le pays, donnerait la liberté à la nation : l'Etat et le peuple verraient croître leur puissance, mais que faire? Vous étant là je perds mon pouvoir et mes moyens d'existence. Je me verrais forcé d'abandonner mon bon poste ou de rester dans les limites qui me sont fixées; je devrais me contenter des appointements qui me sont alloués. «Comment faire désormais par an 200.000 tomans de bénéfices illicites et 100.000 tomans de dépenses ? De qui donc prendre désormais des pots fie vin? Comment emprisonner, enchaîner, tuer, pardonner, gouverner en un mot? Je me verrais dans l’obligation d'obéir aux lois, de me priver de l'arbitraire: je ne pourrais plus tourmenter sans raison mes compatriotes. Aussi, tant je vivrai, vous n'entrerez pas.»
«D'ailleurs, vous laisserais-je entrer que les grands du royaume vous empêcheraient d'y vivre une seconde. Ils s'uniraient tous pour vous qualifier d'ennemie de S. M. le Chah et l'on rédigerait mille sentences écrites qui toutes vous condamneraient à mort. Que ceux-ci ne le fassent pas, les oulémas se lèveraient comme un seul homme pour t'anéantir et faire disparaître ton nom des registres du destin. Oh ! pour ce faire, ils trouveraient 1,000 hadis indiscutables, 1.000 hadis sortant tous de chacune des bouches dont les paroles sont devenues des hadis ! T'enlever la vie est chose facile, mais ils déclareraient obligatoire pour les Musulmans de dévorer ta chair, de boire ton sang, et l'on déclarerait impur, et l'on condamnerait à mort quiconque prononcerait ton nom- Qu'on ne te laisse pas vivre en ce pays, ceci n'est rien, mais on tuerait quiconque serait de tes amis, quiconque aurait un penchant pour toi. Ne sais-tu pas qu'ils regardent comme leurs ennemis les Européens parce qu'ils croient que ceux-ci sont liés à toi : ils considèrent comme licite de les tuer et de les piller; s'ils massacrent les babis qui ont des opinions nettes et fermes c'est uniquement parce qu'ils te voient dans la pensée de ces sectaires. Si ce n'était pas là leur vraie raison, pourquoi laisseraient-ils tranquilles les Nossaïris et les Qoulat, qui d'après les oulémas sont de parfaits impies ? Il n'y a pas de danger qu'ils aillent tourmenter ceux qui sont hors leur religion, par exemple les onze branches des imamiyèhs, qui sont, d'après leurs oulémas, de parfaits infidèles. Que font-ils aux Sadéqiyèhs, aux Nadouciyèhs qui considèrent l'imam Djaafer comme le dernier imam, comme le Mehdi promis? Pourquoi ne font-il pas la guerre aux Moukhtariyèhs qui croient à l'imamat de Mohammed Hanefiyèh et sont par suite 100.000 fois plus mauvais que les babis ?»
=====================================
B. HISTOIRE DU BAB
I. LES DÉBUTS DU BAB, JUSQU'A LA MANIFESTATION
Seyyèd Ali Mohammed naquit à Chiraz le 1er Moharrem de l'an 1236 (26 mars 1821) (128). Son père Seyyèd Mohammed Riza, - fils de Seyyèd Ebrahim, qui lui-même était fils de Seyyèd Fath Oullah (129) était négociant dans cette ville.
Devenu orphelin de bonne heure, il fut placé sous la tutelle de son oncle maternel, A Seyyèd Ali, et s'occupa, sous sa direction, du même commerce que son père (130).
Il était déjà méditatif et plutôt silencieux cependant que sa jolie figure, l'éclat de son regard en même temps que son maintien modeste et recueilli attiraient dès cette époque l'attention de ses concitoyens. Très jeune, les questions religieuses l'attiraient invinciblement, car c'est à l'âge der19 ans (131) qu'il écrivit son premier ouvrage «le riçalèh Feqqiyièh» dans lequel il montre une vraie piété et une effusion islamique qui semblaient lui présager un brillant avenir dans les liens de l'orthodoxie chiite.
Il est probable que cet ouvrage fut écrit à Bouchir car c'est lorsqu'il avait 18 ou 19 ans qu'il y fut envoyé, par son oncle, pour les besoins de son commerce.
Les auteurs musulmans et les babis sont d'accord en ce qui concerne le séjour de notre héros dans le grand port du golfe Persique. Ils insistent les uns et les autres sur l'ardeur religieuse qui animait le jeune Seyyèd, le poussant à s'infliger les macérations (132) qu'exigent certaines règles monastiques. Les Musulmans affirment qu'il s'exposait de longues heures, la tête nue (133), aux rayons brûlants du soleil de ces régions, - ce qui, d'après certains soufis devait le mener à la connaissance des secrets de Dieu, - tant qu'enfin sa raison s'altéra (134).
La tradition rapporte que son séjour fut court (135), car il n'en put supporter le climat: il n'y serait resté qu'une année, et serait revenu à Chiraz, toujours préoccupé de méditations religieuses.
Après quelque repos il voulut, comme tout bon chiite doit le faire, se rendre au fameux pèlerinage de Kerbélah, et y accomplir les rites nombreux et compliqués qui accompagnent les visites aux tombeaux des saints imams.
Molla Sadeq, qui, plus tard, devait prendre le titre de Mouqaddès, Khoraçani se trouvait en ce moment aux lieux saints : voici comment il raconte ses entrevues avec le jeune Seyyéd:
«Un jour j'entrai dans la mosquée du confesseur de la Foi et j'y vis un jeune homme noyé dans ses méditations profondes : son attitude était telle, sa piété si évidente et si manifeste, les larmes qui coulaient de ses yeux si sincères, que je me sentis invinciblement attiré vers lui. Ne voulant pourtant point le troubler dans ses dévotions, je m'assis dans un coin et attendis la fin de ses prières. Plus je le regardais, plus j'étais conquis par son air noble, sa contenance modeste et un je ne sais quoi qui semblait se dégager de toute sa personne.
Il sortit enfin, et je le suivis : un domestique qui, je le sus plus tard s'appelait Mobarek, lui remit ses souliers et ils s'en allèrent sans que j'eusse pu, - retenu par je ne sais quelle honte, - les interroger.
Mais j'avais remarqué l'heure a laquelle nous étions et je résolus de revenir le lendemain à la même heure pour en avoir le coeur net.
Je le retrouvais, ainsi que je l'espérais, plongé dans ses méditations pieuses, et l'impression qu'il me produisit fut encore plus forte que celle que j'avais ressentie la veille».
Quand il eut fini, je m'approchai de lui en lui disant: «J'ai à vous parler». Mais il ne me répondit que par un signe que j'interprétai comme un refus.
Honteux d'un tel accueil, je sortis des limites sacrées en même temps que lui; mais à peine fûmes- nous dehors qu'il m'interpella et me pria de l'excuser s'il n'avait pas répondu à ma demande, considérant la mosquée comme un endroit trop sacré pour que l'on pût même y penser à des choses étrangères à la Divinité.
Il dit cela d'une façon si affable et si courtoise que je fus reconquis tout entier, et oubliant le léger ressentiment qui était, un instant, rentré dans mon coeur, je le priai, en sa qualité de compatriote et de pèlerin de vouloir bien me faire l'honneur de venir me voir chez moi un vendredi. - Ce jour-là, lui dis- je, notre saint professeur, Seyyèd Kazem Rechti, honore ma demeure de sa présence et je serais fort heureux que vous l'entendiez.
-Quel bonheur et quelle joie pour celui qui vient prendre place dans une réunion que d'y entendre mentionner la plus haute lumière de Dieu 1»(136) me» répondit-il.»
Ceci se passait un mardi. Le vendredi suivant, Seyyed Kazem vint chez moi, selon son habitude, accompagné de tous ses élèves. Les prières étaient déjà commencées, nous avions entendu les oraisons dites du haut du mimber par Molla Mohammed Bagher, et Molla Housseïn Bauchrouyéhi lui avait succédé : il développait du haut de la chaire des considérations sur le martyre de l'imam Housseïn quand Seyyed Ali Mohammed entra.»
«Je fus très surpris de voir Seyyed Kazem Rechti se lever dès qu'il aperçut celui qui venait d'entrer. Tous les assistants l'imitèrent naturellement. C'était là une marque de politesse assez banale en Perse, mais qu'on remarqua fort en ce moment comme étant contraire à toutes les habitudes du maître qui, pendant les prêches, ne prêtait la moindre attention aux arrivants, fussent-ils les personnages les plus les plus élevés et les plus puissants.»
«Mollah Houssein Bouchrouyéhi lui-même fut troublé et s'interrompit dans son sermon.»
«Celui qui suscitait une émotion aussi étrange parut ne pas s'en apercevoir, et s'assit modestement à la porte de la chambre(137).».
«Seyyed Kazem l'invita à s'asseoir à une place plus élevée, mais le jeune homme refusa et resta assis à celle qu'il avait choisie.»
«Le trouble une fois apaisé, Seyyed Kazem Rechti ordonna à Mollah Housseïn de réciter quelques vers de Cheikh Ahmed Ahçahi (138). Celui-ci obéit, et ces vers firent pleurer Seyyèd Ali Mohammed. Son émotion gagna la salle entière qui se mit à verser des larmes.»
«Les exercices pieux terminés, on apporta le thé et les sirops pour les assistants, mais Seyyed Ali Mohammed refusa de prendre quoi que ce fût.»
«Enfin Seyyed Kazem partit pour rentrer chez lui, suivi de toute l'assemblée. Nous restâmes seuls, le jeune Chirazi et moi. Je le priais alors de s'asseoir à une place plus digne de son rang : il se leva, et sans hésitation, alla se mettre à la place qu'avait occupée Seyyed Kazem. Je lui causai longuement alors : étant désireux de faire de lui une recrue cheikhie, je lui parlais de la doctrine de nos deux maîtres : je m'efforçais de le convaincre et de l'attirer dans notre secte, mais il ne répondit rien. Enfin, il se leva, prit congé et partit.»
«Trois jours se passèrent au bout desquels je rencontrai encore une fois le jeune Seyyed au tombeau de Imam Housseïn. Cette fois, ce fut lui qui m'adressa la parole: «Mon oncle vient d'arriver, me dit-il, ne viendrez-vous pas le voir?»
«J'y allai vers le soir, j'y rencontrai beaucoup de monde, tous nos compatriotes étant venus, suivant l'usage, rendre visite au nouvel arrivé.»
«A Seyyed Ali me fit asseoir à côté de lui pendant que son neveu, assis près du samovar, distribuait le thé aux hôtes de son oncle.»
«J'appris alors que A Seyyed Ali était venu à Kerbélah tant pour y faire un pèlerinage que pour emmener avec lui son neveu à Chiraz.»
«Je lui lis le plus complet éloge du jeune homme et lui dis, ce que je pensais d'ailleurs, que je n'avais jamais vu personne réunir d'aussi brillantes et d'aussi solides qualités de l'esprit et du coeur. «C'est vrai, me répondit le vieillard, mon neveu est remarquable à bien des points de vue, mais ce qui est une honte pour nous, c'est qu'il se refuse à suivre les leçons et les cours; il ne veut pas apprendre, et comme il ne fait rien ici, je ne veux plus l'y laisser.»
«Toujours désireux de faire de Seyyed Ali Mohammed un cheikhi, je discutai longuement avec l'oncle, et je finis par lui promettre que j'emploierai toute mon influence à le faire travailler et suivre les cours d'une façon régulière.»
«Devant mes instances et mes promesses, A Seyyed Ali voulut bien consentir à tenter l'expérience, et son pèlerinage terminé s'en retourna à Chiraz, laissant son neveu Kerbélah.»
En dépit des promesses que j'avais faites, je ne pus me décider à faire des observations au jeune homme qui ne reparut qu'une fois au cours de Seyyed Kazem. Malgré moi je me sentais intimidé par lui, et quoique je me reprochasse vivement mon manque de parole, je ne pouvais, arrêté par une inexplicable timidité, remplir le rôle que j'avais assumé.»
«Un jour j'appris qu'il `était parti pour Chiraz et petit à petit je cessai d'y penser (139)..»
Nous savons que le jeune Seyyed était devenu cheïkhi. Les Musulmans en effet, s'indignèrent de le voir rompre, dans ses visites aux tombeaux, avec le rite traditionnel, pour suivre la règle imposée par les deux cheikhs (140) : et lui-même, par la suite, éleva cheïkh Ahmed et Seyyed Kazem à la dignité de Précurseurs de la nouvelle manifestation, il se déclare d'ailleurs, à plusieurs reprises et dans toutes ses oeuvres, l'élève le plus humble du Rechti(7:41).
I1 rentra donc à Chiraz où il vécut dans sa famille. Qui nous dira les angoisses à travers lesquelles il dut passer, l'agonie morale qui précéda le cri de sa conscience en révolte contre les iniquités et les blasphèmes dont il avait été et était chaque jour le témoin?
Quoi qu'il en soit et pendant qu'il se préparait à son apostolat, Seyyed Kazem Rechti annonçait à ses disciples sa propre mort et l'apparition de la Vérité.
«Seyyed Kazem, raconte Moqaddès Khoraçani et avec lui les historiens musulmans et babi, avait, chaque année, l'habitude d'aller faire un pèlerinage à Sourré menréha. Cette année-là, il fit comme d'habitude ses préparatifs, mais un jour il annonça à ses disciples assemblés que c'était là son dernier voyage, son pèlerinage d'adieux. Et comme tous, frappés de stupeur, se mettaient à pleurer, Kérim Khan plus violemment que les autres, le vieux Séyyed se tournant vers lui, lui cria : «Chien ! tu ne veux donc pas que je m'en aille et qu'après moi se manifeste la Vérité absolue?»
Ce ne serait pas la première fois que le vieux maître aurait fait une allusion directe à la prochaine manifestation du Sahab ez-Zeman. I1 s'en occupait au contraire beaucoup, suivant Mirza Djani, et commentait les signes qui devaient accompagner son apparition. «Ce devait être un jeune homme, Hachémite et non instruit dans les sciences que l'on acquiert dans les écoles.» Parfois même il aurait dit: «Je le vois comma un soleil qui se lève.»
Hadji Abd oul - Mouttalèb Isfahani, Souleiman Khan Afchar Saïn Qaléhi l'ont raconté, et c'est peut-être là que ce dernier a puisé la conviction qui l'a soutenu jusqu'au dernier moment de son horrible mort:
Il aurait eu, en effet; l'habitude de dire : «Feu Seyyed m'a promis, à moi, que je verrai la manifestation du Sahab-ez-Zéman. Tu y seras, me disait-il, et tu donneras ta foi.»
Akhound Molla Houssein Bouchrouyéhi, qui était intime avec Kazem, lui demanda avec insistance comment aurait lieu la manifestation. Le Maître lui répondit par ces vers du Mesnévi : «Je ne puis en dire davantage, mais le Soleil de la Vérité; de quelque Orient qu'il se lève, illuminera tous les horizons, et les miroirs des coeurs de ceux qui aiment le bien, il les disposera de façon à ce qu'ils reçoivent les émanations de la lumière et de la connaissance.»
Mirza Djani, qui, ne l'oublions pas, est un des martyrs qui ont succombé après l'attentat contre Sa. Majesté ne pouvait être au courant des affirmations que l'histoire officielle a soulevées par la suite, Mirza Djani raconte qu'il vit dans la mosquée de Kouffa, la plupart des élèves de l'ancien Seyyed : «Il y avait là, dit-il, le Bouchrouyéhi, Molla Ali Bestami, Hadji Molla Mohammed Ali Barfourouchi, Akhound Molla Abdoul Djelil Tourk, Mirza Abdoul Hadi, Mirza Mohammed Hadi, A Seyyed Houssïn Yezdi, Molla Hassan Bedjestani, Molla Bachir, Mollah Bagher Tourk, Molla Ahmed Abdal avec quelques autres. Ils s'y occupaient de mortifications étranges et qui avaient lieu de surprendre.»
En effet, après la mort de Seyyèd Kazem Rechti survenue en 1259 (1843-44), ses disciples après avoir passé 40 jours à Couffa se mirent à chercher à travers le monde musulman son successeur.
Donc ils cherchaient un être supérieur, ou au moins égal à leur maître défunt. Avant de se séparer, beaucoup d'entre eux se jurèrent de se prévenir mutuellement de l'heureux succès de leurs recherches s'ils arrivaient à trouver celui que le Qoran et Seyyèd Kazem leur avaient indiqué. Parmi ces chercheurs, trois étaient unis d'une indissoluble amitié : c'était Molla.' Houssein Bouchrouyèhi, Moqaddès Khoraçani et Molla Ali Goher.
La tradition babie veut que deux années se soient écoulées entre le jour où Séyyèd Ali Mohammed quitta Kerbélah et le jour où il annonça au monde la mission dont il était investi; cela nous reporterait donc à l'année 1258, mais avant la mort de Kazem. Or si nous admettons qu'il arriva aux lieux saints à la fin de sa 19e année ou peut-être au milieu de sa vingtième, nous sommes obligés de reconnaître qu'il séjourna 2 ans et demi ou 3 ans à Kerbélah (142), puisqu'il n'avait pas tout à fait 25 ans le 5 Djemadi el Akher de l'an 1260.
Cela concorde parfaitement avec la tradition babie et détruit la légende musulmane qui voudrait que Seyyed Ali Mohammed ait été présent à Kerbelah lors de la mort du Rechti qu'il se soit entendu là avec un certain nombre des disciples du maître défunt et qu'après certaines simagrées destinées à frapper l'imagination du vulgaire ils se soient tous rendu à la Meqqe (143) pour y remplir les prophéties annonçant que l'Iman Mehdi devait sortir de la ville sainte, levant le sabre nu et appelant les peuples au vrai Dieu. Cette comédie ne peut cadrer avec ce que nous savons de positif sur l'histoire des diverses personnes qui furent mêlées à cette tragédie.
Une autre question est encore à examiner ici : celle du manque d'instruction du Bab. Tous les auteurs tant musulmans que babis affirment que Seyyèd Ali Mohammed n'apprit pas l'arabe (144). Seul, l'auteur du Qessas el Ouléma écrit : «Quand j'étais à Kerbélah j'allais au cours de Seyyèd Kazem : Mirza Ali Mohammed y venait avec tout ce qu'il fallait pour écrire et écrivait en effet tout ce que disait le professeur.» Je le veux bien, mais si notre héros était capable de suivre un pareil cours, de s'y intéresser et d'y prendre des notes, pourquoi nous le représentez-vous par la suite, aux fameuses séances d'Isfahan et de Tébriz, plus ignorant qu'un enfant, plus craintif qu'un agneau enfin, tranchons le mot plus bête... qu'il n'est permis de l'être au point qu'il est incapable de conjuguer le verbe arabe le plus simple. Qui veut trop prouver ne prouve rien et toutes ces contradictions ne démontrent... que la mauvaise foi des auteurs musulmans (145).
Nous sommes donc en présence d'une affirmation presque générale, d'un consentement presque univervel, le Bab n'a même pas étudié les éléments de la grammaire arabe, il le dit d'ailleurs, lui-même.
«Apprenez de moi mon ordre au sujet de mon Zikr. «En vérité, l'esprit l'a aidé dans toute chose avec la permission de Dieu et en vérité il n'y a pas d'autre dieu que Dieu, le Puissant, le Chéri».
«Donc quand l'âge de ce jeune homme arriva au moment où il est d'obligation de s'instruire dans les sciences, en vérité nous l'avons fait parvenir au Djeziret oul Bahr(146) par la tradition de Mohammed, prophète de Dieu d'auparavant. Et il n'avait rien appris de vos sciences auprès d'aucun d'entre vous. En vérité ! il était vis-à-vis de cette science comme s'il venait de naître de sa mère; il était étranger sur cette route. Il était Ahmedi, des atomes du prophète de Dieu qui était dans la science de Dieu.» Comment dès lors expliquer sa prodigieuse production littéraire? la réponse est des plus simples: Pour les babis, le Bab étant un prophète il s'est passé pour lui ce qui a eu lieu pour Mohammed, ce que nous admettons pour les apôtres : la descente du Saint-Esprit enseigna toutes les langues à ceux-ci, c'était Dieu qui parlait par la bouche du prophète arabe: les trois cas sont identiques, et pour celui qui a la Foi il n'y a pas de discussion possible.
Les musulmans, eux, disent simplement que le Bab eut des collaborateurs, et j'ai regretté de trouver les Européens exprimant la même opinion. Tout d'abord cette affirmation est contraire à la Vérité historique ce qui est un tort grave : nous voyons en effet, dans le cours de son histoire le Bab, traqué, poursuivi, enfermé seul et sa plume ne s'arrête pas. En second lieu quel est celui de ses disciples qui aurait mis ses oeuvres sous son nom : et pourquoi ? pour fuir une terrible responsabilité, car il ne peut y avoir d'autre raison; mais quand donc verrons-nous au cours de cette histoire l'un quelconque de nos sectaires hésiter - fût-ce une seconde - devant la conséquence de ses actes. Et quelle conséquence ! la mort dans les supplices. Se dérober au trépas pour s'y précipiter par une autre porte serait singulièrement ressembler à celui qui se jetait dans la rivière pour éviter d'être mouillé par la pluie.
Il n'y a donc que deux hypothèses à mettre en avant : ou Seyyèd Ali Mohammed a appris l'arabe durant son séjour de deux ou trois ans à Kerbélah - mais alors cela se serait su, et les Musulmans n'affirmeraient pas qu'il ne l'a pas appris (147) - ou bien il faut admettre la réalité d'un phénomène dont les causes profondes nous échappent.
Enfin, et pour en finir avec cette question, étant par moi-même incapable d'apprécier l'arabe de Seyyed Mohammed, et de le rapprocher - à son avantage ou à son détriment du Qoran, - j'ai sollicité l'opinion d'un arabisant de la plus haute valeur; S. E. Chems ed-dine Bey, ambassadeur de la Sublime Porte à Téhéran, en le priant de vouloir bien, me dire, en laissant de côté toute question religieuse, ce qu'il pensait de la langue du Bab. Il m'a déclaré avec beaucoup de chaleur et de sincérité qu'il la trouvait fort belle, fort élevée, quelquefois fautive, mais d'une grande poésie et d'une parfaite éloquence.
Ceci a été exactement l'avis de M. Houdas, professeur d'arabe vulgaire à l'École des langues orientales vivantes.
=====================================
II. LA MANIFESTATION. - LE PELERINAGE. - LE RETOUR A CHIRAZ. - L'EMPRISONNEMENT. - LE CHOLERA. - FUITE A ISFAHAN. - MORT DE MANOUT CHEHR KHAN. - ENVOI DU BAB A MAKOU
Cependant Seyyed Ali Mohammed réfléchissait longuement à Chiraz tant sur l'enseignement qu'il avait reçu à Kerbélah que sur la corruption au milieu de laquelle vivaient ces Mollahs et ces Moujteheds qui se faisaient de la religion un tremplin pour arriver à la fortune et aux honneurs.
Le spectacle des turpitudes, des hontes, des vices, du mensonge de ce clergé révoltait son âme pure et sincère : il sentait le besoin d'une réforme profonde à introduire dans les moeurs publiques et dut, plus d'une fois, hésiter devant la perspective de la révolution qu'il lui fallait déchaîner pour délivrer les corps et les intelligences du joug d'abrutissement et de violence qui pesait sur toute la Perse pour le plus grand profit d'un élite de jouisseurs et pour la plus grande honte de la vraie religion du Prophète. Sa perplexité dut être grande, ses angoisses terribles, et il lui fallut le triple airain dont parle Horace tour se précipiter tête baissée dans l'océan des superstitions et des haines qui devait fatalement l'engloutir. C'est un des plus magnifiques exemples de courage qu'il ait été donné à l'humanité de contempler, et c'est aussi une admirable preuve de l'amour que notre héros portait à ses concitoyens. Il s'est sacrifié pour l'humanité : pour elle il a donné son corps et son âme, pour elle il a subi les privations, les affronts, les injures, la torture et le martyre. II a scellé de son sang le pacte de la fraternité universelle, et comme Jésus il a payé de sa vie l'annonce du règne de la concorde, de l'équité et de l'amour du prochain. Plus que tout autre il savait quels dangers formidables il accumulait sur sa tête, il avait pu juger par lui-même de l'exaspération à laquelle le fanatisme savamment excité peut atteindre: mais toutes les réflexions qu'il put faire à ce sujet ne furent point assez puissantes pour le détourner de la voie dans laquelle il avait désormais résolu d'entrer : la peur n'eut aucune prise sur son âme et tranquille, sans daigner jeter un regard en arrière, calme, en pleine possession de lui-même il entra dans la fournaise.
Ce fut dans la nuit du 5 Djemadi el-Akher de 1'année 1260, à deux heures et cinq minutes de la nuit
(11 juin 1844) qu'après avoir une dernière fois supplié le Très Haut de lui indiquer ce qu'il avait à faire il s'écria: «Dieu m'a créé pour instruire ces ignorants et pour les sauver de l'égarement où ils sont plongés !»
Dès lors il brûle ses vaisseaux: il proclame qu'il est la Porte qui conduit à la connaissance des Vérités divines. Il relevait ainsi l'affirmation de la théologie officielle d'après laquelle Mohammed et les douze imams morts, la porte de la science divine avait été fermée, et l'humanité n'ayant plus personne à consulter pour acquérir la certitude sur les mystères de Dieu, était désormais obligée de se contenter de probabilités. Il déclara que cette Porte était de nouveau ouverte; qu'il était lui-même cette Porte et que quiconque voulait apprendre des choses certaines sur la nature divine n'avait qu'à s'adresser à lui.
Il écrivit aux principaux oulémas, ceux qu'il considérait comme convaincus et honnêtes, - car on en peut trouver, rari nantes in gurgite vasto : «Venez à moi vous qui cherchez, car la Porte de la connaissance divine est ouverte en ma personne.»
En attendant leurs réponses il commença - dans la Mosquée des forgerons (148), voisine de sa maison - ses prédications qu'il accompagnait d'attaques contre la dégénérescence du clergé officiel. C'était là, pour lui, un sujet continuel de colère car il avait pour le vice une haine vigoureuse qui déchaîna contre lui les fureurs de ceux qui se sentaient atteints par ses coups.
Ce fut à ce moment qu'arriva à Chiraz Molla Houssein Bouchrouyéhi, parti comme nous l'avons dit de Kerbélah à la recherche de Celui qu'avait annoncé Seyyed Kazem Rechti. Il acquit rapidement la certitude qu'il l'avait trouvé en la personne du jeune Seyyed, et se voua à lui avec un respect, une obéissance, un dévouement qui devaient le conduire à la mort. Il fut ainsi le premier croyant (149), Ewel men âmen, titre sous lequel il est aussi souvent désigné que sous celui de Bab-el`Bab(150), qui lui fut donné ensuite par son maître lui-même.
Nous racontons ailleurs l'histoire de sa conversion, pour ne pas retarder notre récit, mais nous sommes cependant obligés de nous arrêter ici un instant pour exposer les modalités de la «Manifestation», - sujet que nous développerons dans le second volume.
Le 5 Djemadi el-akher 1260 n'est pas comme on l'a cru jusqu'ici le jour où le Bab, soudain illuminé de l'esprit de Dieu, comprit et dénonça la mission dont il était chargé. Cette descente de l'esprit prophétique eut lieu quelque temps auparavant, mais le Bab le couva pour ainsi dire en lui-même, et, la gestation finie, lança au monde son appel de paix et de fraternité.
La date nous en est donnée avec précision dans le Kétab-el-Harémeïn :
«Dis, ô troupe, écoutez l'ordre de l'Éternité de Dieu venant de son esclave. En vérité, cet esclave est un esclave qui est né le 1er Moharrem de l'année 1236.
Et en vérité, aujourd'hui est le jour de la moitié du mois qui est avant Redjeb de l'an 1261. Ceci a été écrit dans le Livre de Dieu (151).
... En vérité, le premier jour que l'esprit descendit dans le coeur de cet esclave était le 15 du mois de Rebi el-Ewel (152). Et jusqu'à aujourd'hui, où Dieu vous interdit mes versets, quinze mois ont été écrits dans le Livre de Dieu.»
Les prédications de Seyyed Ali Mohammed si elles furent violentes, ne furent pas nombreuses : le temps lui manqua car il partit dès le mois de Chahaban pour accomplir le pèlerinage de la Meqqe, laissant derrière lui Chiraz stupéfaite.
La tradition veut qu'il ait été accompagné dans son voyage par plusieurs personnes : j'en ignore le nombre, et me bornerai à citer le nom de son oncle, celui du Bouchrouyéhi et celui de Barfourouchi. Ils se rendirent à Bouchir, où ils prirent place sur un navire à voiles qui devait les conduire à. Mascate. Les vents étant contraires, le voyage traîna en longueur et dura 12 jours, la chaleur était excessive, et bientôt le manque d'eau vint infliger aux voyageurs les tourments de la soif (153). Heureusement que le bateau était chargé de petits citrons de Chiraz, ce qui permit à notre héros de se soutenir.
Il garda de son voyage la plus mauvaise impression : «Sache que les routes de la mer sont pénibles : nous ne les aimons pas pour nos fidèles : voyage sur les routes terrestres,» s'écrie-t-il dans le Ketab beïn el-Haremeïn, en s'adressant à son oncle, comme nous allons le voir tout à l'heure. Il reviendra longuement sur ce sujet dans le Beyan. Qu'on ne croie pas ici à un enfantillage : le sentiment qui guide le Bab dans cette horreur de la mer est plus noble et plus élevé. Frappé de l'égoïsme des pèlerins, égoïsme exaspéré par la gène et les dangers d'un voyage sur mer, frappé également de l'état de saleté dans lequel sont obligés de vivre les voyageurs sur le pont, il veut éviter aux hommes l'occasion de donner cours à leurs mauvais instincts et de se rudoyer mutuellement. On sait que l'Apôtre recommande expressément la politesse, la courtoisie la plus raffinée dans les rapports sociaux : «Ne contristez qui que ce soit pour quoi que ce soit.» Et il fut, durant ce voyage, à même de constater la méchanceté de l'homme et sa brutalité quand il se trouve en face des circonstances difficiles : «Car la chose la plus triste que je vis dans mon pèlerinage à la Meqqe était les constantes disputes des pèlerins entre eux, disputes qui leur enlevaient les bénéfices moraux de leur pèlerinage (154).»
Il arriva donc à Mascate où il se reposa quelques jours durant lesquels il chercha à convertir les gens du pays - sans y réussir. Il s'adressa à l'un d'entre eux, un religieux probablement et de rang élevé, dont la conversion eût pu entraîner celle de ses concitoyens; je le suppose du moins, car il ne nous donne à ce sujet aucun détail; il est évident qu'il ne dut pas chercher à convertir le premier venu qui n'aurait eu aucune influence sur les autres habitants de la ville. Qu'il ait tenté une conversion et qu'il n'y ait pas réussi, la chose est indiscutable, puisqu’ il l'affirme lui-même : «La mention de Dieu, en vérité, descendit» sur la terre de Mascate, et fit parvenir l'ordre de Dieu à l'un des habitants du pays : il se pouvait qu’il comprit nos versets et devint l'un de ceux qui sont guidés.»
«Dis : il obéit cet homme à ses passions après avoir lu nos versets : et en vérité, cet homme est, selon l'ordre du Livre,au nombre des Transgresseurs(155).»
«Dis : nous n'avons pas vu à Mascate de gens du Livre qui l'aient aidé, car ils sont des ignorants perdus. Et il en fut de même pour tous (156) ceux qui se trouvaient sur le bateau, si ce n'est l'un d'entre eux qui crut à nos versets et devint de ceux qui craignent Dieu.»
Il continua donc sa route et arriva à la Meqqe où il se livra aux pratiques prescrites pour la visite de la maison de Dieu. Les traditions musulmanes, comme aussi les babises, mais ces dernières avec quelque hésitation, le montrent s'appuyant un jour le dos contre le mur de la Qaaba, tirant son sabre et proclamant l'arrivée de l'imam Medhi qui devait conquérir toute la surface du globe.
Il ne faudrait pas se hâter d'y croire: les Musulmans, en effet, convaincus que notre héros n'est qu'un faux prophète et un simulateur, l'accusent à tout instant de conformer sa conduite aux prophéties antérieures, réglant presque tous les mouvements du Sahabez-Zéman. En agissant ainsi, le Bab se donnait au moins les apparences extérieures du Prophète de la fin des temps, et pouvait, par ce fait même, attirer l'attention du vulgaire. A ce point de vue la question est très simple : dans la masse des hadis annonçant la conquête du globe à l'islam, Seyyèd Ali Mohammed aurait choisi les plus faciles à réaliser, et se serait ainsi fabriqué un «guide du parfait Medhi» auquel il aurait conformé sa conduite.
Vraiment les Musulmans font trop peu de cas de leur adversaire. En parcourant les livres de M. Browne, on pourra se convaincre, particulièrement en lisant les procès-verbaux des séances d'lsfahan et de Tébriz, que le plus grand argument des Mollas contre la mission du Bab, consiste à lui reprocher les noms de son père et de sa mère; et le Bab ne sait que répondre. Ce sont là des enfantillages, indignes de ceux qui les ont inventés et écrits.
De ce que les babis admettent en général cette attitude du Bab à La Meqqe, il ne s'en suit pas qu'elle soit authentique. L'histoire de l'Apôtre est fort peu connue, et j'ai étonné bien des babis, et des plus grands, en leur disant les noms des grand père et aïeul de Seyyèd Ali Mohammad, ou en leur fournissant l'un des détails que j'ai relevés dans le Kétab-Beïn-el-Haremeïn, livre d'une extrême rareté et qu'ils n'avaient pas lu. Les sectaires actuels ne sont compétents que pour ce qui concerne les actes de leur père: et à ce point de vue j'ai été on ne peut mieux servi, principalement par le fil de Moqaddèss Khoraçani.
Donc, en ce qui concerne la question qui nous occupe, il ne faut pas oublier que les babis du début - je parle du vulgaire -ne connaissaient aucun des détails de la nouvelle doctrine(157).Ils étaient purement et simplement convaincus de l'apparition de l'imam Mehdi (158) qui le sabre d'une main, le Qoran de l'autre allait courber sous la loi de l'Islam tous les peuples de la terre. Par suite, et par une opération mentale identique à celle que faisaient les Musulmans, mais cette fois en sens inverse, ils croyaient naïvement que le nouvel apôtre accomplissait, parce qu'ils étaient prédits, tous les actes incombant à l'imam Mehdi. Il en a été exactement de même pour le Christ. Les rabbins lui opposaient les textes pour démontrer qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour être le Messie; Jésus leur répondait : consultez l'esprit, non la lettre et ses sectateurs - tenant aussi peu de compte de cette formule que ses adversaires - lui créaient une généalogie, inventaient une infinité d'épisodes pour prouver qu'il était dans l'étroitesse de la Lettre le Messie promis et attendu.
Ni adversaires, ni sectateurs n'ont donc tenu compte de l'enseignement du Maître : seule, au début du Babisme la belle Qourret-oul-Aïne répondit à Hadji Molla Mirza Mohammed Enderrmani et à Hadji Molla Ali Kéni chargés de la ramener à l'Islam et qui lui opposaient les textes annonçant la venue du Mehdi des villes de Djaboul Qa, et Djaboul Ça : «Laissez donc aux enfants ces insanités indignes de vous et de moi: la question.est plus haute»
Et cependant, le Bab passait pour l’interprétateur non pas seulement du sens intime mais de l'intime du sens intime du Qoran, il commentait non pas la lettre, non pas l'esprit, mais l’âme du Livre de Dieu : et c'est de Lui qu'on attend la réalisation dé prophéties qui ne s'appuient sur rien et dont la base n'est que l'ignorance, le fanatisme ou la mauvaise foi de ceux qui les ont recueillies (159).
Qu'on ouvre le Beyan, qu'on le parcoure : qu'y verra-t-on? rien autre chose qu'une nouvelle explication des termes usités dans toutes les religions -. Le Feu de l’Enfer, le Paradis, la Balance de Dieu, la Mort, le Jugement dernier, etc. Et l'homme qui interprète d'une façon si magistrale ces superstitions d'un autre âge aurait perdu son temps à des simagrées de ce genre !
Je me refuse, pour ma part à y croire, et d'ailleurs nous n'avons aucune autorité qui nous l'affirme. Nous ne rencontrerons dans toute la dialectique non seulement du Bab mais encore des babis qu'un profond mépris pour ces hadis menteurs et forgés à plaisir, tandis qu ils s'efforceront de concilier ceux qui sont authentiques, mais ceux-là seulement, avec les données ou avec l'histoire de la nouvelle religion.
Seyyèd Ali Mohammed nous aurait d'ailleurs parlé de cet incident: il n'y en a pas trace dans le Kétab beïn e1Haréméïn.
Si nous cherchons dans cet ouvrage une allusion aux actes de Seyyèd Ali Mohammed nous nous arrêterons à ces passages :
«O mon Dieu! J’implore ton témoignage pour ce que j'ai dit dans la Mesdjèdel Haram, près de la Qaaba, ton sanctuaire sacré, à celui qui m'interrogeait au sujet des versets, en répondant par ces versets relatifs à ce que tu as fait descendre pour ton ami Mohammed dans le Qoran d'auparavant.
«Si on discute avec toi à ce sujet, depuis que tu en as reçu la connaissance parfaite, réponds : Venez, appelons nos enfants et les vôtres, mes femmes et les vôtres, venons nous et vous et puis adjurons le Seigneur chacun de notre côté et appelons sa malédiction sur les menteurs (160)».
«J'en jure par ta vérité, et tu es Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que Toi, que les hommes n'ont pas même accueilli cette parole, mais le témoignage de Dieu suffit dans cette question.»
«Donc, ô interrogateur instruit, est-ce que je ne t'ai pas dit dans la Mesdjèdel Haraml en face de la Qaaba, et nous étions à là face occidentale, à l'endroit où tu te trouvais, devant le mimber, pendant la nuit du 15e jour du mois de zil hedjè el Haram, trois heures après le coucher du soleil, est-ce que je ne t'ai pas dit: Accepte ma demande, viens, faisons «moubahélé» près de la pierre noire, puisque, au nom de tous les hommes, tu te charges du mandat de me renier, afin que Dieu décide entre nous de la vérité: et Dieu sait ce que je dis. .
«Est-ce que je ne t'ai pas fait une autre fois cette même proposition dans la Mesdjèd el Haram entre le Mimber et le Maqam, en face de la Qaaba.
«Est-ce que je ne t'ai pas, dans la maison même de La Meqqe qui est la demeure de la Vérité, renouvelé trois fois cette offre».
Les termes ici sont donc bien clairs, et bien nets, les détails sont précis, et il n'y est question ni de sabre, ni d'imam Mehdi, ce que le Bab n'eût pas manqué de mentionner si cela avait eu une utilité quelconque, ou quelqu'importance à ses yeux.
Par le fait même qu'il propose le Moubahélé à l'un de ses contradicteurs il est acquis pour nous qu'il continua durant son pèlerinage une propagande qui semble n'avoir pas beaucoup réussi.
Quoi qu`il en soit le Bab, son pèlerinage terminé, se prépara à rentrer en Perse. Ce fut peut-être à ce moment ou peut-être à son retour à Bouchir, après avoir révélé en pleine mer le Kétab-Rouh (161.) qu'il songea à organiser les évènements qui allaient survenir.
En effet, voici en quels termes il invite son oncle, à aller prêcher la nouvelle doctrine.
Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux.
«Lis le livre (162) de la «Mention du Nom de ton Seigneur. Il n'y a pas d'autre dieu que Lui, il est élevé et sage. Et ce livre est un livre descendu de la part du Baqièt Uullah, l'imam de la Vérité Evidente.
«En vérité ce livre est un ordre qui ne renferme aucun doute : il descend de Dieu, le Très-Haut, le savant. Et, en vérité, il est la Vérité dans les cieux et sur la terre.
«Il te récite le Livre de ton Seigneur qui contient un ordre de la Balance inflexible, et en vérité c’est là, la voix de ton Seigneur dans les cieux et sur la terre. Il appelle les hommes à la route de Dieu, le glorieux, le loué.
«Sache que quiconque entend une parole des nouveaux versets, ses oeuvres ne seront acceptées que s'il donne sa foi aux versets de son Seigneur et s'il devient de ceux qui se prosternent»
«Et en vérité un seul verset des versets que nous faisons maintenant descendre sur toi est égal aux versets de (tous les prophètes) d'auparavant et à tous les versets que par la suite tous les hommes demanderont au Baqiet Oullah.
«Ce livre suffit pour prouver la qualité de Houdjèt du Zikr pour tous ceux qui sont sur la terre.
«Si Dieu fait descendre un verset, personne n'a le droit de dire quoi que ce soit à son sujet.
«Et, en vérité, je n'établis aucune différence dans l'ordre du Livre. Tous sont sous ses ordres et adorent Dieu.
«Nous avons éprouvé les hommes par la vérité, comme nous avons éprouvé ceux qui étaient avant eux: tous ont donc pris leur part du Livre et tous retourneront à Dieu.
«En vérité, ceux qui obéissent aux versets de Dieu et sortent dans la direction de la terre bénie(163), ceux-là sont ceux qui ont été guidés.
«En vérité, ceux qui ont traité de mensonges nos versets et obéissent à leur passion, ceux-là sont dignes de la parole de châtiment, et ils ne le savent pas.
«Sachez, ô vous qui m'avez réellement obéi, et donnez-vous la bonne nouvelle du souffle qui vient de moi, et en vérité, ce souffle est un grand bienfait.
«Dieu, votre Seigneur miséricordieux a écrit vos noms dans la feuille de l'Arch, et, en vérité, cette inscription est un grand bienfait.
«Dis: ô troupes ! rapprochez-vous de celui qui est assis sur l'Arch dans le harem sublime. Puis sortez suivant l'ordre de Dieu (de vos maisons?) et rentrez dans la terre du refuge, tous, afin que tous vous soyez inscrits dans les rangs de ceux qui ont reçu le bienfait.
«Sache, ô Seyyèd pur et bon, et qui crains Dieu! Invite les hommes à la justice: fais parvenir l'ordre de ce Livre à ceux qui sont sur cette terre (là), à ceux qui sont dans les alentours de cette terre, afin que meure celui qui doit mourir (164) à l'houdjet nouveau; afin que soit sauvé celui qui a été sauvé par les versets anciens. Et Dieu, ton Seigneur, est celui qui entend, le savant.
«A ceux qui accusent Dieu de mensonge en disant que la Mention du Nom de Ton Seigneur pille ce qu'il veut dans le Qoran, dis: «Dieu est pur et libre (de ce dont vous l'accusez) et son rang est élevé. Quand Dieu le permet à son esclave, il fait descendre dans chaque mot l'équivalent d'un Qoran». Et Dieu qui est ton Seigneur, est le puissant et le glorieux.
«En vérité, [ô Séyyèd] obéis à l'ordre de la révélation et fais parvenir comme ce Livre vers ceux qui, en vérité, habitent dans les routes (165) : il se peut qu'ils comprennent les versets de Dieu et deviennent de ceux qui sont guidés.
«Sache qu'en vérité, les routes de la mer sont pénibles: nous ne les aimons pas pour nos sectateurs. Va par les routes de terre (166) et dis: «Ce que Dieu veut [sera]. Il n'y a de puissance qu'en Dieu, ce Dieu qui tient dans sa main tous les ordres. Il n'y a pas de dieu, si ce n'est Lui, l'aimant, celui qui n'a besoin de personne.
«Et si tu n'as pas peur de l'ordre de Baghdad, fais des efforts dans les routes de ton Seigneur, avec sagesse et avec des versets solides pour ceux qui habitent Baghdad parmi les oulémas qui nient. Il se peut qu'ils comprennent l'ordre de Dieu et deviennent musulmans (167).
«O troupes, faites attention! comment dites-vous au sujet de mon esclave: «tout cela est vain». En vérité, cet esclave est venu vers vous avec des versets, qui, comme ceux du Qoran, sont clairs et évidents, et ce, après que vous-mêmes vous avez été convaincus de l'ordre de Dieu.
«Patientez ! en vérité, le jour de la séparation [entre les bons et les méchants] est vrai. Et j'ordonne au milieu des hommes avec la permission de ton Seigneur. Et ce jour n'est pas un jour de violence. Dieu est le Tout-Puissant, le savant.
«Craignez Dieu, ô hommes! puis présentez-vous entre les deux mains de Dieu : si vous le pouvez, apportez (des versets) pareils à(ceux) de ce Livre. Alors que votre religion soit pour vous, et, pour moi, la religion de Dieu, le glorieux, le loué.
«Et si vous ne le pouvez pas, et certes, vous ne le pourrez pas, même si vous vous entr'aidiez tous mutuellement, alors détournez-vous du mensonge dans lequel vous êtes.
«Entrez par la porte de Dieu, en vous prosternant, peut-être serez-vous sauvés. Et si vous n'entrez pas, alors tenez-vous-en à l'ordre de Dieu dans le Qoran, et réclamez de la justice de Dieu qu'il fasse descendre le châtiment sur ceux qui mentent et sont devenus des méchants.
«Te basant sur cet ordre, fais sur ta route parvenir cet ordre et ne crains personne dans les jours de ton Seigneur. En vérité, ceci est le bienfait de Dieu sur toi.
«Et, en vérité, si tu meurs ou si tu es tué, tu retourneras à Dieu.
«Fais peur à celui qui, en vérité, a traité de mensonges songes les versets de son Seigneur, a obéi à ses passions'et est ainsi devenu des transgresseurs.
«Fais parvenir le salut de la Mention à ceux qui ont cru déjà et dis-leur: «sortez (de vos maisons, vous dirigeant) vers la terre bénie (Chiraz) afin que vous soyez parmi les pieux.
«Et envoie comme ce livre à ceux qui ont obéi à notre religion et sont des convaincus.
«En vérité, pour l'un d'entre vous il est nécessaire qu'il enseigne dans la maison du Bab de Dieu ce qui est de nos versets d'auparavant, et, en vérité, ceci est chose importante.
«O mon oncle maternel, lis ce livre et patiente dans cette ville (?) tant que tu le voudras : puis sors vers ta ville (Chiraz). En vérité toi tu es de ceux qui ont apporté leur foi d'après ce Livre. Dis: «Louanges à Dieu, l'ordonnateur des mondes».
Comme on peut le voir, le Bab prépare dès maintenant son entrée : il ordonne à un messager de répandre ses oeuvres, de prêcher les populations en même temps qu'il fait un devoir strict à tous ceux qui ont cru en lui de se réunir à Chiraz. De plus il donne 1'ordre de reprendre les prédications dans sa maison et je crois qu'il s'agit là de la mosquée des fabricants de sab.re (Chemchirguéran).
M, de Gobineau, M. Browne, tous les auteurs musulmans, la généralité des babis pensent que dans le cours de sa vie le Bab se présenta sous divers aspects: d'abord sous celui de porte, puis sous celui de point.
Moi-même, j'ai partagé cette opinion non pas d'une façon bien nette et bien précise mais cependant suffisamment explicite pour avoir à la page IV de la préface du Livre des Sept Preuves écrit la phrase suivante: «Le Bab se qualifie ici d'imam Mehdi et rejette le titre de Bab dont il s'était revêtu».
Je dois avouer ici que je me suis trompé et ma seule excuse est de m'être trompé en nombreuse compagnie.
Que signifie ce titre de «Porte». Nous l'avons vu, sans avoir eu besoin de rechercher bien loin, le prophète dire «Je suis la ville de la science, et Ali en est la Porte!»
La doctrine des Chiites Esna Achéris, s'est emparée de cette parole, a bradé dessus des dessins compliqués d'où il est résulté, en fin de compte, que les douze imams ont été successivement des Portes, en vertu d'un héritage d'inspiration directe et divine. Le 12e imam disparu, la Porte de la science divine a été fermée, et les hommes n'ont plus eu pour se conduire que le «raisonnement» de leurs chefs religieux, les Moujtéhèds.
Tout ceci est clair et précis, et les termes mêmes que j'emploie sont d'un usage quotidien en Perse.
Or le Bab survint qui se déclara la Porte de la connaissance divine : c'était par le fait même renouer la chaîne interrompue, remonter, suivant les croyances chiites, aux premiers temps de l'Islam, en reprendre toutes les traditions, et continuer, à travers les siècles, l'oeuvre commencée par Mohammed.
Le Bab, là n'invente rien, puisque les prophéties annoncent cette réapparition d'un imam connu sous le nom d'imam Mehdi, imam Qaem, Qaem de la famille de Mohammed, Sahab-ouz-zeman, etc.
Or, se prétendre la Porte, c'est revendiquer par cela même le titre de Sahab-ouz-zéman.
Malheureusement, là est encore intervenu le chaos des superstitions de la Perse. Tout d'abord l'idée universellement admise est que l'imam Mehdi doit faire régner l'islam, et par suite le Qoran sur toute la surface de la terre.
Islam et Qoran veulent dire, pour les Persans, purement et simplement la religion qu'ils ont entre les mains, le Livre qu'ils possèdent. Dès lors Seyyèd Ali Mohammed qui présente une nouvelle religion et un nouveau livre, ne peut être qu'un imposteur.
Mais si l'on prend les mots Islam et Qoran dans leur vrai sens, le spectacle change: «Islam», c'est la résignation à Dieu, la religion de Dieu et c'est en ce sens que les Persans ont raison de dire qu'Abraham, Moïse, Jésus étaient des musulmans. «Qoran» veut dire «la lecture», «le Livre» - irait-on prétendre que la science immense de Dieu est renfermée tout entière dans les bornes étroites du Livre auquel on a donné ce nom. Non, car alors le recours aux Moujteheds serait inutile.
Je ne crois pas qu'il me soit indispensable de m'appesantir sur ce sujet: l'explication que je donne ici doit suffire je pense pour faire comprendre comment peuvent s'interpréter et se traduire toutes les croyances persanes au sujet de l’imam Mehdi. ,
Donc, et par le fait même de sa prétention à être le Bab, Seyyèd Ali Mohammed, réclame le titre de Sahabouz-zèmam.
Or, que fait-il dès cet instant ? sans hésitation, sans crainte il fait descendre des versets. Or, si nous remontons l'histoire des âges, nous ne rencontrons qu'un seul personnage doué de ce pouvoir et c'est Mohammed !
Bien plus, dans le kétab el Harémein même notre héros déclare que les divers témoins -lisez prophètes - de Dieu qui se sont succédé l'ont fait d'une façon ascendante c'est-à-dire que le prédécesseur - déjà plus élevé que celui auquel il succède - est inférieur à son successeur. Or si nous traduisons cette donnée par des noms, nous avons Mohammed comme prédécesseur, Seyyèd Ali Mohammed comme successeur.
Et il insiste sur ce point car il dit qu'il en est de même pour les signes de Dieu, et il va jusqu'à déclarer qu'un seul des versets qu'il fait descendre, lui, est plus grand que tous les versets du Qoran.
Ayant ainsi - dés le début, et j'insiste sur ce point - proclamé sa mission, il ne reste plus rien à réclamer et il ne réclamera rien par la suite, son histoire est là pour l'affirmer.
Nous le voyons, dans ses ouvrages de début se donner les noms de Bab, de mention, du nom de ton Seigneur, de Parole de Dieu etc., etc. : ses autres titres ne proviennent pas d'autre chose que du développement normal de sa doctrine, comme le titre de Nouqté Oula par exemple (168). ;
Au surplus, examinons les différentes sourates qui composent le recueil intitulé Kètab-bein-el-Harémeïn.
La première sourate de cet ouvrage a été intégralement donnée ci-dessus, c'est celle qui est adressée l'oncle de Seyyed.
La seconde sourate, que j'ai appelée «l'interdiction» contient' le passage suivant:
«Est-ce que tous les versets de tous les prophètes» égalent un des versets que nous envoyons vers toi ?» Non, j'en jure par ton Dieu ! En vérité ! nous témoignons que la plupart des hommes ne comprennent pas et n'apportent pas leur foi : ils sont sans intelligence : que Dieu les tue !
«On dirait que ces gens sont plus égarés que n'importe quel âne et, en vérité, l'âne comprend comment il mange l'orge et eux ne comprennent rien, et ne seront pas guidés !
» J'en jure par Celui qui vous a créés et m'a fait son témoin sur vous, un verset de mes versets prouve l'ordre de Dieu pour tous ceux qui sont sur la surface de la terre.»
La 3e sourate est une compilation de hadis., qui ne nous intéressent pas pour le moment.
La 4e est celle qui est adressée à Hadji Seyyèd Ali Kermani.
Et enfin, la 5e celle qui fait l'objet de la présente étude, et à laquelle nous avons fait de larges emprunts contient les mots suivants :
«Alors j'ai accepté ton ordre, ô mon Dieu! parce que tu m'as instruit sur la parole de création, afin que les croyants sachent, par l'ordre de tes versets d'acceptation, la parole qui sépare le vrai du faux (169).»
«Dieu embrasse toutes choses : peut-être ce livre est-il un Qoran sublime de la Science de Dieu, afin que les Unitaires témoignent, dans les versets de ton esclave, la parole du Livre. Et nous avons compté toutes choses dans le livre évident afin que les fidèles entrent dans la porte de la maison de ton harem, à cause de l'ordre que tu as fait descendre dans le Qoran d'auparavant. II.55. «Entrez par la porte en vous prosternant et dites : «Indulgence, ô mon Seigneur et il vous pardonnera vos péchés.» Certes, nous comblons les bons de nos faveurs.»
En vérité ! les gens du Qoran ont dit quand est descendu le (mon) livre de la Mention du nom de ton Seigneur ce qu'en vérité avaient dit les associeurs d'auparavant (au moment de la descente du Qoran).
Et je ne trouve pas de différence sur la route de Dieu. Et tu ne trouveras aucun changement dans aucune des paroles de Dieu !
Retourne-toi vers moi, comme l'ont fait ceux qui se sont tournés vers les Prophètes de Dieu, et ne crains rien, en vérité, Dieu ne détruit pas la récompense de ceux qui font le bien.
En vérité, la parole de ton Seigneur, (le Bab) n'appelle pas les hommes d'après lui-même, mais il appelle l'humanité vers ce à quoi l'ont invitée les envoyés et les prophètes avant lui.
Et quand Dieu le voudra, il expliquera par l'intermédiaire de son Zikr (le Bab) ce qui a été décrété pour lui dans le Livre.
En vérité, si Dieu le veut, il peut manifester de son esclave tout ce qu'il veut, autant qu'il veut: et moi, je ne veux pas une chose autre que celle que Dieu, ton Seigneur, a voulu auparavant.
Auprès de la Mention du nom de ton Seigneur, il n'y a pas de Témoignage, si ce n'est un Témoignage qui vient de moi (Dieu) plus grand que le témoignage d'auparavant.
Enlève, sans aucun signe qui te descende dans le coeur, de la Porte de Dieu les rideaux des preuves et des arguments.»
Comme on peut le voir, le Bab est bien la porte, mais il est en plus Prophète, plus grand(170) que Mohammed, et Dieu expliquera par la suite, par l'intermédiaire même du Bab, ce qui a été décrété, pour ce Bab, dans sa science. Il n'y a donc pas de contradiction dans le curriculurn vitae de Seyyèd Ali Mohammed et certes, c'est une grave erreur de la part des Musulmans que de le vouloir accabler de cette accusation.
Mais revenons au retour de notre héros à Bouchir.
Ce fut Molla Housseïn Bouchrouyéhi qu'il choisit pour l'envoyer à Isfahan à la recherche de Moqaddès Khoraçani. Il confiait à son messager le. début du commentaire de la Sourate de Joseph (171), quelques oraisons jaculatoires en lui disant : «dès que Moqaddès Khoraçani les lira, il donnera sa foi à leur auteur, mais je ne veux pas que tu lui dises mon nom, qu'il devinera lui-même. Tu lui diras de se rendre à Chiraz où il recevra mes ordres.»
Il en fut ainsi que le Bab l'avait dit(172) et le lendemain même jour de sa conversion, Moqaddès sortit à pied d'Isfahan avec son ami Habib, se dirigeant vers Chiraz.
Trois jours après leur arrivée, Moqaddès reçut une lettre de l'apôtre dans laquelle était contenu l'ordre suivant: «Prie dans la Mosquée dans laquelle les versets sont descendus de ton Seigneur et enseigne nos versets dans cette même mosquée(173)...et prononce à haute voix mon nom dans l'azzan, après les trois confessions de la manière suivante :... Et je confesse qu' Ali avant Nébil est le miroir du souffle de Dieu(174).» Il lui ordonnait en même temps de se tourner, au milieu des prières, vers sa maison qui devenait ainsi la nouvelle Qibleh.
La Mosquée était petite, mais Moqaddès y fit mettre des nattes, tant dans le temple lui-même que dans la cour extérieure afin de recevoir tout le monde qu'y attirait l'annonce de son arrivée.
Il y commença donc l'office, devant les fidèles réunis, suivant l'ancien usage, puis soudain se tourna vers la maison du Bab, cependant que trois muezzins auxquels il avait donné ses ordres, faisaient, du haut des minarets, retentir l'air de ces paroles :
«Je confesse qu'il n'y a pas d'autre dieu que Dieu, que Mohammed est le prophète de Dieu, qu'Ali est le Véli de Dieu, et qu'Ali avant Nébil est le miroir du souffle de Dieu !»
Ceci fait, Moqaddês monta vivement sur le mimber, lut quelques versets du commentaire de la Sourate de Joseph et se mit expliquer les fameuses paroles : «O Rois, ô fils de Rois, ne vous parez pas, vous tous, de ce qui appartient à Dieu.»
La guerre était déclarée et le clergé officiel ne tarda pas à répondre à ces hostilités. Après trois jours de cris, de tumulte, de menaces et d'injures pendant lesquels le missionnaire Babi continua la tâche qu'il avait assumée, les étudiants en théologie, les oulémas, des gens du peuple excités en sous main, vinrent crier leurs doléances aux pieds de Mirza Housseïn Khan, adjudant bachi, gouverneur de la ville.
La nuit même de ce jour-là, Housseïn Khan réunit les principaux docteurs de l'islam et fit comparaître devant cet aréopage (175) Moqaddès et Habib, ce dernier plus connu sous le nom de Qouddous.
- J'ai appris, leur dit-il, que vous avez changé la qibleh ?
- Oui.
- Vous avez aussi modifié la formule de l'Azzan?
- Oui.
- Vous avez récité et commenté de nouveaux versets?
- Oui.
-Quel sens donnez-vous à ces paroles : O rois, ô fils de rois... (176)
- Cela veut dire : O Sultan ne possède pas les biens de cette terre sans la permission du véritable propriétaire qui s'est manifesté aujourd'hui.
- Ce jeune Chirazi ?
- Oui.
- Alors Mohammed Chah ne doit pas régner sans lui en demander la permission ?
- Et quand cela serait, le globe terrestre tomberait-il en cendres ?
- Alors je ne suis plus gouverneur de cette ville, à moins que je ne sollicite de lui ce gouvernement.
- Tu l'as dit.
Housseïn Khan entra en fureur, et les oulémas en profitèrent pour rendre un fetva condamnant à mort les deux blasphémateurs. Mais le gouvernement n'y voulut pas consentir, il se contenta de faire dépouiller Moqaddés de ses vêtements, puis de le faire conduire dans le jardin où il lui fit donner, en sa présence, cinq cents coups de verges. Ceci fait, on lui brûla la barbe et on l'emprisonna avec Quouddous qui, lui, reçut douze soufflets.
Le lendemain on leur perça le nez, on leur y passa une ficelle et on les promena durant trois jours.à travers les bazars, au milieu des rires, des quolibets, des insultes et des coups de la populace. Enfin on les expulsa de la ville et ils allèrent se réfugier à Saadièh où le Bab vint les retrouver(177).
Il les fit rentrer nuitamment avec lui dans la ville et les recueillit en grand secret dans sa propre maison. Une fois en sûreté, il se jeta à leurs cous en pleurant, en gémissant et en s'écriant : Hélas ! je ne sais de quelle façon vous .regarder, ô vous qui avez souffert pour moi ! Il pleura ainsi quelque temps, et fit descendre des versets en leur honneur.
On retrouve dans les oeuvres du Bab un écho de la douleur qu'il ressentit de ces violences.
«O gens du Qoran, vous avez accompli, dans les jours de Dieu (178), des actes que personne n'avait accomplis avant vous.»
«En vérité pour vous sont venus les envoyés de la Mention de Dieu, venant de notre part, avec des versets témoins, et porteurs du sens interne du Qoran: ils avaient des feuilles écrites dans la route des gens du Beyan et, en vérité, vous vous êtes ouvertement détournés des versets de Dieu, et vous avez, en dépit de tout droit, tourmenté les envoyés de la Mention de Dieu, cependant que vous vous déclariez sincères dans la religion d'Allah ! C'est le mal que vous ont acquis vos actes, c'est le péché dont se sont remplies, vos mains durant les jours de Dieu (179)»
Moqaddés et Quouddous restèrent cachés trois jours dans la maison du Bab, recevant leurs instructions pour le voyage qu'ils devaient faire à Yezd et au Khoraçan.
Ils se rendirent donc à Yezd où ils séjournèrent pendant quarante jours se bornant à discuter avec les grands personnages tant civils que religieux et militaires. Sans doute crurent-ils le terrain favorable car ils préparèrent une grande manifestation. Ils firent annoncer par la ville- soit à haute voix, soit en faisant circuler des avis écrits - que quiconque voulait voir l'envoyé de l'imam Qa'em n'avait qu'à se rendre le vendredi suivant dans la Mosquée de Mouçalla : «Là serait dit ce qui doit être dit, là serait révélé ce qui doit être révélé». .
Tout avait été préparé pour la circonstance : une estrade avait été établie, et sur cette estrade une chaise avait été placée pour Moqaddès.
La foule était énorme et ardente: ses passions religieuses surexcitées la faisaient vibrer comme un seul homme: aussi, à peine le missionnaire babi eut-il commencé à faire connaître l'apparition du nouvel apôtre que tous se précipitèrent sur lui avec un immense cri «A mort ! à mort!». On le frappa, on le foula aux pieds. Parmi ses assaillants, un Seyyéd. Seyyèd Azqandi se faisait remarquer par sa violence : il semblait s'acharner sur sa victime, se pencher sur elle comme pour la dévorer, mais en réalité la couvrait de son corps et la mettait à l'abri des énergumènes fanatisés. Il fit si bien qu'il poussa Moqaddès dans sa maison l'y garda quelques jours, et l'en fit partir secrètement.
Des violences de ce genre n'étaient pas faites pour calmer l'enthousiasme de nos deux missionnaires. Ayant échoué à Yezd, ils se rendirent à Kirman où ils recommencèrent leurs discussions.
Ils y rencontrèrent beaucoup d'incrédules, mais y obtenaient cependant quelques conversions.
Il y eut là une lutte ardente entre Moqaddès et Kérim Khan, qui comme on le sait avait pris le rang de chef de la secte chéïkhie après la mort de Kazem. La discussion eut lieu en présence d'un nombreux auditoire et Kérim somma son adversaire de prouver la vérité de la mission du Bab. «Si tu le fais, lui dit-il, je me convertis, et mes élèves avec moi; mais, si tu n'y réussis pas, je ferai crier dans les bazars : voilà celui qui foule aux pieds la sainte loi de l'islam.»
«Je sais qui tu es, Kérim, lui répliqua Moqaddèss. Ne te souviens-tu pas de ton maître Seyyed Kazem et de ce qu'il t'a dit: «Chien ne veux-tu pas que je meure et qu'après moi paraisse la vérité absolue!» Et voilà qu'aujourd'hui, poussé par ta passion des richesses et de la gloire tu te mens à toi-même.»
Commencée sur ce ton, la discussion devait être brève. En effet, les élèves de Kérim tirèrent le couteau et se lancèrent sur celui qui insultait leur chef. Fort heureusement le gouverneur de la ville s'interposa, fit arrêter Moqaddès et-le fit conduire dans son palais. Il le garda pendant un certain temps et, quand les passions se furent un peu calmées, il le renvoya de nuit, le faisant accompagner durant quelques étapes par 10 cavaliers.
Il partit donc avec Quouddous, et prit la route du Khoraçan. A Bouchrouyèn ils se rencontrèrent avec Mollah Housseïn Bouchrouyèhi, avec lequel ils continuèrent leur voyage.
Nous avons en effet vu que dès l'arrivée du Bab à Bouchir, Mollah Housseïn avait quitté son maître pour venir à Isfahan où il devait rencontrer Moqaddès et l'envoyer à Chiraz, puis, de là il devait toucher à Téhéran où il devait tenter de voir le roi, et se rendre enfin dans le Khorassan pour y prêcher la nouvelle doctrine.
Nous l'abandonnerons un instant ici où nous le retrouverons après avoir retracé l'histoire de ce qui se passait à Chiraz.
Cette ville était devenue le théâtre de discussions passionnées qui troublèrent profondément la paix générale. Les curieux, les pèlerins, les amateurs de scandale s'y donnaient rendez-vous, commentant les nouvelles, approuvant ou blâmant, exaltant le jeune Seyyèd ou le couvrant au contraire de malédictions ou d'injures: tout le monde s'excitait, s'énervait, s'affolait. Les Mollas voyaient avec une âpre inquiétude s'augmenter le nombre des sectateurs de la nouvelle doctrine: leur clientèle, par suite leurs ressources diminuaient d'autant. Il fallait aviser, une plus longue tolérance pouvait vider les mosquées de leurs fidèles convaincus que puisque l'islam ne se défendait pas c'est qu'il avouait être vaincu. D'autre part Housseïn Khan, Nizam ed Dowléh, gouverneur de Chiraz, craignit qu'à laisser aller les choses le scandale devînt tel, qu'il fût par la suite impossible à réprimer: c'était risquer la disgrâce, d'ailleurs le Bab ne se contentait pas de prêcher: il appelait à lui les hommes de bonne volonté «Et celui qui connaît la parole de Dieu et ne lui vient pas en aide au moment de la violence est exactement comme celui qui s'est détourné du témoignage de sa Sainteté Housseïn fils d'Ali à Kerbelah. Ce sont ceux-là les impies (180).» Les intérêts civils ainsi d'accord avec les intérêts du ciel, Nizam ed Dowlèh et Cheikh Abou Tarab, l'imam Djoum'èh, furent d'avis qu'il fallait infliger au novateur un affront qui le discréditât aux yeux de la population. Peut-être ainsi arriverait-on à calmer les choses.
On convoqua donc à une grande réunion les oulémas et les principaux négociants de la ville. On y fit comparaître le Bab. Cheikh Abou Tarab ne put maîtriser la colère que lui inspira la vue du Seyyed et commença l'entretien par des invectives. I1 termina en lui demandant: «Oui donc es-tu et pourquoi excites-tu tant de désordre. -Je suis, répondit l'apôtre, délégué par Dieu pour conduire les hommes à la vérité et au salut. Que me reprochez-vous? Et qu'ai-je enseigné de mal aux créatures de Dieu?» Cheikh Abou Tarab furieux de tant de calme et d'audace le frappa avec son bâton. Il s'excitait lui-même et frappait particulièrement sur la tête. Les assistants pleins de dégoût pour cette scène scandaleuse y mirent fin en déclarant : que de pareilles violences étaient inconvenantes et que ce serait leur manquer de respect à eux-mêmes que d'y insister. On renvoya le Bab chez lui (181), en lui recommandant de se tenir tranquille et de ne plus prêcher. D'ailleurs on déclara que son oncle serait personnellement responsable de ses actes de perturbateur. Aussi Mirza Seyyèd Ali prit-il son neveu dans sa maison où il l'enferma afin que personne ne le vît. Les autorités religieuses (182) peu expérimentées en la matière espéraient arriver ainsi à arrêter le mouvement qui se dessinait d'une façon menaçante.
Le contraire se produisit et ce martyre ne servit qu'à étendre les progrès de sa secte : désormais l'attention publique était attirée d'une façon impérative sur les événements qui se passaient à Chiraz. On voulait savoir de quoi il s'agissait et chacun s'intéressa à l'affaire dans un sens ou dans l'autre : le désordre fut à son comble.
Ce fut alors qu'on décida de frapper un grand coup. Les mollas imaginèrent de forcer le Bab à une rétractation publique de sa doctrine. On l'envoya donc chercher dans sa maison, puis, après la menace des supplices les plus effroyables on le conduisit à la grande mosquée.
Le Bab monta en chaire et y proclama sa mission, dans un discours si plein de conviction, de force, d'énergie et d'éloquence que tous les assistants se turent oppressés (183).
A la suite de cette séance publique provoquée par la sottise des mollas, et qui lui attira de nombreux partisans, le trouble fut profond dans toutes les provinces de la Perse, le débat prit un tel caractère de gravité que Mohammed Chah envoya à Chiraz un homme en qui il avait toute confiance pour lui faire un rapport de ce qu'il aurait vu et compris. Cet envoyé était Seyyed Yahya, Darabi.
Ce personnage était comme son nom l'indique, né à Darab, près de Chiraz. Son père Seyyed Djaafer, surnommé Kechfi, était l'un des plus grands et des plus célèbres oulémas de l'époque. Sa haute valeur morale, son caractère, ses moeurs pures lui avaient attiré l'estime et la considération universelles: sa science lui avait valu le glorieux surnom de kechfi qui veut dire celui qui découvre, et dans ce cas, celui qui découvre et explique les secrets divins.
Élevé par lui, son fils ne tarda pas à l'égaler sur tous les points : il partagea désormais la faveur dont jouissait son père et se rendit à Téhéran, précédé de son renom et de sa popularité. Il y devint le commensal du prince Tahmasp Mirza, Mouayyed ed Dowléh, petit-fils de Feth Ali Chah par son père Mohammed Ali Mirza. Le gouvernement lui-même rendit hommage à sa science et à son mérite et il fut consulté plus d'une fois dans les circonstances difficiles.
Ce fut à lui que pensèrent Mohammed Chah et Hadji Mirza Aghaci quand ils voulurent trouver un émissaire honnête et dont la fidélité ne fût pas douteuse.
Le chah lui fit don d’un cheval et lui avança, les frais du voyage.
Arrivé à Chiraz, le messager royal alla voir le Bab à plusieurs reprises. Désireux de bien étudier son hôte, Seyyed Yahya lui parla, les deux premières fois qu'il le vit, de choses indifférentes. A la troisième visite, il lui posa quelques questions difficiles de dogme ou de rituel. Son interlocuteur y répondit de façon satisfaisante. Il lui demanda alors d'écrire un commentaire sur la 108e Sourate du Qoran qui porte le titre de «Qooucer».
Sans faire aucune objection, sans une minute de délai, le Bab, en sa présence, prit la plume et, sans hésitation d'aucune sorte, écrivit un commentaire tel que l'envoyé royal sentit le vertige s'emparer de lui.
Certes le fait d'écrire currente calamo un commentaire nouveau sur une sourate dont le sens est si obscur, devait frapper d'étonnement Seyyed Yahya, mais ce qui le surprit plus étrangement encore, ce fut de retrouver, dans ce commentaire, l'explication que lui-même avait trouvée dans ses méditations sur ces trois versets. Ainsi il se rencontrait avec le Réformateur dans une interprétation qu'il croyait avoir été le seul à imaginer et qu'il n'avait communiquée à personne.
Ce fait le troubla et il se retira chez lui.
Il réfléchit longuement à ce qu'il avait vu et entendu, pesa le pour et le contre, et, leur trouvant le même poids, en bon persan qu'il était, il s'en rapporta à Dieu. Il décida donc que le lendemain il se rendrait chez le Bab, qu'il frapperait doucement à la porte. Si contre l'ordinaire c'était le Bab lui- même qui venait lui ouvrir, et si, contrairement aux usages régnant en Perse, celui-ci le prenait par la main pour le faire entrer et le conduisait ainsi jusqu'au salon de réception, c'est que le Bab était réellement le Prophète de Dieu : si les choses ne se passaient pas ainsi qu'il les avait fixées dans son imagination, c'est que Seyyed Ali Mohammed n'était qu'un charlatan. C'était donc à Dieu à régler les choses de façon à ne pas laisser un personnage aussi considérable que Seyyed Yahya dans l'indécision.
Le lendemain donc, il se rendit à la demeure de l'apôtre, frappa et ne put retenir un tressaillement de surprise quand, la porte ouverte, il se trouva face à face avec le Bab qui s'était rendu lui-même à son appel. Ce dernier lui prit la main, le conduisit au salon et ne le lâcha que quand il l'eut fait asseoir. Seyyed Yahya se prosterna et reconnut le Prophète, dont il se déclara l'esclave.
Son maître lui donna I'ordre d'aller prêcher à Bouroudjird, puis à Téhéran et à Yezd, après quoi il devait revenir à Chiraz.
Il obéit et se rendit à Bouroudjird où il avisa son père Seyyed Djaafer de ce qui s'était passé : il écrivit le récit de sa conversion à Mohammed Chah auquel il fit parvenir sa missive par l'intermédiaire de Mirza Louft Ali, gentilhomme de la chambre de S.M. Dès lors, libre de toute attache officielle, il remplit le programme qui lui avait été assigné et commença ses prédications. Quelques oulémas le considérèrent comme fou, d'autres pensèrent qu'il avait été ensorcelé. Nous verrons plus tard qu'il paya de sa vie sa conversion (184).
Cependant les troubles, les discussions passionnées, le scandale continuaient à Chiraz, tant et si bien, qu'importuné de tout ce tapage, anxieux des suites qu'il pouvait avoir, Hadji Mirza Aghaci donna l'ordre à Houssein Khan Nizam ed-Dowlèh, d'en finir avec le Réformateur et de le faire tuer secrètement.
Nizam ed-Dowlèh fit venir le chef de la police pour s'entendre avec lui. On demeura d'accord qu'on ne pouvait songer à un acte public de violence, ce qui serait d'abord désobéir aux ordres de Téhéran et offrait ensuite de grands dangers, vu la qualité de Seyyed du perturbateur. Le préfet de police proposa alors de s'adresser aux voleurs et aux assassins avec lesquels sa profession le mettait tous les jours en contact et de leur proposer ce meurtre moyennant finances. Ce projet fut agréé et l'on décida de réunir un certain nombre de ces gens qui se précipiteraient tous ensemble, la nuit, dans la maison du Bab pour le tuer. «De cette façon, dit le gouverneur, nous déplorerons l'accident dont nous ne serons en aucune façon responsables.»
Le chef de police réunit sans peine les brigands nécessaires à l'opération et après leur avoir bien expliqué ce qu'il attendait d'eux et les mesures de prudence que la situation exigeait, les laissa libres de prendre les dispositions nécessaires. Ceux-ci fixèrent la date de l'assassinat à une huitaine de jours afin de trouver le moment favorable.
Mais, sur ces entrefaites, le choléra avait éclaté dans la ville et y fit subitement des progrès si terribles que tous les habitants s'enfuirent et se dispersèrent. Le Gouverneur et le chef de police avaient été les premiers à se mettre à l'abri du fléau en abandonnant leurs administrés.
Seyyed_Ali Mohammed (185) sortit lui aussi de la ville accompagné de son secrétaire Seyyéd Kazem Zendjani et prit la route d'Isfa.han (Mars 1846). Arrivé à la dernière station avant cette ville, il eut le soin d'écrire au gouverneur, le Géorgien Manoutcheher Khan Meu'temed ed Dowlèh pour le prévenir de son arrivée et lui demander de lui fixer une résidence.
Ce gouverneur était un homme intelligent et libéral, peut-être aussi était-il curieux de voir celui dont toute la Perse s'entretenait; il répondit au Bab en lui accusant réception de sa lettre et lui recommandant de se rendre dans la maison de Mir Seyyed Mohammed. Il prévint en même temps ce dernier d'accueillir l'hôte qu'il lui donnait.
Le prophète obéit et se rendit directement dans la maison qui lui était assignée.
Un jour, sur la demande de son hôte, il écrivit comme jadis en présence de Seyyed Yahya, un commentaire sur la sourate Asr, la 103e du Qoran. Meu'temed ed-Dowlèh en fut informé et vint lui-même voir le Bab avec lequel il causa des divers points de la religion et notamment du Noubouwet Khassé. Le gouverneur d'Isfahan fut très surpris de la supériorité de son interlocuteur et donna l'ordre d'ouvrir un conseil d'oulémas qui fussent chargés d'examiner le Réformateur : il voulait qu'on écrivît le procès verbal de cette séance afin d'envoyer cette pièce à S. M. Mais les oulémas déclinèrent cette invitation en faisant remarquer qu'une discussion sur pareille matière était contraire à la religion. « En effet, disaient-ils, si nous pouvions penser un instant que Seyyed Ali Mohammed peut voir raison dans ses affirmations nous pourrions réunir un conseil pour examiner un point douteux; mais, comme il est de toute évidence que les prétentions de notre adversaire sont en contradiction flagrante avec le Qoran et les ordres de Dieu, nous n'avons aucunement besoin de nous réunir pour faire justice d'un imposteur qui ne mérite que la mort.»
Ils insistèrent sur ce point et déclarèrent au gouverneur que le Bab étant un impie, il devait ou le chasser de la ville ou le faire exécuter.
Meu'téméd ed-Dowlèh fit remarquer que c'était là affaire religieuse qui n'était pas de sa compétence. «Vous n'avez qu'à discuter vous-mêmes avec lui : si c'est un imposteur, prouvez-le; si au contraire ce qu'il dit est vrai, croyez en lui.» Mais le clergé refusa de nouveau.
Les historiens musulmans prétendent qu'alors A Mohammed Mehdi (186), théologien, Mirza Mohammed Hassan Nouri (187;), philosophe, et Mira Seyyed Mohamtned consentirent à tenter l'aventure. On fixa une séance de nuit sous la présidence de Meu'temed ed Dcwléh.
Un procès-verbal, ou du moins un récit de cette séance nous a été conservé par le Nacikh et Tévarikh, et M. Brown l'a recueilli dans un de ses ouvrages.
Je ferai remarquer que la tradition babie nie absolument l'authenticité de cette séance : elle affirme que le clergé persista à refuser toute entrevue officielle avec le Bab. D'autre part, les questions qui ont été posées au Réformateur frisent l'absurdité. Il est étrange que mis en face d'un homme qui se prétend, dit-on, l'imam ez zéman, un théologien comme Mohammed Medhi songe à lui demander: «Les hommes qui sont ornés de la Foi en Mohammed sont enfermés dans les deux voies suivantes : ou ils tirent leurs croyances des hadis mêmes auxquels ils conforment leurs actes, et ce sont là les Moujteheds, ou bien ils suivent les préceptes d'un chef religieux et ce sont les Mouqallèds : au nombre desquels faut-il» te compter?»
Et le Bab aurait répondu: «Je n'ai besoin des avis de personne pour régler mes actions; mais j'estime mauvais qu'un homme n'agisse qu'en s'appuyant sur ses seuls raisonnements.»
«Soit, aurait expliqué Mohammed Medhi, mais tu sais que la Porte de la science divine est fermée (188)» et que la preuve de Dieu est cachée. Dès lors sans avoir vu l'imam Medhi, sans avoir entendu ses explications, comment peux-tu agir avec certitude?» Dis-moi quelle est la source de cette certitude ?»
Question à coup sûr bizarre et qui mérite largement ce dédain du Bab : «Tu n'es qu'un enfant dont la science est empruntée à d'autres. Comment peux-tu m'interroger et discuter avec moi de choses que tu ignores (189), lui répondit-il.»
C'est alors que Mohammed s'étant tu, Mirza Mohammed Hassan, qui suivait la doctrine philosophique de Molla Sadra, interrogea le Bab pour l'inciter à expliquer trois miracles qu'il suffira d'énoncer pour édifier le lecteur.
Le premier est le Teï oul Arz, ou si l'on préfère le transport immédiat d'un personnage quelconque 'd'un endroit du monde à un autre endroit fort éloigné : les chiites sont convaincus que le troisième imam, Djevad, avait adopté cette façon facile et économique de voyager : par exemple il se transporta en un clin d'oeil de Médine en Arabie, à Tous dans le Khoraçan.
Le second miracle est la présence multiple et simultanée d'un même personnage à beaucoup d'endroits différents. Ali, entr'autres, était à la même minute, l'hôte de soixante personnes différentes.
Enfin le troisième est un problème de cosmographie que je soumets à nos astronomes qui en apprécieront certainement la saveur. I1 est dit dans les hadis que durant le règne d'un tyran, le ciel tourne rapidement, tandis que pendant celui d'un imam il tourne lentement. D'abord, comment le ciel peut-il avoir deux mouvements ; et ensuite que faisait-il durant le règne des Ommeyades et des Abbassides (190).
Ce serait la solution de ces insanités qu'on aurait proposée au Bab. Je ne m'y arrêterai pas plus longtemps mais je crois devoir faire remarquer ici la mentalité des savants musulmans de la Perse. Et si l'on veut bien réfléchir que depuis environ un millier d'années la science de l’Iran ne repose que sur de pareilles billevesées, que les hommes s'épuisent en recherches continues sur de pareilles matières, on comprendra facilement le vide et l'arrogance de toutes ces cervelles.
Quoi qu'il en soit la réunion aurait été interrompue par l'annonce du dîner auquel chacun prit part, pour rentrer ensuite chez soi.
Cependant Meu'temed ed Dowlèh crut devoir annoncer à ses convives qu'il savait désormais ce qu'il voulait, qu'on ne l'avait nullement convaincu de l'imposture du Réformateur et qu'au surplus pour éviter toute contestation et avoir l'âme en paix, il allait immédiatement l'envoyer sous escorte à Téhéran.
La tradition rapporte qu'à peine délivré de ses convives Meu'temed ed Dowléh se rapprocha du Bab et lui dit : «Je crois en toi parce que tu es la vérité; ce que j'ai fait, j'ai été obligé de le faire pour te tirer des griffes des oulémas. Dispose de moi comme tu le désireras. Je suis riche et puissant, j'ai un nombre considérable de clients : si tu le veux, j'armerai mon monde et je tuerai tous ceux qui s'opposeront à toi (191).»
Le Bab déclina ces offres et répondit que son oeuvre devait s'accomplir par la force de la persuasion et non par celle des armes.
Le lendemain, c'est-à-dire 40 jours après l'arrivée du Bab dans la maison de l’imam Djoum'éh, Mir Seyyed Mohammed, Meu'temed ed Dowlèh réunit quelques cavaliers, donna une monture au prophète et ordonna à tout ce monde de sortir de la ville en passant par les rues les plus peuplées et les bazars les plus fréquentés, puis de prendre ostensiblement le chemin de Téhéran.
La foule put voir le cortège, le suivre à travers les rues jusqu'à la porte qui donne sur la route de la Capitale et l'accompagner de ses_ voeux ou de ses malédictions. Les oulémas furent informés de ce qui se passait, et, dans leur triomphe comblèrent de louanges le gouverneur qui les débarrassait enfin d'un hôte sacrilège et dangereux.
Mais Meu'temed ed Dowlèh envoya secrètement un de ses confidents à la tête de quelques cavaliers dont il était sûr avec ordre de rejoindre les voyageurs. Il lui remit une lettre pour le chef de l'escorte dans laquelle il faisait connaître à ce dernier qu'il eût à remettre le prisonnier entre les mains du nouvel envoyé. Celui-ci en effet, devait prendre possession de la personne du Bab, le ramener dans le plus grand mystère à Isfahan où il le ferait rentrer de nuit.
Le confident partit, rejoignit le Bab à MourtchèKhar, remit au chef de l'escorte la lettre dont il était porteur, et prenant le Bab, le conduisit par des chemins détournés jusqu'à la ville qu'il venait de quitter. Il attendit la nuit pour y pénétrer et, à travers les rues désertes, le conduisit dans un des palais qui appartenaient au Gouvernement.
Le secret fut admirablement gardé et personne ne soupçonna la ruse. Le Bab vécut ainsi un peu plus de quatre mois dans la plus complète tranquillité recevant fréquemment la visité du gouverneur qu'il instruisit dans la nouvelle religion. Malheureusement Meu'temed ed Dowlèh vint à mourir (192).
Mirza Gourguin Khan son neveu et son seul héritier(193) vint à Isfahan recueillir l'héritage. Il apprit avec surprise quel hôte son oncle avait caché dans une de ses demeures et fort embarrassé, ne sachant que faire, il en référait IHadji Mirza Aghaci.
Celui-ci, fantasque et capricieux, oubliant qu'il .avait peu de temps auparavant ordonné le meurtre du réformateur, sentit naître en lui le désir de voir enfin l'homme qui faisait tant parler de lui : il donna donc l'ordre à Gourguin Khan de le lui envoyer à Téhéran.
Celui-ci obéit et envoya le Bab sous escorte, et sans lui laisser le temps de faire ses adieux à sa femme sur la route de Téhéran. A peine furent-ils arrivés à la dernière station avant cette ville, c'est-à-dire Qénaré Guird, que l'humeur versatile de Hadji Mirza Aghaci changea une fois encore. Il envoya un cavalier pour, faire dire au Bab d'aller attendre de nouveaux ordres, à Qoleïn, village situé un peu en dehors de la grande route. Ce fut là que le Prophète vit pour la première Mirza Housseïn Ali Nouri qui devait lui succéder quelques années après sous le nom de Beha.
Hadji Mirza Aghaci était assez embarrassé de ce qu'il devait faire. Pendant qu'il réfléchissait aux conséquences de la détermination qu'il lui fallait prendre, le Bab écrivit à Mohammed Chah pour lui demander ce qu'on avait décidé à son égard. Le Chah eût voulu le faire venir à Téhéran, mais Hadji Mirza Aghaci fit remarquer que S. M. devant quitter la ville pour effectuer un voyage, l'arrivée de Seyyèd Ali Mohammed ne manquerait pas d'exciter la susceptibilité des, Mollahs et la curiosité peut-être bienveillante de la population, ce qui obligerait le clergé à demander la mort du malheureux Seyyèd. Il valait bien mieux que S. M. donnât les ordres nécessaires pour que ce personnage fût envoyé à Makou jusqu'au retour du Chah, époque à laquelle il serait temps d'examiner l'affaire et d'aviser aux mesures à prendre».
Mohammed Chah s'inclinant devant la sagesse de cet avis répondit de sa propre main (194) : «Comme le camp impérial est sur le point de se mettre en route, votre visite en ce moment ne pourrait avoir que de mauvaises conséquences. Allez à Makou, reposez-vous-y quelque temps. J'ai recommandé qu'on vous traite avec respect. Quand je reviendrai de voyage, je vous manderai auprès de moi (195).»
Une anecdote montre à quels sentiments obéissait le premier ministre: quand il détermina en ce sens la volonté du Chah.
Le prince Ferhad Mirza, jeune encore, était l'élève de Hadji Mirza Aghaci. Il a raconté par la suite:
«Quand S. M. eut pris l'avis de son premier ministre et eut écrit au Bab de se rendre à Makou, nous allâmes avec Hadji Mirza Aghaci passer quelques jours dans le parc qu'il avait lui-même fait planter à YaftAbad, aux environs de Téhéran. J'étais fort désireux d'interroger mon maître sur les événements qui se précipitaient, mais je n'osais le faire devant le monde. Un jour que je me promenais avec lui dans le jardin et qu'il se montrait de bonne humeur, je m'enhardis jusqu'à lui demander : «Hadji, pourquoi avez-vous envoyé le Mab à Makou ?» Il me répondit : «Tu es jeune encore et tu ne peux comprendre certaines choses, mais sache que s'il était venu à Téhéran, nous ne serions pas en ce moment, toi et moi, à nous promener libres de tous soucis sous ces frais ombrages.»
Mohammed Bek, courrier, prit le commandement de l'escorte qui conduisit Seyyièd Ali Mohammed à sa nouvelle résidence.
Les babis commentent très diversement le voyage. Les uns prétendent que la Bab aurait dit à Mohammed Bek qu'il se faisait fort de guérir la maladie du Chah. Cette offre ne fut pas rapportée au Souverain parce que le premier ministre s'y opposa, craignant peut-être un piège. Mais d'autres babis nient absolument ce fait.
Quoi qu'il en soit, le Bab, en cours de route, écrivit au Hadji Mirza Aghaci : «Vous m'avez mandé d'isfahan à Téhéran pour y discuter avec les Mollas : comment se fait-il que vous ayez changé d'avis et me fassiez diriger sur Tébriz et Makou?»
Il arriva ainsi à Tébriz où il demeura 40 jours au milieu de la vive hostilité des Mollas. Là, comme à Chiraz, comme à Isfahan, on convoqua une assemblée des plus éminents docteurs de l'Islam. sous la présidence de Nassr ed dine Mirza, alors Prince héritier et Gouverneur de la province. Nizam-el-Ouléma, Molla Bachi, l'interrogea sur la signification de tel ou tel mot arabe, sur la conjugaison de tel verbe. Il semble que l'on craignît d'entamer avec lui une discussion théologique qui eût pu tourner à la confusion du clergé officiel.
Le Bab fut fort surpris de ces questions et leur répondît: «Il y a bien longtemps que j'ai dépassé le monde des mots et que j'ai rendu la liberté à la parole. Il s'agit ici de matières plus graves et plus hautes.» La conférence ainsi n'aboutit à rien et une autre fut tenue quelques jours après dans la maison de Mollah Mohammed Mamaqani :là on répondit à ses arguments par des coups.
Voici, d'après la version bàbie, le procès verbal de cette séance: «Hadji Mollah Mahmoud, Nizam el Oulema, mollah bachi du Prince Héritier, Molla Mohammed Mamaqani, Hadji Mourteza qouli Mérendi Alem el Houda, prirent place sous la présidence du Veliahd, au milieu d'un grand nombre de fonctionnaires. Le Bab entra seul, sortant du.bain et parfumé.
Il tenait une canne à la main : en entrant il salua, mais personne ne lui répondit. Il s'arrêta un instant, attendant que quelqu'un lui désignat sa place, mais comme personne ne semblait faire attention à lui, il s'assit au bas bout de l'assemblée et se plongea dans des prières.
Soudain Mamaqani l'interpella en ces termes : «O Seyyèd, des écrits circulent parmi les hommes que l'on vous attribue. Nous ne pouvons croire que vous en soyez l'auteur. L'êtes-vous, oui ou non? l
Le Bab répondit : «Ces écrits contiennent les paroles de Dieu, qui sont sorties de ma plume.
- J'ai entendu dire que vous étiez le Bab.
- Oui. _
- Que veut dire ce mot ?
- Qu'avez-vous donc compris de cette parole illustre : Je suis la ville de la science et Ali en est la Porte(196) ?»
Puis le Bab se lança dans une explication au sujet de laquelle il parla de l'oeil, de l'oreille, de la bouche et du nez.
Alors Hadji Molla Mahmoud l'interrompit en ces termes: «Pourquoi dis-tu l'oeil, l'oreille, alors que nous avons deux yeux et deux oreilles.
- O mon âme le sens est un «écoute.»
Le Bab avait deux buts en prononçant ce mot «écoute». D'abord il rappelait Hadji Molla Mahmoud aux termes du contrat, arrêté d'ailleurs hors de sa présence, et d'après lequel, seul Mamaqani assumerait la charge de l'interrogatoire ; et le second sens de ce mot était ceci: «Ouvre l'oreille de ton coeur et comprends Dieu.»
Bref Mamaqani lui dit d'un ton railleur: «Qui donc t'a souhaité le bonsoir en te donnant ce nom de Bab?»
- Je suis Celui que vous attendez depuis mille années.
- Nous attendons le «qaém» de la famille de Mohammed dont le nom est Mohammed fils de Hassan
- C'est moi.
- A quoi pouvons-nous te reconnaître ?
- A mes versets.
Emir Arslan Khan, oncle maternel du Veliahd lui dit alors: «Fais donc descendre des versets au sujet de ta canne.» Le Bab obéit (197).
On se récria, en lui disant: «Nous ne comprenons pas tes versets».
«D'où donc avez-vous compris que le Qoran est le témoin de Dieu ? Ce que vous dites au sujet du Livre sacré, vous devez le redire ici.»
Emir Arslan Khan dit alors en riant, «moi aussi je puis faire des versets» et il se mit à divaguer.
Le Veliahd, entrant à son tour dans l'arène lui dit, en lui jetant une balle qu'il tenait à la main: «Connais-tu l'astronomie, explique-nous les qualités de cette boule.»
- Je ne connais pas l'astronomie.
Quelqu'un demanda : «Que crois-tu au sujet de la prière, quand on doute si l'on en a dit deux ou trois?»
Le Bab répondit.
Alors quelqu'un lui demanda: «Qala, quelle forme est-ce du verbe arabe?»
Le Bab comprenant la dérision de ses adversaires se leva et sortit de l'assemblée (198).
Ces maudits décidèrent qu’il fallait le bâtonner. Le Veliahd ordonna l'exécution de la sentence à ses ferraches, mais ceux-ci refusèrent alléguant qu'ils craignaient pour leur salut éternel dans le cas où ils se permettraient un pareil oubli du respect dû à un descendant de Mohammed. Cheikh oul Islam intervint alors, et ordonna à un Seyyéd de le bâtonner et ce «bâtard» obéit.
Ceci fait, on l'envoya à Makou.
Partout où il avait passé, en dépit ou peut-être à cause de la colère et de la haine des Mollas il avait fait de nombreux prosélytes. Le terrain avait d'ailleurs été admirablement préparé par ses missionnaires, et l'on pouvait suivre dans les consciences les traces lumineuses de son passage.
C'est ainsi qu'il convertit Ali Khan, gouverneur de la forteresse de Makou où il était emprisonné : voici comment la tradition rapporte l'histoire de cette conversion.
Ali Khan Makouï avait, comme tout le monde entendu parler du Réformateur. Comme tous les Persans curieux de questions religieuses, il chercha à s'informer, reçut quelques renseignements et dut reconnaître qu'au moins en tonnant contre les abus, le vice régnant et la pourriture du siècle le Bab avait souverainement raison. Ce qu'il apprit de ses doctrines l'embarrassa fort : le Réformateur pouvait dire vrai, mais sur un terrain aussi mouvant la vérité côtoie de si près le mensonge, il suffit de si peu de chose pour égarer un homme: le moindre sentier de traverse peut vous conduire à l'abîme et le Qoran prévient les fidèles que Satan est habile et qu'il sait donner au faux les apparences de la Vérité.
Il en était là de ses réflexions quant on lui remit le pli officiel lui annonçant qu'il allait devenir le geôlier du Bab. Dés lors il ne connut plus de repos: sa conscience s'inquiétait de la tâche qu'on lui imposait. Si le Bab était un vrai prophète ! Mais d'autre part s'il désobéissait aux ordres qu'il recevait? et si l'illustre captif n'était qu'un vulgaire charlatan ? Il ne pouvait sortir de ce dilemme et voyait tantôt la damnation éternelle qui l'attendait, tantôt plus menaçante encore la colère du gouvernement. Enfin convaincu qu'il aurait beau réfléchir et retourner le problème en tous sens, il ne viendrait pas à bout de la solution il fit comme font tous ses concitoyens dans un cas embarrassant, il s'en remit à Dieu du soin de l'éclairer. II tenterait une épreuve sur le Bab quand celui-ci arriverait et c'était à Dieu à la faire tourner à la gloire ou à la confusion de celui qui se prétendait envoyé par lui
La forteresse de Makou est perchée au sommet d'une montagne d'accès très pénible, et le village du même nom se trouve au pied de la montagne.
Quand le Bab arriva avec son escorte, la première chose qu'il demanda, après les saluts d'usage, fut la permission de se rendre aux bains. Il voulait ainsi se délasser des fatigues du voyage et accomplissait en outre une des obligations de sa doctrine. Il fait en effet de la propreté du corps et des vêtements une des vertus essentielles du vrai croyant.
Ali Khan déféra à son désir et l'envoya dans le village au bas de la montagne. Cette circonstance lui inspira la pensée de tenter l'épreuve décisive qui devait définitivement le fixer sur la valeur du personnage qui était confié à sa garde. Il possédait dans ses écuries un jeune cheval, vicieux, rétif, ombrageux à souhait. Jamais personne n'avait pu le monter et il supportait impatiemment la présence même de l'homme chargé de le nourrir.
Ali Khan résolut d'envoyer cette monture au Bab. Ainsi, se disait-il, si mon prisonnier arrive à se tenir en selle, ce que jamais personne n'a pu faire, c'est que Dieu aura voulu me montrer par ce signe qu'il est bien ce qu'il dit être. Si au contraire comme cela est certain le cheval désarçonne, et tue son cavalier c'est que ce dernier n'est qu'un faux prophète, et j'aurai ainsi débarrassé la Perse et le Gouvernement d'un charlatan dangereux en même temps que je serai délivré d'un hôte coûteux et gênant.»
On eut toutes les peines du monde à seller l'animal. Plusieurs palefreniers furent obligés de s'en mêler, et quelques-uns reçurent force ruades, tant la bête était rétive. Enfin on parvint à l'amener jusqu'à la porte du bain. Ali Khan monta sur le mur de la forteresse pour observer ce qui allait se passer. Les villageois voyant ce cheval, célèbre aux alentours, sellé et tenu à grand peine par plusieurs hommes comprirent le dessein du Gouverneur et se réunirent sur la place pour assister aux événements qui ne manqueraient pas de se produire dans l'un ou dans l'autre sens.
Quand le Bab sortit du bain le chef des domestiques lui dit que le Gouverneur pour lui éviter de gravir à pied le pénible sentier lui avait envoyé son propre cheval en même temps qu'il avait commandé plusieurs palefreniers pour lui faire honneur.
Le Bab s'approcha du cheval qui s'arrêta frémissant, le flatta de la main et de la parole et la bête soumise se laissa monter docilement. On dit même que la contrainte qu'elle exerça ainsi sur elle-même fut si forte qu'une sueur abondante coula de tous ses membres.
Le Prophète pria ceux qui tenaient le cheval de lâcher les brides, et tout doucement sans accident se mit à gravir la pente. ,
Les villageois témoins du prodige se précipitèrent dans le bain et recueillirent l'eau du bassin : ceux qui vinrent trop tard prirent des serviettes avec lesquelles ils essuyèrent ce qui restait encore d'humidité, ce sont autant de reliques.
Ali Khan(199) se rendi au devant du Bab se prosterna devant lui et fit profession de foi entre ses mains.
Le Bab consentit donc à rester à Makou où il vécut pendant neuf mois dans une liberté relative, recevant ceux qui le venaient voir, recevant et expédiant une nombreuse correspondance, écrivant beaucoup.
=====================================
III. MOLLA HOUSSEIN BOUCHROUYEH, LE BAB-EL-BAB
Nous avons vu que le premier croyant à Seyyèd Ali Mohammed fut un personnage nommé Molla Houssein Bouchrouyéhi. ,
Il était, ainsi que son nom l'indique né à Bouchrouyéh, village entre Serdj et Rabat Chour, d'une famille qui s'était illustrée dans la cléricature. Son père lui fit faire de bonnes et fortes études, et bientôt le jeune homme, en sachant autant que ses professeurs se rendit à Nedjef et Kerbéla, où il suivit les cours de Seyyèd Kazem Rechti, l'homme peut-être le plus célèbre de cette époque.
Il partagea avec passion ses doctrines et devenait en même temps que Cheïkhi convaincu, le meilleur et le plus aimé des disciples de son maître. Il se montrait plein d'ardeur, de zèle et d'attention et devait bientôt prouver que son courage était à la hauteur de son dévouement.
En effet, les prédications de Seyyèd Kazem Rechtî avaient profondément remué les consciences musulmanes. Sa science incontestée, son éloquence, la clarté de son jugement et de ses explications avaient propagé d'une façon inattendue les opinions de Cheikh Ahmed Ahçahi. Le clergé officiel -s'épouvantait de voir se développer des nouveautés aussi dangereuses que celles de la non résurrection des corps et de la non existence matérielle du corps de Mohammed dans son ascension miraculeuse au ciel. La pureté légale et rituelle des chrétiens, possesseurs des évangiles, proclamée par Cheikh Ahmed, mettait le comble à leur fureur. Ils se sentaient menacés dans leurs doctrines, ce qui est peu, mais aussi dans leur influence et dans leurs intérêts ; ce qui était autrement grave. Ils voulurent donc employer le seul moyen dont ils pouvaient disposer et qui, jusqu'alors s'était montré efficace: déclarer Seyyèd Kazem Rechti et tous les cheikhis convaincus d'impiété et d'apostasie et les condamner à mort.
Le danger était pressant: déjà la sentence d'excommunion et de mort se couvrait de signatures: tous les oulémas, tous les imans-Djoum'èh, tous les Moujtéheds l'avaient ratifiée de leurs sceaux et de leurs malédictions. Il ne restait qu'à obtenir l'approbation, d'ailleurs certaine, du plus grand d'entre eux, je veux dire Seyyèd Mohammed Bagher Ghilani, surnommé Houdjèt oul Islam.
Ce triste sire exerçait son métier à Isfahan. Il était d'un orgueil, d'une vanité, d'une prétention, d'une insolence et d'une cruauté extrêmes. Sa seule excuse - en admettant que la folie ait besoin d'excusé - était sa conviction qu'il était suscité par Dieu pour châtier, les crimes de la terre. La camisole de force lui eût peut-être rendu la raison, mais par malheur la Perse était depuis longtemps façonnée à de pareilles tyrannies : aussi, non content d'y vivre, y prit-il la place prépondérante. Fier de ce qu'il appelait sa science, hélas ! fier surtout du respect qu'on lui témoignait, du fanatisme qui l'environnait, il s'était fait le justicier de Dieu! Les pauvres diables que l'on surprenait l'haleine fleurant le vin, les pauvres filles accusées de faire métier de leurs corps étaient amenés tremblants en sa présence, et la Bête les tuait de sa propre main. Ces exécutions rapides et hasardeuses avaient semé la terreur dans les âmes, et par un phénomène fréquent, plus on tremblait autour de lui, plus on lui prodiguait les marques du respect. Quand ce monstre mourut, gorgé de sang humain, on attacha son sabre dans la mosquée. Aujourd'hui il opère des miracles ! et le meilleur moyen de se guérir de toutes les maladies est de faire couler de l'eau le long de la lame, de la recueillir à sa sortie par la pointe de l'arme et de la boire. Cet individu auquel il semble impossible de donner le nom d'homme eut un jour l'outrecuidance de reprocher à Mohammed Chah les dépenses que ce roi et son ministre faisaient pour l'achat de fusils et de canons : «Qu'avez-vous besoin de tout cela, lui dit-il, quand vous serez en lutte avec un de vos voisins, prévenez-moi. Je donnerai l'ordre à un gouvernement quelconque de vous expédier les armes dont vous aurez besoin et il obéira.»
C'était là le personnage qui tenait entre ses mains le sort de tous les chéikhis.
Mollah Housseïu Bouchrouyéhi, dès qu'il apprit que le décret fatal allait être soumis à la signature de ce Houdjétoul Islam, n'hésita pas un instant. Il se mit en route pour Isfahan, où il arriva juste à temps. Il réclama la constitution d'une sorte de tribunal des docteurs de l'Islam, arguant qu'on ne peut condamner une doctrine sans la connaître, ni un homme sans qu'on eût entendu sa défense. Il se jetait ainsi tête baissée dans la mêlée, ne se ménageant aucun moyen de retraite décidé à vaincre ou à mourir pour son vieux maître.
Le tribunal se réunit: Bouchrouyéhi pria ses adversaires de lui présenter un à un leurs arguments; ce qu'ils consentirent à faire. Il les réfuta les uns après les autres et, cette joute terminée, il entama un long discours pour démontrer que l'enseignement chéïkhi n'était qu'une interprétation nouvelle du texte sacré et que cette interprétation n'était en aucune façon destructive du Qoran ni de la religion musulmane. Certes, ou pouvait ne pas l'admettre mais, comme elle était conforme au sens apparent ou intime de tels hadis ou de tel verset, on ne pouvait la condamner comme impie. Il fut si fougueux et si éloquent, si emporté et si sincère, il sut si habilement démontrer qu'en acceptant les idées nouvelles il était resté un bon et fidèle musulman, qu'il finit par convaincre une partie de l'auditoire et particulièrement l'homme redoutable de qui tout dépendait.
Il obtint donc les suffrages de ses pairs : on le félicita, on le complimenta de la science et du réel talent qu'il avait montrés et Seyyèd Mohammed Bagher Ghilani déchira de sa propre main la sentence qu'on avait voulu lui faire signer.
Cette aventure fit la réputation de Molla Housseïn, mais lui, dédaigneux des honneurs et de la richesse retourna à Kerbéla où il vécut paisible et tranquille - jusqu'au moment où Seyyèd Kazem étant mort, il se mit à parcourir le monde à la recherche du successeur de son maître.
Il le trouva en la personne de Seyyèd Ali Mohammed, notre héros. L'histoire de sa conversion est assez obscure, mais toujours est-il qu'il crut, - par la vertu du A'hçan el Qessas, semble-t-il, - et que cette conquête parut des plus précieuses au Bab. Il accompagna son nouveau maître pendant son pèlerinage et fut chargé par lui, dès le retour à Bouchir, d'aller évangéliser Isfahan et Téhéran. «Va dans ces deux villes, lui fut-il dit, annonce aux hommes que Dieu m'a manifesté et convertis-les. Où que tu ailles tu recevras de moi des ordres qui t'éclaireront sur ce que tu auras à faire. Pars, et que Dieu soit avec toi.»
Le nouvel apôtre se mit en route et se rencontra à lsfahan avec Akhound Mollah Sadèq Mouqaddès Khoraçani, plus tard connu sous le nom de Asdaq.
Mollah Sadeq Mouqaddès avait quitté son pays poussé par le désir d'aller à Chiraz se rendre compte de ce qui se passait dans cette ville. Arrivé à Isfahan, les oulémas et la population considérant sa présence parmi eux comme une bénédiction de Dieu, l'avaient retenu plus longtemps qu'il ne le désirait. Entouré d'estime et d'affection, il ne savait comment se dégager des liens multiples qui le retenaient, quand il reçut la visite du Bouchrouyèhi. Celui-ci s'empressa de lui dire: «Celui dont nous attendions là manifestation est apparu et il est actuellement à Chiraz. Je l'ai vu, j'ai fait profession de foi entre ses mains et il a fait de moi un missionnaire. Je vais prêcher sa doctrine et convertir à lui les populations.» Puis il lui expliqua longuement ce qu'il avait vu et compris et termina en disant : «D'ailleurs va là-bas toi-même, vois par tes yeux, écoute et tu seras convaincu.»
Mouqaddès n'hésita plus et partit.
Le séjour de Bouchrouyéhi à Isfahan fut un triomphe pour le Bab. Les conversions qu'il opéra furent nombreuses et brillantes, mais lui attirèrent - juste retour des choses d'ici-bas, - la haine féroce du clergé officiel, - devant laquelle il dut s'incliner et quitter la ville.
En effet, la conversion de Molla Mohammed Taghi Herati, jurisconsulte de premier ordre, mit le comble à leur fureur, d'autant que ce dernier plein de zèle montait chaque jour au mimber d'où il parlait aux hommes sans détours de la grandeur du Bab auquel il attribuait le rang de Naiëb khass du 12e imam (200).
Je crois devoir faire remarquer ici que les prédicateurs babis de la première heure ne révélaient à leurs auditeurs qu'une infinie partie de la nouvelle doctrine. Ils se trouvaient en effet au milieu d'une population attendant la venue du Mehdi. Les textes sacrés étaient clairs et promettaient le Sauveur, pour le moment où la terre serait pleine d'iniquités et d'injustices. Or, le spectacle de chaque jour, les abus criants, l'oppression, la violence, la tyrannie dont ils étaient les témoins en même temps que les victimes pouvaient leur faire croire que la mesure était comble et que le terme fatidique était proche. Le Mehdi devait venir et rétablir le Qoran dans sa pureté primitive, puis le sabre à la main conquérir et convertir à la Foi de Mohammed tous les peuples vivant sur la surface du globe. Dès lors, en sa qualité d'Isman il expliquerait ce qui était obscur et caché, et la terre deviendrait ainsi pleine de justice et d'équité. Naturellement ceux qui l'aideraient dans sa tâche recevraient une récompense proportionnée à leurs efforts et à leurs sacrifices.
C'est ce rôle que les Prédicateurs babi assignaient au Bab, c'est lui qu'ils représentaient comme le Mehdi, comme l'Imam Qaëm, comme le Sahab-ez-Zéman. De là, l'empressement de la foule a saluer et à acclamer le nouveau Messie.
Si d'une part on ne pouvait détromper d'un seul coup la foule au sujet du rôle que depuis des centaines d'années elle attribuait à celui qui devait être le Medhi, il va sans dire que de l'autre on présentait la chose sous son vrai jour aux esprits cultivés.
Dans sa route, Mollah Housseïn, toujours porteur du ziaret naméh que le Bab avait écrit pour Ali, et du commentaire de la sourate de Joseph, passa par Cachan où, il convertit Mirza Djani, négociant et futur historien de la Révélation.
Il échoua cependant dans cette même ville de Cachan auprès d'un Moujtehéd, Hadji Molla Mohammed, fils de Hadji Molla Ahmed Nè'raqi. En effet ce personnage lui aurait montré les fautes de grammaire qui auraient émaillé le texte du Ziaret Name et du commentaire de Joseph.
Ce fut toujours en prêchant dans le même sens que Bouchrouyéhi parla à Téhéran et convertit un nombre assez considérable de musulmans et, parmi eux deux frères, l'un Mirza Yahya Nouri(201), l'autre Mirza Housseïn Ali Nouri.(202)
L'auteur du Nacikh et Tévarikh veut que Molla Housseïn ait été porteur d'une lettre de Bab pour le chah et pour Hadji Mirza Aghaci. Mais ces personnages n'auraient répondu que par un ordre d'expulsion.
Quoi qu'il en soit, ce fut à ce moment qu'il reçut du Bab l'ordre d'aller évangéliser le Khorassan.
Cette province était depuis quelque temps déjà en proie à des troubles qui offraient une certaine gravité. A la fin de l'année 1844 ou au commencement de l'année 1845 le gouverneur de Boudjnourd s'était révolté contre l'autorité du chah et s'était allié aux Turkomans contre la Perse. Le prince Acèf ed Dowlé gouverneur du Khorassan, réclama des secours à la capitale. Le général Khan Baba Khan, général en chef de l'armée persane reçut l'ordre d'envoyer 10.000 hommes contre les rebelles, mais là pénurie du trésor l'empêcha d'obéir. Le Chah forma dès lors pour le printemps, le projet d'une expédition à la tête de laquelle il devait se (203) mettre.
Les préparatifs pour cette expédition se poursuivirent avec vigueur. Bientôt dix bataillons de 1.000 hommes chacun furent préparés, n'attendant que l'arrivée du prince Hamzé Mirza nommé général en chef de l'expédition
Tout d'un coup, le gouverneur du Khorassan, Acef ed Dowlè, frère de la mère du roi, se sentant; menacé dans sa sécurité par la suspicion qui s'élevait à Téhéran contre lui, vint à la cour se jeter aux pieds du roi, protester de son entier dévouement à sa personne et demander justice contre ses accusateurs (204)
Or, le principal de ses adversaires était Hadji Mirza Aghaci, le tout puissant premier ministre. La lutte fut donc longue (206) mais se termina par la défaite du gouverneur, qui reçut l'ordre d'aller accomplir, avec la mère du roi le pèlerinage de la Meqqe.
Le fils de Acef ed Dowlè, Salar, conservateur de la mosquée de Mechhed, riche par lui-même, fort de son alliance avec le chef kurde Djaafer Qouli Khan, ilkhani de la tribu Qadjar, prit dès lors une attitude assez hostile, ce qui provoqua l'envoi immédiat de 3.000 hommes et de 12 pièces de canon, en même temps que le gouvernement du Khorassan était donné à Hamzé Mirza (207)
La nouvelle que Djaafer Kouli Khan, à la tête d'une nombreuse troupe de cavaliers kurdes et turkomans avait sabré quelques détachements de l'armée royale provoqua un envoi immédiat de 5 nouveaux régiments et de 18 canons (208).
Ce fut vers le 28 octobre de l'année 1847 que cette révolte sembla complètement réprimée par la victoire de Chahroud (15 septembre) et la dispersion et la fuite de Djaafer Kouli Khan et de Salar.
Si donc le terrain politique semblait favorable à un agitateur, il n'en est pas moins vrai que ce dernier devait se heurter à un tel faisceau d'intérêts que la tâche semblait être au-dessus des forces humaines.
En effet, Mechhed est le plus grand lieu de pèlerinage de toute la Perse, Kerbéla étant, comme on le sait, en territoire ottoman. C'est-là que repose l'imam Riza. Je ne m'appesantirai pas sur les centaines de miracles que le saint Tombeau a opérés jadis et continue à opérer chaque jour; qu'il suffise de savoir que chaque année des milliers de pèlerins se rendent à cette tombe et qu'ils ne s'en retournent chez eux qu'après avoir été soulagés de leurs derniers centimes par les habiles exploiteurs de cette productive industrie. Le fleuve d'or coule sans interruption entre les mains des heureux fonctionnaires. Mais ceux-ci ont naturellement besoin d'une infinité de comparses pour enserrer dans leurs filets leurs innombrables dupes. C'est certes là, l'administration la mieux organisée de la Perse entière. Il s'ensuit que si une moitié de la ville vit de la mosquée, l'autre moitié, elle aussi, est intéressée à l'affluence des visiteurs : je veux parler des négociants, des restaurateurs, des hôteliers et même des filles qui y trouvent autant de maris, à l'heure ou à la journée, qu'elles en peuvent désirer.
Tous ces gens devaient naturellement s'unir contre le missionnaire dont ils ignoraient la doctrine mais qui leur semblait néanmoins menacer leur industrie. Tonner contre les abus était fort bien dans toute autre ville, mais n'était guère de mise là où tout le monde, petits et grands, ne vivait que de ces abus mêmes. Que l'imam Medhi parût, c'était évidemment son droit, mais c'était bien ennuyeux. Certes, c'était très beau de courir le monde avec lui et d'en opérer la conquête, mais c'était bien fatigant et bien hasardeux, puis, on y pouvait recevoir de mauvais coups. Tandis qu'actuellement on était bien tranquille, dans une bonne ville où l’on gagnait de l'argent sans risques et sans péril.
C'était à ces difficultés qu'allait se heurter le missionnaire babi.
Néanmoins celui-ci se mit en route et les débuts de son voyage semblèrent heureux. A Nichapour, en effet, il convertit deux des principaux oulémas : Molla Ali Asker et Molla Abd el-Khaled Yezdi.
Arrivé à Meched il s'installa dans une maison de l'avenue connue sous le nom de Bala Khiaban et recommença ses prédications. Molla Abd el Khaled Yezdi monta sur le mimber de la mosquée cathédrale de Méchhed et proclama la mission du Bab pendant que Molla Ali Asker en faisait autant à Nichapour. Le clergé supporta mal la nouvelle de ce sacrilège et s'en plaignit très vivement au prince Hamzé Mirza, lui demandant la punition des coupables. Or Hamzé Mirza qui avait quitté Téhéran au mois de Ramazan de l'an 1262 (mai 1847) était à ce moment là à Tchéman Rade-an (28 juin 1848). C'est là que lui parvinrent et la plainte des mollas et le rapport que lui écrivait Sam Khan, sujet russe au service de la Perse, sur les événements qui s'étaient succédé à Mechhed durant son absence.
Le prince fit venir auprès de lui Molla Hussein Bouchrouyéhi et le fit emprisonner dès son arrivée au camp: en même temps il manda à ses hommes de poursuivre et de punir ceux qui continueraient à se dire babi et qui ne consentiraient pas à maudire le nouveau prophète. Molla Ali Asker, en vertu de ces ordres, fut amené de Nichapour à Mechhed et, conduit au mimber de la principale mosquée, il se hâta de lancer les malédictions célestes sur le réformateur; Molla Abd el Khaleq, au contraire ne voulut pas se soumettre, et prétendit continuer ses prédications jusqu'à ce que les autres Moujtéheds consentissent à établir une sorte de tribunal où il aurait le droit d'exprimer ses idées. On lui interdit donc l'entrée de la mosquée, et on l'emprisonna chez lui.
Ceci dut se passer après l'assassinat de Mohammed Ali Khan Makouhi par Salar et l'Ilkhani révoltés, comme nous l'avons dit, contre l'autorité royale. En effet, le prince Hamzé Mirza était sorti de Mechhed dans la direction de Bouzendjard pour poursuivre les assassins qui, sans l'attendre, s'enfuirent aussitôt au milieu des Turkomans Akhal. L'hiver survint et Hamzé Mirza, après avoir mis en fuite l'Ilkhani qui alla se réfugier à Hérat, et poursuivi à plusieurs reprises. Salar, qu'il faillit atteindre, tomba gravement malade.
Ce fut ce moment que choisit Salar, qui était alors à Sarakhs, pour exciter, par l'intermédiaire de son frère, Mirza Mohammed Khan, resté prisonnier à Mechhed, une révolte qui coûta la vie à 70 soldats de l'empire. Et ceci se passait le 23 Ramazan 1263. (Mai 1848)
Tout malade qu'il fût, Hamzé Mirza vint camper devant la ville qui se déclarait contre lui et commença une campagne difficile, car tout le Khorassan se levait en faveur de son ennemi. Les vivres commencèrent à se faire rares au camp impérial et nul doute que ce fut à ce moment que Mollah Houssein recouvra sa liberté.
Il rentra dans la ville, probablement au moment où la population faisait, mais en vain, le siège de l'ark resté au pouvoir du gouvernement et défendu par des artilleurs.
En effet, l'auteur du Mirhat oul Bouldan ajoute que la guerre se prolongea plusieurs mois, puis annonce, après l'accession au trône de Nassr ed dine Chah, le jeudi soir 20 novembre 1848, la nomination comme gouverneur du Khorassan de Soultan Mourad Mirza, Yçam oul Saltanéh, pour le dernier mercredi du mois de Sefer 1264, c'est-à-dire environ deus mois et demi après la cérémonie du sacre.
Toujours est-il que Mollah Housseïn reparut à Mechhed, je pense vers le milieu de juillet 1848, dans le quartier de Baba Qoudret, faubourg de la ville. Il fut vite reconnu, et, comme on ne lui accordait pas l'entrée dans Mechhed même, il s'en fut vers Nichapour où il convertit plusieurs personnes. De là il se rendit à Sebzevar où il convertit entr'autres gens Mirza Taghi Djoveïni, et Avaré Nigar.
De là il se mit en route pour Meïaméi, et croisa en route le village de Yardjemende. A Seyyèd Mohammed qui était le premier de ce village l'invita, lui et ses compagnons, à venir se reposer chez lui. Les domestiques apportèrent tout d'abord le qalian et le café et Mollah Housseïn déclara que le tabac était interdit suivant la nouvelle religion. Ceci fut l'origine d'une discussion qui ne se termina que par le départ des babis, qui, sur leur route rencontrèrent le village de Khankhodi (209). Ils y séjournèrent et plusieurs musulmans se convertirent à eux, entr'autres Molla Hassan et Mollah Ali.
Enfin Molla IIousseïn se rendit à Meiameï où il amena à sa foi, environ 36 personnes. Cela occasionna dans la ville une révolution à la suite de laquelle le missionnaire babi se rendit à Chahroud où il descendit dans la maison d'un Moujtéhèd nommé Molla Mohammed Kazem. Comme il cherchait à convertir son hôte, celui-ci furieux des blasphèmes qu'il entendait, chassa tous les compagnons de la ville. Ils allèrent alors à Bestam où ils apprirent la mort de Mohammed Chah (le 4 septembre 1848). Mais les oulémas de la ville lui interdirent l'entrée, et lui et ses compagnons furent obligés d'aller camper à deux farsakhs de là, dans un village nommé Houssein Abad, où la conversion de Molla Ali Housseïn Abadi vint les consoler de ce dernier déboire.
Ce fut alors que Molla Housseïn, avec tout son monde, se dirigea vers Bedecht.
=====================================
IV. QOURRET-OUL-Aïn HAZRET-E-TAHERE, LE CONCILE DE BEDESHT
L'une des plus grandes familles de Casvine, je veux dire des plus grandes tant par les hautes positions que ses divers membres occupaient dans la hiérarchie ecclésiastique que par la réputation de science qui les environnait, était, sans contredit, la famille de Hadji Mollâ Salèh Baraqani.
Il avait un frère Mollah Mohammed Taghi Baraqani qui reçut, après sa mort le titre de «Chahid Salis», c'est-à-dire troisième martyr.
Nous reprendrons d'un peu haut leur histoire pour faire bien comprendre tant leur rôle dans les dissensions religieuses de la Perse que la catastrophe que devait fatalement amener le caractère altier et l'orgueil du frère de Molla Saléh.
Quand le grand Moujtéhed A Seyyèd Mohammed arriva à Casvine, quelqu'un lui demanda si Hadji Molla Salèh Baraqani était un Moujtéhèd. «Certes», répondit le Seyyèd, et cela, d'autant plus que Salèh était de ses anciens élèves, qui, vers le tard avait suivi les leçons de A Seyyèd Ali.
«Fort bien», lui répondit son interlocuteur, mais son frère Mohammed Taghi, est-il, lui aussi, digne de ce titre sacré? A Seyyèd Mohammed répondit en louant les qualités et la science de Taghi, mais évita de donner une réponse précise à l'interrogation directe qu'on lui avait faite.
Ceci n'empêcha pas l'interrogateur de répandre dans la ville le bruit que Seyyéd Mohammed lui-même reconnaissait la maîtrise de Taghi, qu'il avait déclaré Moujtéhùd en sa présence.
Or Seyyéd Mohammed était allé habiter chez un de ses collègues, Hadji Molla Abdoul Vehhab : celui-ci eut vite connaissance du bruit ainsi répandu, et faisant venir chez lui l'interlocuteur du Seyyèd, le tança vertement, en présence de témoins.
Naturellement le bruit de cette intervention, amplifiée de bouche en bouche, parvint jusqu'aux oreilles de Taghi qui, furieux en lui-même se bornait à dire chaque fois que le nom de Molla Abdoul Vahhah frappait ses oreilles : «Je ne le respecte que parce qu'il est le fils de mon maître bien-aimé.»
Seyyèd Mohammed, ayant été mis au courant de tous ces incidents et de toutes ces rumeurs, comprenant qu'il avait contristé l'âme de Taghi, vint un jour lui demander à déjeuner, le traita avec beaucoup de distinction, lui écrivit son brevet de Moujtéhéd et, ce jour-là même, l'accompagna à la Mosquée, et, la prière terminée; s'assit sur les degrés de la chaire d'où il fit l'éloge de Taghi et le confirma, en pleine assemblée, dans sa nouvelle dignité.
Or, un peu plus tard, vint à passer par Casvine Cheikh Ahmed Ah'çahi. Ce personnage; dit l'auteur très pieux du Qessas oul Ouléma, fut déclaré impie car il voulut rapprocher la philosophie de la loi religieuse, «et tout le monde sait que, dans la plupart des cas, vouloir mêler l'intelligence et la loi religieuse est une chose impossible.» Quoiqu'il en soit, Cheikh Ahmed s'éleva fort au-dessus de ses contemporains, et beaucoup d'hommes partageaient son opinion. Il avait des sectateurs dans toutes les villes de la Perse, et le Chah Feth Ali le traitait avec beaucoup de considération quoiqu'Akhound Molla Ali eût, parait-il dit de lui. «C'est un ignorant au coeur pur».
A son passage à Casvine, il alla habiter la maison de Molla Abdoul Véhhab, désormais l'ennemi de la famille Baraqani. Il allait prier à la Mosquée paroissiale et les oulémas de Casvine y venaient prier sous sa direction. Il rendit naturellement à ces saints personnages toutes les visites et toutes les amabilités qu'il en avait reçues : il était fort bien avec eux, et ce ne fut bientôt plus un mystère pour personne que son hôte était de ses disciples.
Un jour, il se rendit chez Hadji Molla Taghi Baraqani, qui le reçut avec tous les dehors du plus profond respect, mais profita de sa présence pour lui poser quelques questions insidieuses.
«En ce qui concerne la résurrection des morts au jour du jugement, lui demanda-t-il, votre opinion est-elle celle de Molla Sadra?»
«Non», dit Cheikh Ahmed.
Alors Taghi interpellant son plus jeune frère Hadji Mollah A1i: «Va, lui dit-il, dans ma bibliothèque et apporte-moi le Chévahed Rouboubiyieh de Molla Sadra.»
Puis comme Hadji Molla tardait à revenir, il dit à son interlocuteur : «Je ne discute pas avec vous, à ce sujet, mais je suis cependant curieux de connaître votre opinion sur la matière.»
Le Cheikh répondit : «Rien n'est plus facile. D'après moi la résurrection n'aura pas lieu avec notre corps matériel, mais avec son essence : et j'appelle, essence, par exemple, le verre qui est en puissance dans la pierre.»
«Pardon, rétorqua méchamment Taghi, mais cette essence est autre que le corps matériel, et vous savez qu'il est de dogme, dans notre sainte religion de croire à la résurrection de ce corps matériel lui-même.»
Le Chéikh fut naturellement interloqué, et ce fut en vain qu'un de ses élèves, natif de Turkestan, voulut détourner la conversation en entamant une discussion qui menaçait d'être longue, le coup, était porté, et Chéikh Ahmed se retira, convaincu qu'il s'était compromis.
Il ne tarda pas à s'apercevoir que sa conversation avait été soigneusement rapportée par Taghi, car le jour même il se rendit à la mosquée pour prier et il fut suivi du seul Abdoul Vehhab.
Les choses menaçaient donc de se gâter, et Abdoul Vehhab crut avoir trouvé le moyen d'aplanir toutes les difficultés en suppliant son maître d'écrire et de publier un traité dans lequel il affirmerait la résurrection du corps matériel. Il avait compté sans la haine de Taghi. En effet, Chéikh Ahmed écrivit ce traité qui se trouve encore dans son volume intitulé Adjevébét-oul-Mleçal, mais personne ne le voulut lire et le bruit de son impiété grandissait tous les jours. Ce fut au point que le Gouverneur de la ville le Prince Ali Naghi Mirza Rouhn ed Dowlë considérant l'importance des personnages engagés dans la lutte et craignant d'être accusé d'avoir laissé germer la discorde, résolut de tenter un accord. Il invita, une nuit, à un grand dîner tous les oulémas illustres de la ville. Chéikh Ahmed avait la première place, et près de lui, séparé par un seul personnage était assis Taghi. On apporta les plateaux préparés pour trois personnes, de telle sorte que les deux ennemis se trouvassent obligés de manger ensemble.
Mais Taghi, irréductible se tourna vers le plateau de ses voisins de droite, et, au grand scandale du Prince, mit sa main gauche devant la partie gauche de sa figure de façon à ce que son regard ne rencontrât pas, même involontairement, la personne de Chéikh Ahmed.
Après le repas, qui fut plutôt morne, le Prince, persistant dans son idée de réconcilier les deux adversaires fit un grand éloge de Chéikh Ahmed, disant qu'il était le plus grand des docteurs arabes et persans, que Taghi devait lui témoigner le plus grand respect et qu'il n'était pas convenable qu'il prêtât l'oreille aux propos des gens qui voulaient amener la guerre entre deux intelligences d'élite.
Il fut violemment interrompu par Taghi qui déclara d'un ton de souverain mépris : «Il ne peut y avoir aucune paix entre l'impiété et la foi : le Chéikh a, en ce qui concerne la résurrection, une doctrine contraire à la loi islamique. Or, celui qui partage cette doctrine est un impie. Que peut-il y avoir de commun entre un révolté et moi ?»
Le prince eut beau insister, prier, Taghi n'en voulut pas démordre et la séance fut levée.
La guerre était bien et dûment déclarée et Taghi la poussa vigoureusement; il ne cessait de maudire le Chéikh au point qu'un jour l'auteur du Qessas el Ouléma se trouvait dans la bibliothèque de Taghi, quand des plaideurs vinrent trouver le Moujtéhed. I1 s'agissait d'un héritage laissé en entier par le défunt à un de ses parents chéikhis alors que les autres, musulmans, protestaient de toute leur force. Taghi les interrompit bien vite en leur disant : «Un legs fait selon toutes les règles à un impie est nul de plein droit, c'est vous, musulmans, qui avez raison». Et se tournant vers le spectateur muet de cette scène il lui dit : «Les chéikhis se sont unis avec les philosophes et disent : Un être qui agit ne peut accomplir qu'une action, et cela est impie.»
Le Cheikh ne put rester plus longtemps à Casvine où sa situation devint bientôt intenable, et le bruit des malédictions qui l'accablaient s'étant répandu dans toute la Perse, il voulut aller à la Meqqe en passant par l'Iraq arabe: mais il mourut à Baçrah encours de route.
Il laissait beaucoup d'élèves et parmi eux A Seyyéd Aboul Hassan fils de Seyyèd Mohammed Housseïn Tounouhabouni, et Seyyéd Kazem Rechti qui, habitant à Kerbélah, devint son successeur.
La mort de Chéikh Ahmed ne mit pas fin aux discussions soulevées par Taghi ; le bruit de ses malédictions s'était répandu partout, mais personne ne savait au juste à quoi s'en tenir. Aussi ne tarda-t-on pas à interroger à ce sujet le célèbre A. Seyyèd Mehdi (210) qui n'avait pas encore fait connaître son opinion. Celui-ci, peu désireux de prendre seul la responsabilité d'un pareil jugement réunit un tribunal de docteurs, devant lequel comparut A Seyyéd Kazem. Les principaux Oulémas qui s'étaient constitués ses juges étaient Chérif el-Ouléma et Hadji Molla Mohammed Djaafer Asterabadi.
On lut quelques passages des oeuvres de A. Chéihh Ahmed, et l'on fit constater au comparant qu'en apparence, tout au moins, ces paroles étaient impies.
«C'est vrai, constata Seyyèd Kazem, mais toutes les paroles du Chéikh ont un sens intime, et seul ce sens est le vrai.»
«Soit, répondirent les Oulémas, mais nous ne sommes, nous autres, chargés que de commenter le Qoran et les hadis des imams, et non pas les paroles d'un chacun. Nous ne pouvons commenter les paroles des impies qui disent des impiétés, pour démontrer qu'ils sont fidèles. Écrivez qu'en apparence les livres de Chéikh Ahmed sont impies.»
Seyyèd Kazem obéit, et scella de son sceau sa déclaration.
Alors Seyyèd Mehdi- sans donner de fetva - se basant sur le témoignage des deux oulémas déclara à haute voix que Cheikh Ahmed et ses élèves étaient des infidèles.
De là, il se rendit à la Mosquée où il fit un sermon dans lequel il dit que dans ce siècle il s'est trouvé des loups qui ont revêtu des peaux de brebis pour entrer clans la bergerie de Mohammed. Dès qu'ils y furent entrés ils se mirent à saper les bases de sa religion : et ces loups, ce sont Chéikh Ahmed et ses disciples.
Dès lors il fut nettement établi qu'un chéikhi est un impie, mais le premier qui les condamna fut Taghi. Il ne fut suivi qu'un peu plus tard par A. Seyyéd Méhdi, Hadji Asterabadi, Cherif el Ouléma. Puis Akhound Molla Agha Derbendi, A Seyyèd Ibrahim, Chéikh Mohammed Hosseïn Sahab fouçoul, Cheikh Mohammed Hassan Nedjefi, et presque tous les oulémas suivirent les mêmes errements.
Cheikh Ahmed croyait donc à la résurrection de l'essence des corps. En effet, les philosophes Échraq croient au monde Méçal (c'est-à-dire au monde des doubles) qu'ils appellent Alem Méçal, Alem Echbah, Alem Azellé, Kouh-é-kaf, Eqlim Samen, Chehr Djab-oul Qa ou Djab-oul Ça, Hour Qélia. Ce monde est immédiatement sous le ciel de la lune et les gens qui y habitent ont bien un corps, mais dépourvu de matière. La croyance générale est que l'âme après avoir quitté le corps va dans cette forme double : là règnent la nuit et le jour conformément à ce verset du Qoran : Leur nourriture leur vient nuit et jour.
C'est en se basant sur ce verset que Imam Djaafer ous Sadeq croit à l'existence du monde Barzakh (sorte de purgatoire). Là l'homme, s'il est dans la voie de Dieu, reçoit la miséricorde du Seigneur, s'il est de ceux qui doivent recevoir le châtiment, il le subit. Ils restent là jusqu'au jugement dernier, alors, de cette forme double ils rentrent dans leur corps matériel. Il faut donc que celui-ci trouve la force de vivre dans l'éternité, comme l'âme. Il faut donc bien qu'il y ait un monde barzakh ou moyen, et que ce monde ne soit ni comme le monde d'ici-bas qui est périssable, ni comme l'autre qui est éternel. C'est dans ce monde-là que Ali vient à la tête de chaque mourant qu'il soit ou non fidèle et c'est la- l'application de ce vers de l'Emir des croyants :
O fils d'Emdan, quiconque meurt me voit, qu'il soit croyant on infidèle.
Seyyèd Mourteza dit qu'il est impossible qu'un corps se trouve en même temps en plusieurs endroits, et qu'Ali s'y trouve veut simplement dire que le mourant voit l’utilité et le fruit de la lumière du Véli, et non sa personne.
Les Chiites au contraire croient que le mourant voit la personne même d'Ali comme on voit le soleil dans quelqu'endroit que l'on soit. Quelques-uns, orthodoxes, croient qu'on voit le double du corps d'Ali car les personnages très saints ont la puissance de se répandre dans un nombre infini de corps doubles comme l'ont fait les prophètes, et c'est là l'explication de la présence simultanée d'Ali en 60 endroits différents.
Bref Chéikh Ahmed croit que le corps de l'homme est composé d'éléments empruntés aux neuf cieux et aux quatre éléments : quand l'âme quitte le corps, chacune des parties de ce dernier retourne à son élément, et rien n'en reste si ce n'est les parties des cieux, ou parties célestes qui reparaissent au jour du jugement. Il n'y a aucun doute que ceci soit contraire à la doctrine de l'islam qui enseigne la renaissance des quatre éléments.
El n ce qui concerne le Mihradj, ou ascension céleste de Mohammed voici l'explication donnée par Chéikh Ahmed. Quand le prophète fit son ascension il rendit à l'eau ce qui appartenait à l'eau, à la terre ce qui appartenait à la terre, l'air à l'air et le feu au feu. Ce n'est qu'avec ses éléments célestes qu'il pénétra dans les cieux. Il ne fut donc pas nécessaire que les cieux s'ouvrissent pour lui livrer passage.
Les chiites croient que le prophète alla aux cieux avec son corps, ses vêtements et même ses pantoufles jaunes. Il y pénétra parce que les éléments qui composaient son corps étaient plus délicats que la matière céleste tel un génie pénètre dans une maison dont, tontes les ouvertures sont fermées, sans avoir besoin d'ouvrir les murs.
Chéikh Ahmed croit que les imams sont les quatre éléments de la création du monde: il en fait donc des associés à Dieu, et c'est là impiété notoire. Les chéikhis disent bien que les imams ne sont actifs qu'avec la permission de Dieu, ce sont des sortes de fondés de pouvoir, mais leur doctrine n'en est pas moins haïssable aux yeux de tout bon musulman: je sais bien qu'ils l'appuient sur le Qoran et sur les hadis. Dieu dit lui-même au sujet de Jésus: «quand il eut crée de la terre comme une forme d'oiseau». Ali, n'a-t-il pas dit : «Je suis le Créateur du ciel et de la terre» Les chéikhis prétendent que si Dieu crée quelqu'un qui, avec sa permission, crée le ciel et la terre c'est démontrer sa hauteur et sa sublimité.
Cependant, disent les chiites attribuer la création et la nourriture à des imams est une impiété. Ceux qui pensent ainsi sont les Moufavvézés, et c'est à tort qu'ils pensent ainsi car le Sahab ouz zéman a écrit dans une de ses lettres pendant son Qéibet :«Quiconque m'attribuera la création du monde, ou à mes pères, est un impie».
C'est là l'opinion universelle.
Si nous avons un peu insisté sur l'histoire de Chéikh Ahçahi et de ses doctrines, c'est avant tout pour mettre le lecteur à même de juger les évènements qui vont suivre, et ensuite parce que Cheikh Ahmed Ahçahi et Seyyèd Kazem Rechti sont considérés par le Bab lui-même comme les deux portes de sa religion : ce sont ses deux précurseurs qui sont venus préparer le monde à sa manifestation.
Ceci dit, revenons à l'histoire de la famille Baraqani.
Molla Salèh avait, parmi ses enfants une fille, Zarrine Tadj - la couronne d’or - qui attira sur elle l'attention dès sa plus tendre enfance. Au lieu de se livrer comme ses congénères aux jeux et aux amusements, elle passait des heures entières à écouter les conversations dogmatiques de ses parents. Sa vive intelligence s'assimila rapidement le fatras de la science islamique, sans s'y noyer et bientôt elle fut à même de discuter sur les points les plus obscurs et les plus confus: les traditions (hadis) n'eurent plus de secrets pour elle. Sa réputation s'était bien vite répandue dans la ville et ses concitoyens la considéraient, à juste titre, comme un prodige.
Prodige de science, mais aussi prodige de beauté; car l'enfant grandissante était devenue une jeune fille dont le visage étincelait d'une si radieuse beauté qu'on lui avait donné le surnom de Qourrèt-oul Aïne- que M. de Gobineau traduit «la consolation des Yeux».
Son frère, Abd oul Vahhab Qasvini, qui hérita de la science et de la réputation de son père, racontait lui-même, quoique resté, en apparence du moins, musulman :«Nous tous, ses frères, ses cousins, nous n'osions parler en sa présence, tant sa science nous intimidait, et si nous nous hasardions à exprimer une hypothèse sur un point de doctrine contesté, elle nous démontrait d'une façon si nette, si précise et si péremptoire que nous faisions fausse route, que nous nous retirions tout confus».
Elle assistait aux cours de son père et de son oncle dans la même salle que deux ou trois cents étudiants, mais cachée derrière un rideau et plus d'une fois, elle réfuta les explications que ces deux vieillards proposaient sur telle ou telle question.
Sa réputation devint immense dans la Perse savante et les plus hautains oulémas consentirent à adopter quelques-unes de ses hypothèses ou de ses opinions. Le fait est d'autant plus remarquable que la religion musulmane chiite a placé la femme presque au rang de l'animal : elle n'a pas d'âme et n'existe guère que pour la reproduction.
Elle épousa, toute jeune encore, le fils de son oncle, Mohammed Qasvini, qui était imam Djoum'eh de la ville et, par la suite, se rendit à Kerbélah où elle assista aux leçons de Seyyed Kazem Rechti. Elle partagea avec passion les idées de son maître, idées qu'elle connaissait déjà d'ailleurs, Qasvine étant devenu un foyer des doctrines Cheikhies.
Elle était, comme nous le verrons par la suite, d'un tempérament ardent, d'une intelligence nette et lucide, 'd'un sang froid merveilleux et d'un courage indomptable.
Toutes ces qualités réunies devaient l'amener à s'occuper du Bab dont elle entendit parler dès son retour à Qasvine. Ce qu'elle en apprit l'intéressa si vivement qu'elle entra en correspondance avec le Réformateur et que, bientôt convaincue par lui, elle fit connaître sa conversion urbi et orbi. (1848)
Le scandale fut immense et le clergé consterné. En vain son mari, son père, ses frères la conjuraient-ils de renoncer à cette dangereuse folie, elle resta inflexible et proclama hautement sa foi.
Il est parfaitement inexact qu'elle ait, dès de moment, rejeté l'usage du voile et se soit montrée dans les assemblées à visage découvert. Un oubli aussi complet de toutes les lois les plus sacrées eût été promptement et sévèrement châtié. Le préjugé est trop fortement enraciné dans l'esprit des Persans pour qu'elle eût ainsi osé le braver, sans aucune utilité d'ailleurs.
De plus, jusqu'au moment du concile de Bedecht le mot d'ordre, pour ceux qui connaissaient les secrètes pensées du Bab, était d'annoncer que les promesses contenues dans le Qoran s'étaient réalisées, que l'Imam caché s'était manifesté et qu'il allait soumettre le globe à la religion de l'Islam. Ç'eut été une singulière aberration que de contrevenir aux lois, qu'on annonçait comme devant être si prochainement triomphantes.
Ces deux raisons suffisent à démontrer l'erreur dans laquelle est tombé M. de Gobineau: d'ailleurs nous allons voir bientôt où et comment Qourret oul Aine parut pour la première fois devant une foule, à visage découvert.
Quoi qu'il en soit, le scandale allait, augmentant tous les jours, aussi fut-ce avec un soupir de soulagement que sa famille lui vit accepter la proposition qui lui était faite de retourner à Kerbélah. On espérait bien d'une part que son absence la ferait oublier et d'autre part que la Majesté des lieux saints l'amènerait à résipiscence.
Mais ce fut en vain qu'elle accomplit le voyage, et, en face des tombeaux bienheureux des martyrs elle resta aussi résolument babie qu'elle l'était à Qasvine, et devant la gravité que prenait son attitude au centre même du fanatisme chiite, sa famille crut devoir la faire revenir.
Hadji Mohammed Hammami fut chargé de cette mission avec plusieurs domestiques de sa maison. Voici comment il a raconté son voyage : «J'arrivai à Kerbélah et me rendis immédiatement auprès de Qourrèt oul Aïne; je lui remis les lettres dont j'avais été chargé par son père, son époux et son oncle. Je la suppliai d'obéir aux ordres qu'elles contenaient et mes instances finirent par la convaincre. Je lui fis préparer un kedjavé et nous nous mîmes en route. Des babis l'accompagnèrent jusqu'au bois de dattiers qui est proche et où ils prirent congé d'elle.»
«J'étais fort heureux d'avoir réussi dans ma mission et ne pensais qu'à la joie du retour, quand soudain, après avoir dépassé la dit bois, je fus rejoint par quelques cavaliers qui s'approchèrent du kedjavé, saluèrent respectueusement Qourrêt oul Aïne et se mirent à l'escorter.»
«Quand nous arrivâmes à la station, ce furent eux qui l'installèrent à une certaine distance de nous et qui s'empressèrent à son service.»
«Il en fuit ainsi tout le long du voyage, et quand nous arrivâmes à Qasvine, les cavaliers se dispersèrent dans toutes les directions.»
«Je conduisis Qourret oui Aïne dans la maison de son père à qui je rendis compte de ce que j'avais vu. Hadji Molla Taghi, qui était présent à l'entretien, se montra fort irrité, et recommanda à tous les serviteurs d'empêcher cette femme de sortir de la maison sous quelque prétexte que ce fût, et de ne permettre à personne, sans une autorisation expresse de sa part à lui, devenir la voir.»
«Ces recommandations faites, il se rendit chez la voyageuse et voulut par la persuasion, la convaincre de l'erreur dans laquelle elle s'était engagée. Il ne put y réussir, et outré de fureur devant ce calme et cette conviction, il ne put s'empêcher de maudire le Bab et de le couvrir d'injures.»
Qourrèt oui Aïne le regarda alors en face et lui dit: «Malheur à toi, car je vois ta bouche se remplir de sang.»
Dés lors elle fut étroitement surveillée et se bornait pendant le jour à se promener dans ce qui constituait sa prison en chantant des psaumes et des cantiques.
Une nuit, des hommes armés forcèrent l'entrée : la prisonnière les reçut, les fit entrer et prononça un sermon qui dura plus de deux heures.
Ces faits s'étant renouvelés, on prévint Hadji Molla Taghi qui, se laissant aller à la colère, insulta sa nièce et la bâtonna.
Cependant l'effervescence augmentait tous les jours en ville : les babis de Qasvine ne pouvaient dissimuler leur joie, et ces marques d'allégresse augmentant d'autant la fureur des Musulmans : ce ne furent plus que discussions enfiévrées, insultes mutuelles, troubles sans cesse renaissants. Qourrèt oul Aïne toujours en correspondance avec le Bab venait de recevoir de lui l'ordre d'aller évangéliser les provinces. Ce fut d'ailleurs à ce moment que Seyyèd Ali Mohammed fut enfermé à Makou.
Les événements se précipitaient donc et il devenait urgent d'aviser. L'emprisonnement du Prophète pouvait être le prélude d'une exécution sanglante : déjà, sur quelques points, des babis isolés avaient été massacrés et la persécution s'annonçait menaçante. Si l'on ne prenait énergiquement des mesures immédiates, on risquait de voir toute cette agitation tomber comme elle était née et la nouvelle religion se noyer dans des torrents de sang. Et cette religion même, ne fallait-il pas enfin la dévoiler aux yeux de ses sectateurs qui la suivaient sans se douter de ce qu'elle était en réalité et où elle pouvait les conduire. Ne fallait-il pas enfin aviser aux moyens de tirer le Bab de la situation dans laquelle il se trouvait, dangereuse et pénible.
Toutes ces questions faisaient l'objet d'une correspondance active entre les divers chefs babis, et ce fut précisément pour en rechercher la solution que fut décidée une réunion générale que nous avons appelée le Concile de Bedecht.
Il fallait donc que Qourret oul Aïne songeât à quitter Qasvine; mais il lui restait auparavant à punir l'impie qui avait osé, en sa présence, proférer l'anathème sur le Bab.
Molla Mohammed Taghi avait pour habitude de sortir avant le lever du soleil pour aller dire les prières du matin dans la mosquée : il n'y trouvait jamais que le domestique chargé de l'entretien du temple et deux ou trois mendiants.
Ce matin-là, il était à peine entré dans la mosquée qu'un individu le frappa à la bouche d'un coup de lance, réalisant ainsi la prédiction que lui avait faite sa nièce. Cinq ou six autres assassins se jetèrent sur lui et l'achevèrent à coups de sabre et de couteau. Cet exploit accompli, chacun tira de son côté, laissant la victime où elle était tombée.
Le tumulte fut effroyable dans la ville. Ce sacrilège audacieux fit tressaillir le coeur de tous les Musulmans : ils proclamèrent solennellement Molla Mohammed Taghi martyr de la foi islamique et réclamèrent à grands cris la punition des coupables.
Le gouverneur fit arrêter tous ceux qu'il soupçonnait d'être babi et il en référa immédiatement à Mohammed Chah.
Sur ces entrefaites, un Arabe, Cheikh Saleh, se déclara seul coupable de l'assassinat.
On fit surveiller étroitement Qourrèt oul Aïne, mais l'enquête fut longue, et une belle nuit des babis vinrent qui l'enlevèrent. On la fit monter à cheval et la troupe, sortit de la ville par une brèche de la muraille d'enceinte.
Naieb Qouli, devenu par la suite ferrache du Chah, raconte ainsi cette fuite: «J'étais parmi les domestiques qui accompagnaient cette femme. Dès que nous fûmes sortis de la ville nous abandonnâmes la grande route et suivîmes celle du Zah'ra de Qasvine. Nous arrivâmes en voyageant ainsi jusqu'à Endermâm, aux environs de Chahzadé -Abd Oul Azim. Arrivés là, elle me remit une lettre avec ordre de la porter à Téhéran, à la maison de Mirza Bouzourg Nouri où je devais la remettre à Mirza Hosseïn Ali (211)»
«J'arrivai en ville de bon matin et je remis ma lettre entre les mains de son destinataire. Celui-ci m'ordonna de retourner à Endermane et d'annoncer qu'il s'y rendrait lui-même dans l'après-midi. En effet, cinq heures environ avant le coucher du soleil, Mirza Hosseïn Ali, accompagné de quelques cavaliers tenant des chevaux sellés par la bride, vint nous rejoindre. Qourrèt oul Aïne se retira pour changer de vêtements et monta sur un cheval dont la bride était en or. Chacun de nous enfourcha les chevaux que l’on avait amenés et nous nous mîmes en route, une heure avant le coucher du soleil. Deux heures après nous étions dans la maison de Mirza Hosseïn Ali. Nous y restâmes plusieurs jours durant lesquels Qourrèt oul Aïne reçut de nombreuses visites.
«Cinq jours environ après notre arrivée je fus surpris de voir qu'il n'y avait plus qu'un seul domestique dans la maison : il me servit le thé, m'annonça qu'un cheval était sellé pour moi à l'écurie et me dit de me rendre à Mesker Abad; près de Sourkh Eçar. J'arrivai à ce village avant le déjeuner et j'y vis, beaucoup de monde et de nombreuses tentes. Qourrèt oul Aïne me fit venir, me demanda si je voulais me convertir au babisme, et, sur mon refus, me donnant plusieurs poignées de pièces de monnaie elle me dit: «Cette nuit encore tu es mon hôte, mais demain matin tu repartiras pour Téhéran.»
«Après le dîner elle partit avec son monde, et le lendemain je rentrais en ville avec quelques domestiques qui n'avaient pas voulu la suivre. J'appris alors qu'elle se rendait au Khorassan.»
Ce fut, en effet, la route qu'elle prit, pour se rendre à Bedecht où elle se retrouva avec Molla Housseïn Bouchrouyéhi, le Bab el-bab, Mirza Housseïn Ali, Quouddous et d'autres, arrivés avant elle.
Ces personnages discutaient entre eux certains points obscurs sur lesquels ils n'étaient pas d'accord. Ils choisirent pour arbitre, la nouvelle arrivée qui donna par écrit sa réponse que tous acceptèrent.
L'emprisonnement du Bab fut l'objet de la première conférence.
On tomba d'accord pour organiser un pèlerinage au mont Makou. Les missionnaires devraient courir le pays, recruter le plus de pèlerins qu'il leur serait possible et se rendre aussitôt leur troupe formée à la prison du prophète. Quoiqu'aucune histoire ne le dise, quoique la tradition orale soit muette sur ce sujet il est certain qu'en fin de compte il s'agissait de l'enlèvement du prisonnier. Je veux bien qu'il fut décidé en principe de ne pas avoir recours à la violence, mais je suis convaincu que cette foule de pèlerins, devait attendre là-bas les événements et, au cas où le Gouvernement aurait décidé la mort du Bab, s'opposer par la. Force l'exécution de la sentence. Peut-être même eurent-ils la pensée qu'au cas où des troupes trop nombreuses viendraient les assaillir, ils pourraient facilement se jeter en Russie.
L'action en faveur du prisonnier ainsi décidée on examina sous toutes ses faces la nouvelle doctrine. Ils furent tous unanimes sur ce point que Seyyèd Ali Mohammed était un nouveau prophète plus grand que ceux qui l'avaient précédé et que de même que Jésus avait abrogé la loi de Moïse, de même que Mohammed avait abrogé celle du Christ, le Bab abrogeait le Qoran, ce qu'on représenta par cette formule «Dieu s'est manifesté et la religion antérieure est abrogée; l'ancienne loi est déracinée, il faut semer la nouvelle parmi les hommes»
Qourrèt oul Aïne déclara alors qu'il était franc et loyal de prévenir les babis ignorants de ce point fondamental (212).
Qouddous fit observer que leurs sectateurs étaient des musulmans sincères, que leur fanatisme naturel avait encore été surexité par leurs prédications, et qu'il était actuellement dangereux de les détromper.
Qourrèt oul Aine répliqua que remettre les explications à plus tard n'était que reculer pour mieux sauter; que le danger d'ailleurs irait grandissant avec l'exaltation des leurs, et qu'il valait mieux avant qu'une goutte de sang fût répandue, s'assurer du dévouement conscient de ceux qui voudraient les suivre.
Y en aurait-il ? Là était le noeud de la question, et tous, contre Qourrèt oul Aine, étaient d'avis qu'aux premiers mots qu'ils entendraient prononcer contre le Qoran, leur adhérents épouvantés du blasphème les couvriraient de malédictions et d'injures, si ce n'est pis. Ils ne pouvaient songer sans frémir à la colère qui succéderait à la stupeur de ces babis sans le savoir. Peut-être comprirent-ils là pour la première fois la responsabilité qu'ils avaient encourue d'attirer des êtres humains dans une aussi terrible aventure sans leur avoir fait connaître ce à quoi ils s'engageaient.
Les choses risquaient fort de mal tourner quand Qourrét oul Aine s'avisa d'un stratagème.
Pour en bien saisir la portée, il faut savoir que la religion chiite condamne à mort sans rémission tout renégat. Aucune excuse n'est acceptée, et le retour à l'Islam du transfuge ne peut arrêter ni suspendre la sentence prononcée contre lui de par les lois elles-mêmes. Mais il n'en va pas ainsi des femmes : animaux reproducteurs, elles sont à peine responsables de leurs actes ; aussi, que l'une d'entre elles vienne à changer de religion elle ne le peut faire que par inconscience : il faut donc la raisonner, l'instruire, lui faire comprendre son crime et la ramener à l'islam : son retour à sa religion primitive lui assure l'oubli et le pardon de sa faute. Que si elle persiste dans sa funeste erreur c'est alors, mais alors seulement qu'elle mérite la mort.
C'est en s'appuyant sur cette disposition ce la loi chiite que Qourret oul Aîne convainquit ses correligionnaires de tenter l'aventure. «Nous convoquerons dit-elle, tous ceux qui sont venus ici avec nous. Quouddous n'assistera pas à la réunion. Quand nos fidèles seront assemblés je leur dévoilerai toute la vérité, je leur ferai connaître la manifestation de Dieu et l'abrogation du Qoran : si ces hommes acceptent nous aurons sans difficulté atteint notre but; si au contraire ils se scandalisent et se révoltent ils viendront certainement aviser celui de leurs chefs qui n'aura pas assisté à la séance. Quouddous alors me reniera, me déclarera infidèle et tentera de me faire de nouveau entrer dans l'islam. Cela durera quelques jours pendant lesquels nous aviserons à calmer l'effervescence et à convaincre nos gens. Si nous n'y arrivons pas; alors j'aurai l'air de céder aux raisonnements de Quouddous et je feindrai de me rallier au Qoran.»
Après avoir mûrement réfléchi sur cette proposition, les chefs comprirent que c'était le meilleur moyen d'arranger les choses, et puisqu'il faudrait un jour aborder l'explication il valait mieux le faire immédiatement et d'une façon qui ne les compromît point.
Toutes les dispositions bien prises et bien arrêtées on convoqua les babis à un sermon, comme il s'en faisait chaque jour dans le camp. Tous sachant que S. A. la Pure devait prendre la parole, chacun se rendit à l'assemblée sauf Quouddous qui sut faire remarquer son absence et l'expliqua par un malaise qui l'obligeait à se coucher.
Qourrèt oul Aïne avait, conformément à l'usage adopté par elle, fait suspendre à deux cordons comme rideau un léger morceau d'étoffe. C'était toujours derrière ce voile qu'elle parlait. Ce jour-là elle se revêtit de ses plus beaux vêtements et de ses plus riches parures, elle ordonna à ses deux servantes de se tenir un peu derrière elle armées de ciseaux. Au signe qu'elle leur ferait elles devaient toutes deux ensemble couper les cordonnets retenant l'étoffe qui tomberait ainsi d'un seul coup. -
Elle commença aussitôt sa conférence : l'aventure qu'elle tentait, l'émotion bien naturelle qu'elle en ressentait, l'espoir de la réussite, la crainte d'un échec l'excitèrent à tel point que jamais elle n'avait été aussi éloquente ni aussi persuasive. Lés auditeurs, charmés par sa voix et par son talent l'écoutaient avec une attention profonde, pas un ne remuait. Au moment où elle prononça ces paroles: «Vous devez aujourd'hui tous savoir que Dieu s'est manifesté et que le Qoran est abrogé : un livre nouveau nous est descendu du ciel, une loi nouvelle nous est donnée,» elle fit le signe convenu : les servantes obéirent, le rideau tomba et splendide elle apparut aux yeux des auditeurs. Elle se tourna une seconde vers ses servantes comme pour leur demander compte de ce qui venait de se passer, mais faisant immédiatement face à la foule : «Qu'importe cet accident dit-elle, cela n'a aucune importance: ne suis-je pas votre soeur et n'êtes-vous point mes frères. Or quelle soeur a jamais caché son visage à son frère.»
Mais l'effet produit avait été foudroyant. Les uns se cachèrent la face avec leurs mains, d'autres se prosternèrent, d'autres s'enveloppèrent la tête de leur vêtement pour ne point voir le visage de Son Altesse la Pure. Si regarder le visage d'une femme inconnue et qui passe est un grave péché, quel crime n'était-ce pas que de porter les yeux sur la sainte qu'elle était.
Elle chercha à les convaincre, se mit à marcher au milieu d'eux en les appelant ses frères, en leur disant que le Qoran étant abrogé la loi qui ordonnait aux femmes de se voiler n'existait plus, elle ne put y arriver. Quelques-uns, bien rares la regardaient. Mirza Housseïn Ali Beha comprenant que la scène avait assez duré et qu'elle risquait de tourner au tragique, jeta son vêtement de dessus qu'on appelle Aba sur la tête de Qourrèt oui Aine et la conduisit dans sa tente.
La séance fut levée au milieu d'un tumulte indescriptible. Les injures pleuvaient à l'adresse de la femme assez indécente pour se montrer ainsi à visage découvert, les uns affirmèrent qu'elle était devenue subitement folle, les autres que c'était une dévergondée, quelques-uns bien rares prirent sa défense. La discussion s'éleva violente, et, pour en finir on décida d'aller prévenir Quouddous du scandale survenu : seuls ceux qui avaient pris sa défense allèrent se ranger autour de la tente de S.A Tahéré.
Qouddous reçut les mécontents et se fit expliquer l’affaire dans les moindres détails. Il put se convaincre ainsi de l’horreur qu’inspirait à ces musulmans fanatisés l’acte de Qourrèt oul Aïne. Ne voulant pas rompre en visière au sentiment qui éclatait avec tant de force mais songeant à réserver l’avenir il déclara : «Le fait en lui-même est incompréhensible et me confond. Si en agissant et en parlant comme elle l’a fait S.A. Tahéré a réellement exprimé sa conviction, elle est infidèle et vous devez désormais la considérer comme telle. Mais peut-être y a-t-il dans tout cela une signification cachée.»
Ainsi que l’espérait l’orateur, ces derniers mots préoccupèrent vivement l’imagination de ceux qui les avaient entendus. On chercha avec passion le but intime, la signification mystérieuse, et, dès lors, un terrain de discussion était trouvé.
Chaque jour Quouddous enfonçait plus profondément dans l'esprit de ses adhérents le doute qu'il avait si habilement semé. «Certainement, disait-il, le voile est plus d'usage que de rite ; les femmes du Prophète ne se voilèrent qu'à partir du moment où un Arabe eut l'impudence de vouloir acheter Aicha à Mohammed et l'on peut penser que les ordres du Qoran ne concernent que les épouses sacrées. Mais c'est là un usage vénérable par son antiquité et qui, de plus, protège la pudeur de nos femmes et la sainteté de la famille. Certes, si l'usage contraire s'établissait, les hommes s'y habitueraient bien vite et, dès lors, respecteraient celles avec qui il leur est défendu d'avoir commerce. Ceci modifierait même d'une façon profitable les moeurs débauchées de nos grandes villes ; mais comment oser dire que le Qoran est abrogé, comment vouloir y substituer une loi nouvelle ? Le Mehdi doit nous expliquer tout ce que le livre Divin a d'obscur, mais il le doit amplifier, non le détruire. Quourret oui Aine est une impie.»
Les ayant ainsi habitués à l'acte si inattendu de Qourret oul Aïne, il insista habilement sur les obscurités et les inconséquences du Qoran, tout en renouvelant chaque jour son excommunion ; il pensa les avoir ainsi suffisamment préparés et avisa son associée de tenter une dernière épreuve.
Celle-ci n'était pas restée inactive. Quand elle eut été avisée de l'excommunion prononcée contre elle,
elle assembla ceux qui lui étaient restés fidèles et dont le nombre s'était accru dès les premiers jours. Elle leur expliqua la nouvelle doctrine, leur démontra la Divinité du Bab et excommunia à son tour Quouddous et ses adhérents. Son talent incontestable imposait la conviction de ceux que la beauté merveilleuse de son visage ne prédisposait que trop bien en sa faveur. Quand Quouddous lui eut fait connaître que l'heure était venue de tenter un dernier assaut, elle demanda deux hommes prêts à mourir. Deux jeunes gens se présentèrent à qui elle donna ses instructions.
Ils se rendirent au camp ennemi et y arrivèrent au moment où Quouddous prononçait son allocution quotidienne. Ils l'interrompirent et dirent à haute voix : «S. A. la Pure vous reproche de dire du mal d'elle sans oser l'attaquer en face : elle vous engage donc à venir dans notre camp et à discuter avec elle suivant la raison et les arguments vrais, et cela publiquement. Que si vous l'emportez sur elle, elle vous donnera raison et vous obéira ; si, au contraire, c'est elle qui l'emporte sur vous, ce sera à vous à vous incliner et à vous soumettre.»
«Non, dit Quouddous, cette femme a apostasié sa religion :je ne veux ni la voir, ni discuter avec elle.»
«Certes, répliquèrent-Ils, nous n'irons pas lui rapporter une réponse aussi offensante pour elle. Au surplus, voici les trois alternatives que nous a laissées la très pure : ou nous devons t'amener à elle de bon gré, ou, si tu refuses, lui apporter ta tête, ou si nous n'y réussissons pas nous faire tuer en tâchant d'y réussir. Voici les ordres que nous avons reçus et nous sommes ici pour les exécuter ; or donc, choisis : viens, laisse toi tuer ou tue-nous.»
Quouddous se tourna vers ses compagnons et leur dit: «C'est à vous qu'appartient la réponse : si vous me dites tue, je tuerai, si vous me dites meurs; je mourrai, si vous me dites va j'irai».
On discuta assez vivement, mais la sentence ne se fit pas attendre ; elle fut ainsi formulée: «Aller trouver Quourret oul Aïne et discuter avec elle, vaut mieux que de tuer ou d'être tué.»
Quouddous se leva donc, et, suivi de tous ses gens, se rendit au camp de Tahéré. Quand tout le monde eut pris sa place, notre héroïne vint s'asseoir en face de son adversaire et la discussion commença aussitôt. Par d'habiles citations du Qoran et des Hadis, elle démontra victorieusement quelle était la tâche de l'Imam caché, que c'était à lui qu'incombait la charge de dire toute la vérité divine et d'ordonner au nom de Dieu et que devant la grandeur de ce rôle ceux joués par les précédents prophètes y compris Mohammed s'effaçaient complètement.
Vaincu, Quouddous se leva et proclama à haute voix: «Ce qu'elle dit est la Vérité, et ce qu'elle a fait est bien fait.» Il se tourna alors vers elle et lui demanda pardon de ses erreurs et de ses blasphèmes. Tous ses gens l'imitèrent et la nouvelle religion fut ainsi fondée au milieu de l'enthousiasme et de l'allégresse universels.
Après quelques jours donnés à la joie et aux congratulations mutuelles, les chefs se séparèrent pour aller à la recherche de pèlerins. Mollah Housseïn Bouchrouyéhi rebroussa chemin vers l'intérieur du Khorassan, Quouddous se dirigea sur le Mazanderan, et Quourret oul Aïne, après avoir reconduit pendant quelques journées de marche l'apôtre du Mazanderan, se sépara de lui et semble s'être directement dirigée sur Qasvine en passant toutefois par Nour. Nous la retrouverons vers 1266.
=====================================
V. INSURRECTION DU MAZANDERAN
Dès la clôture du Concile de Bédecht Hadji Mollah Mohammed Ali Barfourouchi (213) se dirigea avec Qourret oul Aïne vers le Mazanderan, tandis que Mollah Houssein Bouchrouyéhi Bab el Bab rentrait au Khorassan : il s'agissait de réunir le plus de pèlerins possible afin d'être en forces imposantes autour de la prison du Bab.
Ce fut dans un des villages du Hézar Djérib que l'héroïne babie quitta ses compagnons pour aller chercher des pèlerins dans les autres provinces pendant que Mollah Mohammed Ali retournait à Barfourouch où il recommença ses prédications.
Le Bab oul Bab s'occupait donc de la tâche qui lui était confiée, quand il reçut de Quouddous une lettre restée célèbre sous le nom de Loh-i-Chéhadét Azèliyèh. Dans cette lettre le Barfourouchi, tout en lui prédisant, dit la tradition, les événements qui allaient se dérouler, lui recommandait de venir le rejoindre avec ses gens le plus rapidement possible.
Le Bouchrouyéhi, après avoir pris connaissance de ce document, se prépara à exécuter l'ordre qu'il avait reçu : il se mit donc en route et arriva d'abord à Méïaméï où il s'adjoignit trente babis dont le chef, Mirza Zeïn el Abèdine, élève du défunt Cheikh Ahmed Ahçahi, était un vieillard pieux et respecté. Son zèle était si ardent qu'il emmena avec lui son gendre, jeune homme de dix-huit ans qui s'était, il y avait à peine quelques jours, marié avec sa fille. «Viens, lui dit-il, viens avec moi faire le dernier voyage. Viens, car je veux être pour toi un véritable père et te faire participer aux joies du salut.» Ils partirent donc, et c'est à pied que le vieillard voulut faire les étapes qui devaient le conduire au martyr.
Mirza Djani veut que ce soit à Arim, village du district de Sevad Kouh, que Mollah Houssein ait appris la mort de Mohammed Chah. Quoi qu'il en soit notre héros se rendit à Sevad Kouh même, distant d'une journée de marche de ce dernier village, et là, réunissant ses hommes autour de lui, il monta sur la chaire, comme il le faisait d'ailleurs deux fois chaque jour, et, les apostrophant, il leur parla longuement du néant des choses de ce monde et de la gloire du ciel. «Sachez, ô mes frères, que la pure intelligence interdit de réunir deux choses contraires. Or, posséder les biens périssables et suivre exactement les lois de la religion sont deux faits qu'il est impossible de concilier. Gagner de l'or est un obstacle à gagner le salut. Depuis le commencement du monde ceux qui, soutenus par la grâce de Dieu et leurs forces naturelles sont arrivés à la connaissance, au bénéfice de la certitude, à la perfection dans leur obéissance et dans leur foi ont, au premier pas sur cette route, détourné les yeux des biens et des richesses, de leurs femmes et de leurs enfants, de la considération du monde et des honneurs : ils ont fait le sacrifice de leur propre vie et, s'ils n'en eussent agi ainsi, ils n'eussent pu faire un second pas sur cette route glorieuse. Ainsi, dans chaque siècle, les prophètes, les saints, les hommes purs n'ont jamais pu montrer la vraie route à leurs concitoyens, les délivrer des mauvais chemins et des pensées mauvaises, les faire arriver à la ville capitale de la certitude et de la Foi, tant qu'ils n'ont pas traversé eux-mêmes le pont plus mince qu'un fil, plus tranchant qu'un rasoir des honneurs et des biens du caravansérail en ruines qu'est ce bas monde, tant qu'ils n'ont pas pris la ferme et stoïque résolution de supporter les tourments les plus pénibles, de souffrir les peines les plus cruelles, tant qu'ils n'ont pas enfin décidé au fond de leur coeur de se vouer au martyr. C'est ce qu'a fait le Seigneur des Seigneurs, Hosseïn, que le salut soit sur lui ! C'est pour nous montrer la route, c'est pour prouver la vérité de son oeuvre qu'il épuisa avec ses compagnons jusqu'à la dernière goutte la boisson délicieuse du martyr. Quelques années après ce merveilleux dévouement, la Vérité du Chériat éclata inattaquable, car il l'avait scellée de son sang ! Eh bien, c'est à notre tour aujourd'hui ! A nous de réveiller les fils de Noé endormis, ceux qui sont parfaits comme ceux qui ne le sont pas, ceux en qui brille l'intelligence comme ceux qui en sont dépourvus, ceux qui sont ornés de la science comme ceux qui sont plongés dans l'ignorance ! A nous à détruire les erreurs, le doute, les négations de ceux qui se détournent du chemin ! A nous enfin à faire disparaître l'indifférence du siècle présent et des siècles à venir ! C'est Dieu qui le veut, c'est Votre Altesse bien aimée qui l'ordonne ! Ils nous disent de fermer les yeux aux vanités du monde pour prouver la vérité de cette manifestation, pour démontrer la sincérité de notre Foi. C'est par là que nous assurerons à la doctrine de Dieu un triomphe éclatant ; c'est en supportant des souffrances telles qu'un homme ne les peut imaginer non plus qu'il ne pourrait les souffrir, c'est en jetant nos vies à tous les vents que nous démontrerons les mensonges de nos ennemis. C'est par ces signes visibles et certains qu'éclatera à tous les yeux l'excellence et la vérité de notre religion. Venez, venez tous parfaire la preuve pour nos ennemis, pour ceux dont les yeux sont aveugles.»
«Mais sachez, sachez bien, sachez tous qu'une fois entrés au Mazanderan, nous n'aurons plus aucun moyen de fuir, aucune route pour nous soustraire à la mort. Et cette mort sera accompagnée de tortures raffinées qu'on nous infligera sans nous interroger, sans nous rien demander. Il faut que la terre du Mazanderan soit teinte de notre sang et sachez que nous ne venons pas chercher ici autre chose que la mort.»
«Quiconque se sent l'âme assez forte, le coeur assez ferme pour supporter en souriant ce terrible fardeau, pour l'accepter avec joie, que celui-là demeure ; mais que celui qui se sent la moindre hésitation, qui peut craindre de faiblir à un instant quelconque se retire et s'en aille. Il n'est ni juste ni digne que nous tracions à qui que ce soit un devoir qu'il n'aurait pas la force de remplir. Que ceux qui sont dans ce dernier cas nous fassent leurs adieux.»
Ils étaient deux cent trente qui écoutaient ce discours fréquemment interrompu par leurs larmes et leurs cris ! Deux cents protestèrent de leur fidélité inébranlable, de leur amour pour le Bab, de leur soif de mourir pour lui. Trente seulement, tout aussi émus que leurs camarades, mais se sentant l'âme faible et le coeur hésitant se retirèrent après avoir fait leurs adieux à ceux qui allaient mourir (214).
A la tête de ces deux cents hommes déterminés, Bab el Bab monta à cheval et se dirigea sur Barfourouch.
Les prédications de Quouddous y avaient fait déjà de nombreuses conversions. Le clergé officiel et son chef Saïd el Ouléma étaient outrés de rage et de fureur sans que, cependant, aucun incident grave se fût produit. La ville était frémissante, la surexcitation augmentait de jour en jour : il ne fallait qu'une étincelle pour provoquer l'explosion. Ce fut Sâïd el Oulema qui, en apprenant la prochaine arrivée de Bouchrouyéhi et craignant pour la sûreté de la ville, mit lui-même le feu aux poudres. Il arma, en effet un certain nombre de musulmans et les envoya hors des murs pour s'opposer par la force à l'entrée des sectaires.
Mollah Housseïn précédant ses compagnons rencontra le premier les soldats de Said : comme ceux-ci l'empêchaient de passer, il leur déclara que lui et ses compagnons venaient dans leur ville en qualité d'hôtes et de suppliants. Il invoqua la mort du Chah, l'insécurité des routes, mais ils restèrent inflexibles. «Chérissez vos hôtes même s'ils sont infidèles, a dit Mohammed, s'écria le Mollah. C'est au nom de cet ordre sacré que nous vous demandons pour quelques jours l'hospitalité dans votre ville. Pourquoi nous refuser? Aucune religion n'ordonne de repousser les hôtes et les voyageurs, et il est indigne de tourmenter ceux qui demandent asile.»
Il eut beau prier, beau flatter ces musulmans, ils ne voulurent rien entendre ; au contraire, leur audace et leur insolence croissaient avec la douceur et l'humilité de leur interlocuteur. Ils pensaient avoir facilement raison de gens à l'aspect aussi peu guerrier et ils supputaient que si tuer les infidèles était agréable à Dieu, les piller après le massacre ne leur serait pas désagréable à eux-mêmes. Il y avait la double profit : on s'assurait le Paradis, ce qui est déjà quelque chose, mais on s'enrichissait du coup, ce qui était infiniment précieux.
Ces réflexions firent que quand Mollah Houssein Boucbrouyéhi, las de l'inutilité de ses prières, retourna sur ses pas, les musulmans se jetèrent sur ses traces. S'enhardissant peu à peu, l'un d'entre eux, un boulanger, déchargea son fusil sur le groupe des babis. La balle atteignit en pleine poitrine et étendit raide mort le nommé Seyyèd Riza. C'était un homme de moeurs pures et simples, d'une conviction ardente et sincère. Par respect pour son chef, il était toujours à pied à côté de son cheval, prêt à le servir à la moindre occasion.
L'exemple du boulanger fut suivi par ses compagnons et une décharge générale vint abattre encore deux compagnons du Bab el Bab. Celui-ci se retourna furieux, et invoquant l'ordre du Qoran qui dit qu'on doit repousser la force par la force, il chargea les assaillants. Ceux-ci plièrent sous le nombre et les babis entrèrent dans la ville.
La bataille continuait à l'avantage des babis : un musulman tira un coup de fusil sur le Bouchrouyéhi et le manqua ; celui-ci le tenait déjà sous son sabre, quand l'autre implora son pardon. Bouchrouyéhi, ému de ses larmes, lui laissa la vie sauve. Comme il s'éloignait, le musulman, peu touché de cette magnanimité et ayant eu le temps de recharger son arme, tira encore sur le chef Babi, que les chevrotines atteignirent légèrement. Bab el Bab, outré de cette traîtrise, le chargea, et le musulman se réfugia derrière un arbre, se servant de son fusil pour parer les coups de son adversaire. 'Mais la douleur et la colère décuplèrent les forces de ce dernier qui, d'un seul coup de son arme, coupa en deux le fusil l'homme et l'arbre (215).
Les babis, tout en combattant, avaient pénétré jusqu'à la maison de Saïd el Oulema : ils eussent pu y entrer et le tuer, mais, dit Mirza Djani, pour que les prophéties s'accomplissent et pour laisser la page de l'histoire qui lui était réservée se noircir tant du récit de ses forfaits que de celui de ses souffrances, exemple terrible pour ceux qui comprennent, ils retournèrent sur leurs pas.» La vérité est que probablement la ville s'armait de toutes parts et Molla Housseïn vit bientôt que les forces étaient disproportionnée.
Quoi qu'il en soit, ils se rendirent au Sebz Meîdan, c'est-à-dire au marché aux herbes, où ils s'enfermèrent dans le caravansérail qui s'y trouvait. Mais bientôt les musulmans vinrent les y assiéger : ils tentèrent de forcer le passage en mettant le feu à la porte, mais les babis firent une sortie et les dispersèrent.
Quelque temps après, les ennemis revinrent plus nombreux. L'attaque eut lieu au moment de la prière : le Bab el Bab voulant, dit notre auteur, en même temps qu'accomplir un devoir religieux donner un exemple de la fermeté des convictions des sectaires, de leur mépris de la vie, et démontrer au monde l'impiété et l'irréligion de ceux qui se disent musulmans, donna l'ordre à l'un des siens de monter sur une terrasse et d'y chanter l'azzan. Celui-ci obéit et il avait à peine prononcé à haute voix les premières paroles qu'une balle l'étendit mort. Sur l'ordre du chef, un autre monta qui reprit l'azzan au point où l'autre l'avait laissé; mais il ne put achever. Une balle l'atteignit à son tour qui le tua. Un troisième eut le même sort, mais il eut le temps de terminer l'appel à la prière. L'attaque fut encore repoussée.
Saïd el Ouléma voulant en finir à tout prix, réunit autant de monde qu'il put et mit de nouveau le siège devant le caravansérail : la bataille durait depuis cinq ou six jours, quand parut Abbas Kouli Khan Serdar Laridjani.
Entre temps, en effet, et dès le début de l'action, les oulémas de Barfourouch, exaspérés des nombreuses conversions que Quouddous avait su faire en ville - 300 en une semaine, constatent avec quelque mauvaise humeur les historiens musulmans - en avaient référé au Gouverneur de la Province, le Prince Khanlar Mirza ; celui ci ne fit aucune attention à leurs doléances, ayant en tête bien d'autres préoccupations. La mort de Mohammed Chah l'inquiétait beaucoup plus pour lui-même que les criailleries des Mollas et il se préparait à aller à Téhéran saluer le nouveau souverain dont il espérait se concilier les bonnes grâces.
N'ayant pas réussi de ce côté et les événements se précipitant, les oulémas écrivirent une lettre fort pressante au chef militaire de la province, Abbas Kouli Khan Laridjani. Ce dernier, jugeant inutile de se déranger lui-même, envoya Mohammed Bek, yaver (capitaine) à la tête de trois cents hommes pour remettre les choses en ordre. C'est alors que les musulmans vinrent assiéger le caravansérail. La lutte s'organisa, mais, si dix babis furent tués, un nombre infiniment plus grand d'assaillants mordit la poussière. Les choses traînant en longueur, Abbas Kouli Khan crut devoir venir lui-même pour se rendre compte de visu de la situation.
Les auteurs musulmans veulent qu'il ait commandé une nouvelle attaque et que, pour l'éviter, Molla Housseïn Bouchrouyéhi lui ait envoyé des émissaires chargés de négocier. Hadji Mirza Djani, Mirza Fazl Oullah et la tradition prétendent que c'est au contraire le Serdar Laridjani qui entama les pourparlers. La chose est plus que probable, car le Serdar ne dut pas comprendre grand chose aux explications des Mollas. Il lui fut probablement difficile de se rendre compte de l'impiété de ses adversaires car il en avait vu bien d'autres, et il dut très certainement songer que tout serait pour le mieux si les babis allaient se faire pendre ailleurs.
Quoi qu'il en soit, des négociations eurent lieu : Abbas Kouli Khan envoya au chef babi son propre gendre, Seadet Kouli Bek, chargé de lui dire : «Les gens de Barfourouch ont certainement mal agi à votre égard, car vous étiez des étrangers et vous êtes venus chez eux en qualité d'hôtes ; mais la mort de Sa Majesté le Chah les a troublés, et, dans de telles occurrences, l'on a facilement peur. Or, maintenant, le sang a coulé entre vous, et la paix est devenue impossible : il serait désirable que vous quittiez le pays.» Bab el Bal répondit qu'il était tout prêt à partir à condition qu'on lui laissât le passage libre et qu'on ne l'attaquât pas en route. «Nous exigeons du Serdar, dit-il, qu'il nous donne sa parole d'honneur qu'on ne nous inquiétera pas sur notre chemin.» Abbas Kouli Khan s'engagea et fit plus encore. Il chargea le négociateur même, Seadet Kouli Bek, d'escorter les babis jusqu'à ce qu'ils arrivassent en lieu sûr.
Un certain Khosrau Bek, de Qadi Qélah, songea immédiatement à profiter des circonstances. Il suivit les babis jusqu'à Ali Abad, point où Seadet Kouli Bek les quitta pour revenir à Barfourouch. Là, considérant la proie comme sûre, il prévint les gens du village ; tous se mirent en route et se lancèrent à la poursuite des babis. Ils les rejoignirent en pleine forêt et massacrèrent les traînards dont ils volèrent les dépouilles. Molla Housseïn, peu soucieux d'engager les hostilités dans un endroit qu'il ne connaissait pas, et d'ailleurs si propice aux coups de main, fit arrêter son monde. Il était arrivé aux environs de Cheikh Tebercy. C'était d'ailleurs le moment de la prière, et Bab el Bab descendit de cheval pour procéder à cette cérémonie. Il fut rejoint par Khosrau Bek qui, hypocritement, vint demander son salaire pour l'avoir escorté jusque-là. Bouchrouyéhi lui fit donner cent tomans en argent. Ce cadeau excita la cupidité du musulman qui exigea insolemment que le chef babi lui fit don de son cheval. Comme celui-ci s'y refusait, Khosrau Bek, croyant l'intimider, se mit à vociférer des injures contre la nouvelle religion et le Bab. Exaspéré de tant d'audace, le Molla lui déchargea sur la tête un tel coup de sabre qu'il le fendit jusqu'à la ceinture. Mirza Djani raconte que sur le refus de Bouchrouyéhi de donner son cheval parce qu'il le tenait d'un grand personnage, Khosrau s'écria: «Si vous ne me le donnez pas, je le prendrai, car j'ai ordre de vous tuer. Vous êtes des impies et, comme tels, tout ce que vous possédez nous appartient.» Puis il insulta la personne même du Bab. Mirza Mohammed Taghi Djovéïni lui prit la main, le fit reculer de quelques pas, et lui offrit encore de l'argent pour qu'il cessât d'importuner son chef. Mais ni prières> ni menaces, ni argent, ne purent fléchir Khosrau ; il persista insolemment dans sa demande et dans ses blasphèmes. Djovéïni sentit sa patience se lasser et, sur une dernière insulte du musulman, il lui plongea son kandjiar dans la poitrine.
Les Ali Abadis, voyant tomber leur chef, prirent la fuite sans être inquiétés ; mais leurs villages étant à proximité, ils reprirent bien vite courage et revinrent en plus grand nombre reprendre l'offensive. Le Bab el Bab craignant toujours une surprise et se sentant sur un terrain défavorable, ordonna à ses compagnons de jeter les charges qu'ils portaient et de continuer rapidement leur route. Ceux-ci obéirent et, pendant que les musulmans se livraient au pillage, la petite troupe arriva saine et sauve au tombeau du Cheikh 'I'ébercy.
Là, on fit halte, on se remit un peu de ces émotions et l'on décida que, l'endroit paraissant convenable, on y resterait pour attendre les événements. Aussi le Molla envoya-t-il des cavaliers à la recherche de ce qui pouvait rester des charges que l'on avait jetées. Ils revinrent bientôt, en ayant trouvé un assez grand nombre que le Bab el Bab fit réunir en tas ; puis, se tournant vers ses compagnons: «Pour ces quelques jours que nous avons encore à vivre, évitons que des richesses périssables nous divisent et nous séparent. Que tout ceci nous soit commun et que chacun en profite.» Les babis y consentirent avec joie, et c'est ce sacrifice merveilleux, cette abnégation parfaite qui les ont fait et les font encore accuser de vouloir la communauté des biens et des femmes !
On choisit un intendant chargé de donner à chacun ce dont il avait besoin, et un cuisinier pour nourrir toute la troupe. Les repas étaient servis en commun, et l'on donnait un plat pour deux personnes. Ils restèrent ainsi vingt jours et vingt nuits, attendant les événements ; mais la pluie était si abondante que les gens des environs ne pouvaient sortir de chez eux. Quand le temps se fut rasséréné, les Qedi Qélahis en profitèrent pour venir attaquer les babis mais ils furent repoussés avec de telles pertes que l'envie leur passa de renouveler l'expérience.
Quelques instants après la bataille, les sectaires virent arriver Quouddous qui venait les rejoindre avec quelques hommes. Ce personnage était en effet resté en apparence inactif durant les événements de Barfourouch. En réalité, il s'occupait de recevoir les nouvelles des provinces ou d'y expédier les ordres relatifs au pèlerinage à Makou. La grandeur et l'importance de ce devoir lui interdisaient de se compromettre irrémédiablement dans les premières batailles du début. Quand il crut avoir tout réglé, il se hâta de rejoindre Molla Housséïn Bouchrouyéhi. Celui-ci, prévenu de son arrivée, alla au-devant de lui avec tout son monde. Dès qu'ils l'aperçurent, tous se prosternèrent dans la poussière.
Hadji Mirza Djani déclare que dès son arrivée, Quouddous s'occupa de tracer les limites de la forteresse. Chacun se mit au travail, et l'on tira profit de l'adresse ou de l'industrie de chacun. Pendant que les maçons bâtissaient les murs, les armuriers fabriquaient des sabres, aidés de leurs coreligionnaires. Les vieillards en qui résidait la science, prêchaient, éclaircissant des points de doctrine afin d'instruire les ignorants : c'était éviter d'entraîner de pauvres diables à la mort sans qu'ils sussent pourquoi, c'était faire de chacun d'eux des martyrs volontaires et sublimés. Profitant de l'absence des fonctionnaires supérieurs de la province qui, tous s'étaient rendus à Téhéran - où ils arrivèrent le 1er Moharrem - pour y porter au nouveau souverain leurs félicitations, les babis mirent leur demeure en état d'opposer, le cas échéant, une forte défense.
Ils établirent avant tout un mur d'enceinte octogone, dont les tours s'élevèrent jusqu'à dix mètres de hauteur ; ces tours furent elles- mêmes surmontées de constructions faites avec des troncs d'arbres, en ménageant de nombreuses meurtrières. Il fut, à une certaine distance, entouré d'un profond fossé dont on rejeta la terre, de façon à établir un remblai qui montait depuis le pied du mur jusqu'à sa crête, soutenant ainsi toute la construction. On ménagea trois étages de chemins de ronde et l'on ouvrit plusieurs portes. On creusa également des abris dans la forteresse, dont on rejeta les terres au pied intérieur du mur d'enceinte.
Dans ces remblais, et de distance en distance, ainsi que dans le fossé, on creusa des puits profonds dont l'entrée fut soigneusement dissimulée au moyen de branchages recouverts de terre et dont le fond fut garni de baïonnettes plantées la pointe en l'air. Ceci fait, on préleva sur tous les villages voisins des approvisionnements considérables pour les gens et pour les bêtes.
Tout bien mis au point, Molla Housséïn Bouchrouyéhi recommença ouvertement ses prédications, et annonça, dit l'auteur musulman, que l'année suivante Mirza Ali Mohammed conquerrait le globe tout entier, l'organiserait, y ferait connaître la loi de Dieu et réunirait en une seule toutes les religions. Il attira ainsi et convertit bon nombre de musulmans (216). Quouddous le soutenait dans son oeuvre, et régnait en souverain pontife sur la petite troupe babie. Il sortait fort peu, n'accordait que de rares audiences : encore recevait-il les visiteurs caché derrière un rideau. «J'ai entendu dire, raconte l'auteur du Nassikh out Tévarikh, que ce personnage se rendit un jour aux bains et monta à cheval pour faire la route jusqu'au village voisin de la forteresse. Comme il parut le visage découvert, les babis qui se tenaient pressés sur son passage, malgré une boue épouvantable, se prosternèrent la face contre terre et ne se relevèrent qu'après en avoir obtenu de lui la permission.»
Ce fut à ce moment, toujours d'après le Nassikh out Tévarikh, et au grand scandale de l'auteur, que Molla Housseïn distribua à ses compagnons les noms des prophètes et des imams. Nous avons vu, ou
du moins nous verrons ce qu'il en faut penser comme aussi des promesses qu'il faisait de la résurrection au bout de quarante jours de ceux qui seraient tués pour la cause sainte. «Hâtons-nous, leur disait-il, de faire la conquête du Mazanderan car nous devons aller tuer 12.000 Turks sur la montagne de Chah Abdoul Azim.» Il interprétait là le hadis : «Vous descendrez de l'Ile Verte et vous exterminerez douze mille Turcs sur le mont Zouhéha.» Il assimilait le Mazanderan à l’Ile Verte à cause de sa végétation et le Mont Zouhéba à la colline de Chah Abdoul Azim. Enfin, il fanatisa si bien ses hommes qu'ils ne craignirent plus le danger, considérèrent la mort comme la préface de la vie et ne demandèrent plus qu'à attaquer les Musulmans.
Le bruit fait par cette réunion de rebelles parvint jusqu'aux oreilles de S. M. Pour y mettre un terme, le Chah donna l'ordre aux grands du Mazanderan, qui se trouvaient encore à Téhéran, de réunir leurs régiments et de les envoyer anéantir les babis (217).
Hadji Moustapha Khan transmit ces ordres par écrit à son frère Agha Abdoullah, et Abbas Qouli Khan Laridjani prévint également Mohammed Soultan, yaver. Ali Khan Sevad Kouhi envoya des émissaires à Sevad Kouh et à Hézar Djerib pour réunir ses hommes et aller attaquer la forteresse. Les fonctionnaires du Gouvernement écrivirent à Saïd el Ouléma et à Mirza Agha Moustofi du Mazanderan de faire hâter les préparatifs et de réchauffer le zèle des défenseurs de l'islam.
Ces ordres à peine parvenus à destination, chacun se hâta pour distancer les autres et recueillir à lui seul les fruits d'une victoire qu'il croyait facile.
Hadji Abdoullah, frère de Hadji Moustapha Khan Hézar Djeribi, fut le premier prêt. Il choisit 200 cavaliers d’élite qu'il arma et partit, accompagné de ses parents. Il arriva à Sari où il rencontra Mirza Abha, l'afghan, qui disposait d'une troupe de cavaliers Kurdes. Ils s'entendirent ensemble et se rendirent à Ali Abad où ils s'adjoignirent une troupe de Qédi Qélahis. Hadji Abdoullah traversa le fleuve Talar avec son monde et vint camper dans la ville de Lar où il descendit de sa personne dans la maison de Nazer Khan Qérayéli. Le lendemain, il parvint en vue de la forteresse.
Il construisit, sur le terrain où il se trouvait, des retranchements et des approches, en même temps que des huttes de branchages pour abriter ses hommes.
Ceci fait, il posta en sentinelles les renommés tireurs que sont les gens de Goudar et il alla lui même s'établir au village d'Afra, d'où il comptait revenir chaque jour pour surveiller les travaux du camp retranché.
Mais le lendemain, dès l'aube, Molla Housseïn sortit de la forteresse et se précipita sur les fusiliers de Goudar qu'il massacra en un instant. Le bruit des coups de fusil vint réveiller Hadji Abdoullah qui réunit son monde et se lança à la rencontre des babis. Les Kurdes qui l'accompagnaient déchargèrent leurs fusils et jetèrent bas plusieurs de leurs ennemis. Mais Molla Housseïn ne leur laissa pas le temps de respirer et les attaqua furieusement. Un jeune Afghan se jeta sur son chemin et voulut l'empêcher de passer ; la lutte fut ardente et vive, mais, soudain, le cheval de l'Afghan manqua des deux pieds de devant et précipita son cavalier sur le sol : Molla Housseïn le coupa en deux d'un coup de sabre (218).
Pendant ce temps, les siens avaient fait un carnage terrible des gens de Hadji Abdoullah ; cent trente d'entre eux restèrent sur le carreau, le reste s'enfuit. Leur chef, démonté, chercha son salut dans la fuite ; mais, ayant une jambe malade, il ne pouvait courir et Molla Mousseïn l'ayant aperçu se lança contre lui, l'atteignit et le tua.
Les babis poussèrent leurs ennemis l'épée dans les reins jusqu'à Ferrah, où ils les tuèrent jusqu'au dernier. Les habitants du village furent massacrés à leur tour, leurs maisons pillées et les vainqueurs, comme adieu et comme exemple, mirent le feu aux quatre coins du village.
Le bruit de cette victoire et de cette terrible exécution se répandit dans le Mazanderan avec la rapidité de la foudre : la province entière trembla de terreur et les soldats eux-mêmes sentirent leurs coeurs se serrer à la pensée d'avoir à se défendre contre de tels adversaires, car il n'était plus question de les attaquer. Mohammed Soultan, le yaver Laridjani, ; ne penssa plus qu'à fortifier Barfourouch dans la prévision d'une attaque des babis ; dans la même pensée, Mirza Agha le Moustofi en fit autant à, Sari.
L'écho de ces nouvelles arriva à Téhéran : le Chah fut outré de fureur et ordonna au prince Mehdi Qouli Mirza de partir sans désemparer pour le Mazanderan et de n'y pas laisser vivant un seul babi. Moustapha Khan, frère de Hadji Abdoullah (219), fut chargé de la garde du Poucht Kouh de Hézàr Djerib, et, pour exciter l'ardeur des défenseurs de l'islam, Sa Majesté ordonna de dresser une liste des victimes des derniers événements afin de donner une pension à leurs veuves.
Le Prince sortit de Téhéran le 1er Moharrem, c'est-à-dire juste un an après y être entré, accompagné de tous les hauts fonctionnaires du Mazanderan. Il prit la route de Sevad Kouh, détachant Abbas Kouli Khan Laridjani qui fut chargé d'aller à Amol par la route de Demavend et de Laridjan, pour y réunir l'armée dont le prince viendrait prendre le commandement.
Arrivé au Zir Ab de Sevad Kouh, Mehdi Kouli Mirza y réunit une troupe de cavaliers de Hézar Djerib, de Kurdes et de Turks et les emmena avec lui au village de Vaskés de Ali Abad où il descendit dans la maison de Mirza Saïd. Il y séjourna quelques jours pour tout organiser et exercer ses soldats.
Mais ce qu'il entendait de toutes parts ne laissait pas de l'inquiéter un peu. La terreur peinte encore sur tous les visages, les histoires effroyables qui circulaient sur la férocité de ses ennemis sans l'effrayer précisément le laissaient cependant rêveur. Il songea, qu'il vaudrait mieux, par de bons procédés, amener les babis à composition quitte à s'en débarrasser ensuite : ce serait la une victoire remportée sans effusion de sang, et tromper des infidèles est non seulement licite mais encore obligatoire pour les chiites.
En conséquence, il écrivit à Quouddous une lettre dans laquelle il demandait au chef babi quel était son but ? ce qu'il voulait ? «Est-ce une guerre religieuse que vous faites ? ou bien vous révoltez-vous contre le Gouvernement ?Où cela peut-il vous mener ? Croyez moi, abandonnez toutes ces idées vaines et rentrez tranquillement chez vous.»
La réponse de Quouddous ne se fit pas attendre : elle était fort nette et ne laissait prise à aucun espoir de conciliation. Mirza Djani la donne tout entière dans son histoire : je ne la rapporterai pas ici, parce que, à cause de sa longueur même, elle me parait apocryphe ; l'historien babi a délayé certainement dans d'infinies proportions les raisons que dut donner Quouddous. Un seul point de cette réponse est à retenir : le chef Babi se plaint que lui et ses compagnons aient été déclarés infidèles sans qu'on eût fait une enquête sur leur religion, sans qu'on eût même daigné discuter avec eux. Ceci semble infirmer les récits de discussions publiques dont sont pleins les historiens musulmans et que les histoires babises nient absolument.
Mirza Djani veut que cette lettre pleine d'enthousiasme ait fait réfléchir le Prince : voyant devant lui des hommes résolus à mourir, il crut pouvoir feindre de saisir le joint qu'on semblait lui offrir, et endormir ainsi la vigilance des babis. «Ce que vous m'écrivez, répondit-il, est conforme aux lois et parfaitement juste. Aussi, vais-je faire connaître vos réclamations et réunir une assemblée de docteurs de l'islam dans laquelle les vôtres seront admis pour y présenter et y discuter leurs idées.» Mais, en réalité, le Prince, tout en exerçant ses troupes, attendait des renforts qui lui permissent de tenter une surprise heureuse. Il faisait d'ailleurs fouiller les environs et arrêter tous ceux qui paraissaient suspects de babisme. Ce fut ainsi qu'on emprisonna Molla Youssouf Ali Ardébili qui cherchait à rejoindre Bab el Bab. Notre auteur rapporte que ce fut à ce moment que lui-même, avec Mehemet Taghi Khan Nouri et quelques autres, se rendit à Nour auprès de Mirza Housseïn Ali, le futur Béha. Ils insistèrent auprès de lui pour l'amener dans la forteresse, mais il répondait invariablement qu'il était inutile de tenter cette aventure puisqu'il était sûr d'être arrêté en route. Il céda enfin à leurs instances, prit 4.000 tomans en argent et tous les objets nécessaires. Arrivée à deux farsakhs de la forteresse, la petite troupe fut en effet arrêtée par les forces royales et conduite devant le Prince qui en ordonna l'exécution immédiate.
Mais les grands du Mazandéran intervinrent et plaidèrent la cause de Mirza Housseïn Ali dont la famille était une des plus illustres de leur province. Aussi, se contenta-t-on de le dépouiller et de l'envoyer à Barfourouch où, après avoir été passablement martyrisé, il parvint à s'enfuir.
Mirza Djani eut la chance de rencontrer dans le camp deux négociants de son pays, c'est-à-dire de Qachan, qui, créanciers de quelques officiers, rachetèrent le captif par l'abandon de leurs créances.
Ces arrestations ne restèrent pas inconnues du Bab el Bab : aussi comprit-il rapidement que le Prince, par sa promesse de conférence, avait voulu endormir sa méfiance : convaincu que les impériaux méditaient une surprise, il résolut de les devancer.
Le même jour, une neige abondante tomba, qui couvrit tous les environs ; la température baissa considérablement et les soldats coururent se réfugier dans tous les coins abrités où ils se couchèrent et dormirent sans se soucier le moins du monde des ennemis.
Molla Housseïn et Hadji Molla Ali, qui étaient merveilleusement renseignés sur ce qui passait dans l'armée royale, saisirent l'admirable occasion qui se présentait. Ils choisirent 300 compagnons résolus à vaincre ou à mourir et, cette nuit même malgré le froid, il leur fit traverser la rivière et courut à Vaskès.
Avant de pénétrer dans le village, il détacha quelques-uns des siens avec ordre de le précéder et leur donna pour instruction d'annoncer à tous ceux qu'ils rencontreraient qu'ils étaient les avant-coureurs, d'Abbas Kouli Khan Laridjani et que ce général les suivait de très prés.
Ainsi fut fait, et les babis traversèrent aisément le camp royal : ils arrivèrent ainsi jusqu'à la demeure du Prince. Les soldats de garde, réveillés par le bruit, leur demandèrent qui ils étaient et d'où ils venaient. Ils firent la réponse convenue et Molla Housseïn survint aussitôt. Il fit garder toutes les rues aboutissant à la maison afin d'empêcher les soldats de venir au secours de leur chef et recommanda à ceux qu'il prit avec lui de crier dès leur entrée dans la demeure de Mehdi Qouli Mirza : «Le Prince est mort ! le prince est mort !» Il était sûr ainsi de terroriser l'armée qui devait s'enfuir comme un seul homme.
Il fut obéi à la lettre et, dès les premiers cris annonçant la terrible nouvelle, le camp royal fut dans une confusion inexprimable.
Molla Housseïn parcourut toutes les chambres, tuant ceux qu'il rencontrait : ayant fait maison nette, il y mit le feu ; tout flamba et propagea l’incendié dans les maisons avoisinantes : les cavaliers de Sevad Kouh furent tués jusqu'au dernier et l'on jetait les cadavres dans les flammes ; les survivants, pris de terreur panique, s'enfuirent sans prendre le temps de se vêtir. C'est dans cette nuit que moururent le prince Soultan Housseïn Mirza, fils de Feth Ali Chah, le Prince Davoud Mirza, fils de Zell-ès-Soultan ; et le Moustofi Mirza Abdoul Baghi. Leurs cadavres allèrent rejoindre dans la fournaise ceux des autres musulmans.
Le Prince Mehdi Kouli Mirza s'enfuit par une porte dérobée, dit le Nacikh out Tevarikh, en sautant de la terrasse de la maison, dit l'historien Babi. Il erra toute la nuit à travers champs, dans l'obscurité et le froid glacial qui l'environnaient de toutes parts.
Pendant ce temps, les babis tuaient, pillaient, incendiaient. Ils étaient surtout menés au pillage par leur chef Agha Reçoul Behendmiri. Ils délivrèrent d'ailleurs leurs coreligionnaires antérieurement faits prisonniers par le Prince. Le jour parut enfin et Quouddous donna le signal du ralliement; la plupart de ses compagnons, surchargés de dépouilles, embarrassés de butin, tardèrent à rejoindre leur chef. Aussi quelques echréfis, réfugiés sur le flanc de la montagne où ils s'abritaient derrière des fortifications élevées à la hâte, voyant que les babis étaient en petit nombre et, de plus, dispersés de droite et de gauche, reprirent courage et vinrent les attaquer. Molla Housseïn et Quouddous réunirent quelques hommes, s'élancèrent sur les assaillants qui s'enfuirent, laissant beaucoup des leurs sur le carreau, mais ayant fait mordre la poussière à trois de leurs ennemis. Dans cette échauffourée, une balle vint atteindre Quouddous à la bouche.
Les musulmans voient dans cette blessure un châtiment de Dieu, punissant cette bouche des impostures qui en étaient sorties.
Les impériaux définitivement mis en fuite, la troupe baille se reforma et se dirigea vers le château. La terreur des soldats était si grande que nul ne songea à une revanche facile. Ils contemplèrent leurs ennemis emportant leur butin, les chevaux, les moutons et les bagages du prince. C'est au point que 600 impériaux qui se trouvaient par hasard sur la route conduisant à Cheik Tebercy, s'enfuirent affolés, dès qu'ils aperçurent les babis. Ceux-ci rentrèrent paisiblement à leur forteresse où ils arrivèrent à 10 heures du matin.
Le Prince Mehdi Qouli Mirza avait erré toute la nuit par des sentiers affreux ; il n'en pouvait plus de fatigue, d'inquiétude et de froid, lorsqu'il fut enfin reconnu par un paysan qui le fit monter sur son cheval et le conduisit à une étable où il l'installa. Puis il courut de tous côtés annoncer la bonne nouvelle que le Prince n'était pas mort. Il rallia ainsi les débris de l'armée dispersée, mais Mehdi Qouli Mirza, dégoûté de la leçon qu'il venait de recevoir, tourna les talons, partit pour Kadi Kélah où il passa la nuit et se rendit le lendemain à Sari.
Le bruit de la victoire babie se répandit dans toute la Province, grossissant de bouche en bouche : les histoires les plus effroyables circulaient, qui répandaient partout la terreur la plus folle ; on s'attendait à chaque instant à une attaque subite, à un pillage, à un assaut. Les femmes, les enfants, fuirent dans les montagnes, où elles furent bientôt rejointes par leurs frères ou leurs maris, abandonnant à leur tour les villages ; la désolation, la peur, régnaient en souveraine maîtresse.
C'est au milieu de ces circonstances difficiles quo Mehdi Qouli Mirza s'occupait à Sari à recruter une nouvelle armée, ne rencontrant partout que terreur panique, et c'est à grand peine qu'à l'aide des plus brillantes promesses, il parvenait à s'assurer le concours de quelques chefs qui lui amenaient leurs hommes. Pendant qu'il était ainsi occupé, Abbas Kouli Khan Laridjani, désireux de se distinguer et de finir la campagne à lui tout seul, conduisit devant Cheikh Tebercy l'armée qu'il avait préparée pour le Prince, et mit le siège devant la forteresse.
Sûr du succès, il eut le mauvais goût de prier le Prince de ne lui envoyer aucun renfort, n'ayant besoin de personne pour châtier les rebelles. Il l'invita même à venir voir de ses propres yeux comment il devait conduire une guerre aussi facile.
Le Prince, quand il reçut ce message, ayant désormais l'expérience de la défaite, comprit ce que ces rodomontades pouvaient valoir vis-à-vis d'un ennemi aussi déterminé que celui auquel on avait affaire. Il eut le bon sens d'envoyer au secours du Laridjani Mohsèn Khan et ses hommes, quelques afghans et Mohammed Kérim Khan Echrefi avec des fusiliers d'Echref. Puis il donna l'ordre à Khalil Khan Sevad Kouhi de venir rejoindre le gros de l'armée avec les hommes de Qadi Qèla. Toutes ces précautions prises, il se rendit de sa personne auprès d'Abbas Qouli Khan et l'invita à mener le siège suivant toutes les règles de l'art. Mais le Laridjani ne voulut rien entendre, se contentant de répondre aux objurgations du Prince : «Les fortifications des habitants de Laridjan sont leurs propres corps.»
Il se riait des dangers qu'il considérait comme imaginaires et n'avait qu'un mépris profond pour ces babis qu'on n'apercevait même plus. Ceux-ci, en effet, pour endormir la vigilance qu'ils supposaient chez leurs ennemis faisaient les morts derrière leurs murailles et l'on eût juré que la forteresse était inhabitée si, de temps à autre, deux ou trois personnes n'en fussent sorties pour venir, au nom des assiégés, reconnaître leurs fautes et demander leur pardon. Ces démarches plusieurs fois répétées enchantaient Abbas Qouli Khan qui les renvoyait vers leurs coreligionnaires pour leur annoncer qu'il les passerait tous au fil de l'épée.
Quelques jours se passèrent ainsi quand le 10ème jour du mois de Rebbi el Evel arriva. Le matin, 3 heures avant le lever du soleil, Molla Housseïn en ayant obtenu l'autorisation de Qouddous que sa blessure à la bouche rendait incapable de commander, sortit doucement de la forteresse par la porte de l'Est, avec 400 fusiliers déterminés (220). Il se posta avec quelques cavaliers à un angle du camp pour fusiller les fuyards et donna l’ordre à son monde d’attaquer de l’autre côté.
L’armée royale dormait à poingts fermés sans avoir l’air de se douter qu’elle assiégeait une place ennemie. Soudain les babis hurlant leur cri de guerre «Ya sahab ez zéman», se précipitèrent sur le Sevad Kouhi et les Hezar Djeribis qu’ils commencèrent à massacrer. Ces malheureux ainsi surpris s’enfuirent à la première attaque, mais les religionnaires les détournèrent sur les Qadi Kelahi. Ceux-ci surpris de cette tumultueuse attaque et croyant avoir affaire à une troupe ennemie, tournèrent les talons et s'allèrent jeter sur les Sooureti et les Echrefis. La confusion devint inextricable et les soldats perdant la tête se mirent à se tuer les uns les autres à la grande joie des babis. Une poussée formidable se produisit et l'armée entière alla heurter les Laridjanis. Les coups de fusils partirent de plus belle et Abbas Qouli Khan faillit mille fois être tué. Il parvint cependant à se tirer de l'affreuse bagarre pendant que Mohammed Soultan Yaver cherchait à rétablir l'ordre et à engager le combat. Les babis survinrent et lui, les prenant pour des soldats de l'armée royale, les appela à grands cris, les exhortant à combattre courageusement et à tuer le plus grand nombre possible de Babi. Il avait à peine achevé de parler qu'il tomba, haché de coups de sabre. Les babis poursuivirent leur avantage, mais 80 d'entre eux restèrent sur le carreau.
A ce moment, Molla Houssein voyant le tumulte à son comble se précipita sur le lieu du carnage. Les troupes impériales fuyaient de toutes parts, ahuries parles cris, les coups de fusils et l'incendie, que les religionnaires avaient allumé car la nuit était obscure et il pleuvait. Le feu flambait et éclairait magnifiquement cette scène de désordre, d'horreur et de désespoir.
Seuls, Mirza Kérim Khan Echrefi (221) et A Mehemt Khan Laridjani résistèrent à la panique : ils s'enfermèrent à la hâte avec quelques compagnons, derrière des retranchements élevés rapidement, tous décidés de mourir jusqu'au dernier plutôt que de fuir ou de se rendre. Grâce à la lumière de l'incendie ils contemplaient les babis égorgeant les musulmans comme des moutons, et tiraient sans trêve sur les assaillants. Soudain un cavalier parut, la tête couverte d'un turban vert. «Tu vois bien ce cavalier, dit Mirza Kérim Khan à Mohammed Khan, regarde-le car c'est Molla Housâeïn.» Ce disant, il déchargea sur lui son fusil. On vit le Molla porter la main à sa poitrine et l'on comprit que la balle l'avait atteint à cet endroit. Au même moment Mohammed Hassan visa aussi le Molla qu'il atteignit au ventre. Malgré ses deux blessures le Bouchrouyehi eut le courage de rester à cheval et de continuer à combattre. Mais bientôt, sentant que ses forces allaient l'abandonner, il commanda la retraite. Celle-ci eut lieu en bon ordre et quoique les Echrefis continuassent à tirer, Molla Houssein ne précipita pas un instant sa marche : c'est au pas qu'il parvint à la forteresse à la porte de laquelle il tomba.
Le matin se leva : Mirza Kerim Khan Echrefi monta sur un mur et chanta l'azzan afin de rallier les troupes. Abbas Kouli Khan Laridjani avec ses 50 hommes, Abdoullah Khan Afghan, avec 3 compagnons, et Mohsin Khan avec quelques cavaliers d'Echref, qui n'avaient pas été pris de panique et étaient restés à faire le coup de feu sur le champ de bataille, rejoignirent aussitôt. Tous étaient honteux et inquiets de ce qu'allaient penser les sphères gouvernementales. Aussi, après avoir enterré leurs morts, décapitèrent-ils les 80 cadavres babis qu'ils trouvèrent, et envoyèrent-ils les têtes dans les différentes villes de la province, afin de prouver ainsi que les sectaires n'étaient pas invulnérables. Abbas Kouli Khan expédia un exprès nommé Abdoulllah Khan au prince Medhi Mirza : il lui confia une lettre et quelques têtes d'ennemis.
L'auteur babi, certainement ici plus exact que l'auteur musulman, rapporte qu'Abbas Kouli Khan Laridjani après avoir enterré ses morts - 400 soldats et 35 officiers - profané les cadavres ennemis et expédié un express à Mehdi Qouli Mirza, se retira à Amol, pendant que les sectaires, qui s'étaient égarés durant la nuit, rejoignaient le château.
La mort du Bab el Bab les plongea dans la désolation, quoiqu'elle eût été prédite et qu'elle ne fit qu'accomplir les prophéties. Le cadavre du chef babi fut enterré secrètement sous les murs du tombeau de Cheikh Tebercy : on mit son sabre dans sa tombé. On enterra également les cadavres des religionnaires qui avaient succombé dans cette nuit si glorieuse mais si fatale en même temps. On fit le compte de ceux qui avaient été tués depuis le commencent de la guerre, il se montait à 70, conformément aux prédictions de la Khoutbé Ezelyèh.
J'admets parfaitement que la Khoutbé Ezelyèh n'ait rien prédit du tout, et que le chiffre ait été mis après coup, mais il est plus que probable que ce chiffre est exact, et c'est pour cela que je le donne.
Quoi qu'il en soit, les babis furieux de voir que l'on avait profané les cadavres des leurs, déterrèrent les soldats musulmans, leur coupèrent la tête qu'ils fichèrent au bout de longues piques plantées devant la forteresse. Ils jetèrent les corps ainsi mutilés dans les champs d'alentour pour être la proie des bêtes sauvages, et ils ensevelirent pieusement les leurs. Puis ils rentrèrent chez eux et attendirent l'ennemi.
Cette fois la terreur fut à son comble dans la province ; le peuple surexcité par les défaites successives de l'Islam commençait à pencher pour la nouvelle religion : les chefs militaires sentaient leur autorité chancelante, les chefs religieux voyaient leur échapper les consciences, la situation était tendue à l'extrême, et le moindre incident pouvait précipiter le Mazanderàn aux pieds du Réformateur. Dans ces circonstances critiques, Saïd el Oulema épouvanté, écrivit à Abbas Kouli Khan Laridjani une lettre dans laquelle il l'adjurait de reprendre l'offensive : «Certes tu t'es montré plein de vaillance et de courage; tu t'es exposé et les tiens se sont bien battus. Tu as remporté la victoire, et ton sabre a couché dans la poussière une foule de tes ennemis ; mais tu es revenu laissant en vie dans la forteresse quelques vieillards débiles et sans force. C'est un autre qui recueillera le fruit de ta victoire, c'est lui qui pénétrera dans le château privé des défenseurs, à lui le pillage et la gloire ! Pourquoi ne finirais-tu pas toi-même ce que tu as si bien commencé ? Sache bien que c'est là pour toi le devoir le plus strict et le plus pressant : ta gloire en ce monde y est attachée, ton salut dans l'autre en dépend. Retourne au château et mets tout en oeuvre pour que la médaille d'or de la victoire soit frappée à ton nom.»
Non content d'agir directement sur l'esprit du Laridjani, Saïd el Oulema écrivit aux Docteurs d'Amol une lettre fort longue dont tous les paragraphes se terminaient par ce refrain : «Hâtez-vous de faire partir Abbas Kouli Khan, ne le laissez pas s'attarder à Amol.»
Abbas Kouli Khan était partagé par bien des sentiments divers : certes il brûlait de se venger, certes il voulait laver la honte qui le couvrait, tant aux yeux du Chah qu'aux yeux des femmes du Laridjan dont il avait fait tuer les maris, mais d'autre part, il n'était pas très sûr de réussir. Les hommes étaient démoralisés, la plupart de ceux qui étaient autour de lui soignaient leurs blessures, le reste s'était enfui et caché dans les villages environnants.
Aussi, importuné par les oulemas d'Amol qui ne remplissaient que trop bien la commission de Said el Oulema, songeant d'ailleurs que c'était là un moyen peut-être de réveiller l'ardeur islamique. «C'est plutôt votre affaire que la mienne s'écria-t-il. Si vraiment la religion est intéressée à la destruction des babis, prêchez la guerre sainte, mettez vous, vous mollas, vous Moujtehids, à la tête du peuple et marchez contre le château, je vous aiderai de toutes mes forces !»
Les oulemas se trouvèrent pris à leur propre piège, sans aucun moyen de reculer : ils durent obéir et firent prêcher la guerre sainte dans toutes les mosquées. On réunit ainsi la tourbe de la population et cette foule hétéroclite se précipita sur les pas des oulemas et des étudiants en théologie.
Quelques-uns restèrent avec Abbas Kouli Khan, le plus grand nombre se rendit à Barfourouch où il se joignit à l'armée de Mehdi Kouli Mirza. .
Celui-ci, en effet, pendant que tous ces événements se passaient, avait réuni et organisé une forte armée avec laquelle il était parti pour Sari, d'où il se mit en route pour Cheikh Tebercy. Il avait à peine quitté Surkhé Kéla où il avait campé la nuit, que le messager d'Abbas Kouli Khan Laridjani lui remit la lettre dont il était porteur en même temps qu'il lui montrait les tètes coupées des babis. La lettre ne disait pas grand’chose car Abbas Kouli Khan s'y taisait sur la déroute de son armée et la victoire des sectaires. Il en agissait ainsi tant pour ne pas avouer sa défaite que pour ne pas jeter le trouble et le découragement dans l'armée du Prince.
Celui-ci, peu soucieux de voir son subordonné cueillir à lui seul des lauriers qui devaient lui appartenir en sa qualité de Prince donna l'ordre de hâter la marche afin de prendre sa part de la victoire qui lui apparaissait désormais si facile. On courut ainsi jusqu'au pont de Kara Sou Ali Abad. Là Abdoullah Khan, l'Afghan et Mirza Abdoullah Nevahi prirent le prince à l'écart et lui révélèrent la vérité.
Medhi Qouli Mirza fut fort refroidi par cette communication qui lui présentait les choses sous un tout autre aspect. Aussi donna-t-il l'ordre de faire revenir l'avant-garde, puis il assembla les principaux officiers et les avisa de ce qui s'était passé.
On se rendit à Qia Qéla où un conseil de guerre fut tenu. Quelques rares officiers conseillèrent la marche en avant, les autres affirmèrent qu'il vaudrait mieux camper là où l'on se trouvait. Enfin on tomba d'accord que les troupes avaient une peur bleue des babis, qu'il fallait les exercer et les rassurer avant de rien entreprendre, une nouvelle victoire devant rendre instantanément les babis maîtres du Mazandéran.
On resta donc quatre jours à Qia Qéla où l'on prépara tout ce qui était nécessaire et le 5° jour, l'armée s'étant mise en marche on arriva à Cheikh Tébercy.
Là, on se trouva en face des cadavres à demi dévorés et des têtes fichées sur les piques. Le prince fut terrifié à cette vue; il comprit qu'il n'y avait d'autre moyen de mener à bien cette affaire que d'assiéger la forteresse dans toutes les règles de l'art.... persan.
Pour aviser aux mesures à prendre il dépassa la forteresse et alla s'installer à un farsakh de là, au village de Qachette. C'est là que le rejoignit Abbas Kouli Khan Laridjani.
On y resta trois jours à discuter ce qu'il y avait à faire, en même temps qu'on réunissait de toutes parts des recrues.
Les Mollas, les étudiants en théologie avaient été saisis d'une terreur qui ne les quitta plus quand ils eurent aperçu les têtes de musulmans qui «ornaient comme des fruits, la forêt de piques plantées par les babis». Fort peu convaincus de l'assistance céleste, croyant leur dernier jour arrivé, ils ne pouvaient dormir et passaient leurs nuits à se lamenter. Ils maudissaient le Prince et Abbas Kouli Khan qui les avaient forcés à venir dans ce guêpier, ils anathématisaient Saïd el Oulema qui était resté bien tranquille à Barfourouch alors qu'il les avait envoyés à la boucherie : «N'est-ce pas là du temps perdu pour la science, disaient-ils, et la religion ne serait-elle pas bien plus honorée si nous étions restés à nos études et à nos discussions. D'ailleurs pourquoi nous envoyer faire la guerre ? Faire la guerre c'est se tuer soi-même, or Dieu l'a défendu dans son verset: «Ne vous jetez pas de votre propre main dans la mort.»
Les plus lâches disaient : «Moi j'ai ailleurs des devoirs religieux bien plus importants à remplir, d'après la loi je suis obligé de m'en aller». Un autre : «Que faire, j'ai un petit enfant. Et moi, disait l’autre, je n'ai pas laissé à ma femme de quoi vivre, il faut que je m'en retourne. Oh ! je reviendrai si la chose est nécessaire». Un autre: «Je n'ai pas réglé mes comptes et si je suis tué ma fortune est compromise; j'aurais ainsi été inique envers ma femme et mes enfants. Or d'un côté compromettre sa fortune est légalement oeuvre mauvaise, d'autre part l'iniquité déplait à Dieu !» Un autre : «Je suis débiteur vis à vis de tant de gens et je n'ai personne pour m'acquitter. Si je suis tué je resterai débiteur et mes créanciers ne me laisseront pas traverser le pont qui conduit au paradis». Un autre pleurait: «Je suis venu malgré ma mère et elle me disait si tu pars que mon lait te soit illicite ; j'ai peur de mourir maudit». «Moi j'avais fait le voeu solennel d'aller cette année à Kerbela ; or se prosterner sur la tombe, du Seigneur des Seyyeds vaut mieux que 100.000 morts dans la guerre sainte !».
D'autres plus hypocrites: «Ces babis, nous n'avons jamais entendu aucune impiété sortir de leurs bouches. Ils croient à Dieu et à son prophète. Ils s'imaginent que l'imam caché s'est manifesté, eh bien, qu'on les laisse croire. En tous cas ils ne sont pas pires que les Sunnis qui ne croient à aucun des 12 imams ni aux 14 purs. Ils acceptent Omar comme khalife et préfèrent Osman au fils d'Abou Taleb. Ils acceptent comme premier successeur du Prophète Abou Becre, quoi qu'il fût le père d'Aïchah. Eh bien mais, c'est avec les Sunnis qu'il faudrait faire la guerre et non avec les babis qui n'ont qu'une légère différence d'opinion avec nous, et dont la vérité ou l'erreur n'ont pas encore été prouvées.»
Abbas Qouli Khan et le Prince craignant que leurs terreurs ne gagnassent les soldats, que leurs murmures ne trouvassent de l'écho dans le camp s'empressèrent de les renvoyer. Ils partirent donc enchantés, au fond du moins, mais ayant bien soin de bénir l'armée et de demander à haute voix au Dieu de l'Islam de lui accorder la victoire.
Enfin, le quatrième jour, on commença à construire une solide fortification autour de la forteresse. Le prince nomma Hadi Khan Nouri et Mirza Abd Oullah Khan Nouri comme approvisionneurs de l'armée. Il assigna leurs postes autour de la forteresse à Abbas Qouli Khan Laridjani et à Nassr Oullah.
Tous ces régiments ayant occupé les points dont la garde leur était confiée il ordonna de creuser des approches et de construire des tours dominant la forteresse de façon à empêcher les babis de sortir de chez eux, et de circuler dans l'intérieur du fort. Mais Hadji Mohammed Ali profita des nuits sans lune pour faire exhausser ses murailles et ses tours de façon que ses compagnons pussent vaquer tranquillement à leurs occupations et à leurs devoirs.
Le Prince demanda alors à Téhéran qu'on lui envoyât deux bons canons et deux mortiers. (222)
Le siège continuait ainsi : les pièces d'artillerie arrivèrent au moment où un Herati de l'armée royale venait de fabriquer un instrument qui lançait des bombes jusqu'à 70 coudées de distance : on les faisait ainsi tomber dans la forteresse où l'on incendia les maisons des babis. En même temps les canons et les mortiers faisaient pleuvoir, dit l'auteur persan, la mort dans le camp des sectaires. Pleuvoir est exagéré mais il est certain que le feu de l'armée royale gêna tellement les défenseurs de Cheikh Tébercy que Quouddous alla s'installer dans les remblais pendant que ses compagnons se logèrent dans des souterrains : et l'on se moqua de l'artillerie royale.
Celle-ci fut rejointe par Djaafer-Kouli Khan de Bala-Restaq, dans le Hézar-Djérib, avec son contingent. Sur l'ordre du Prince il construisit une tour à l'Ouest de Cheikh-Tebercy et près des murs. Il fit en trois jours ce travail qui eut demandé trois mois à tout autre. Le 4ème jour au matin, son ouvrage terminé il fit rentrer ses hommes au camp et leur accorda un repos bien mérité : mais le Prince ne voulut pas l'admettre et donna l'ordre à ces gens de retourner sur leurs pas pour aller construire des retranchements autour de la tour. Les officiers expérimentés de l'armée eurent beau lui exposer que ces hommes étaient rompus de fatigue et qu'ils n'avaient même pas mangé, qu'il fallait avant tout les laisser se reposer et se restaurer, le Prince ne -voulut rien entendre et maintint l'ordre qu'il avait donné. Les soldats, peu soucieux d'obéir s'enfuirent de tous côtés et c'est avec beaucoup de peines que Djaafer Kouli Khan et Mirza Abdoullah réunirent 35 hommes qu'ils ramenèrent vers la tour. Aussitôt arrivés là, ces hommes se couchèrent et s'endormirent. Les babis observaient du haut de leurs murailles ce qui se passait : ils comprirent qu'une excellente occasion se présentait à eux : ils sortirent au nombre de deux cents de leur forteresse et se jetèrent en hurlant sur les hommes endormis. Mirza Abdoullah qui veillait déchargea son fusil et en tua deux, ce qui fit instinctivement détourner les assaillants sur la tour de Djaafer Kouli Khan, dans laquelle ils entrèrent facilement, massacrant tout sur leur passage. Djaafer Kouli Khan en tua deux de sa propre main pendant que ses soldats en tuaient aussi deux autres, mais les babis se jetèrent sur lui et l'assaillirent à coups de sabre. Ayant reçu plusieurs blessures il se jeta dans le fossé de la tour. Les babis assaillirent et tuèrent son neveu Thamasp Kouli Khan, puis laissant quelques-uns d'entre eux au sommet de la tour qui tiraient dans la direction de l'armée royale pour l'empêcher d'approcher, ils balayèrent les environs immédiats. Enfin ils sonnèrent la retraite, et comme ils passaient ils virent Djaafer Kouli Khan dans le fossé et le criblèrent de balles.
Pendant leur retraite, Mir Abdoullah en tua encore deux, ce qui porta à 8le nombre de leurs morts. Puis il vint relever Djaafer Kouli Khan horriblement blessé et le reconduisit au camp. Les parents pansèrent les blessures de cette victime de l'entêtement du Prince, et la firent transporter à Sari. Mehdi Kouli Mirza furieux de ce qu'on en eût agi ainsi sans sa permission eut la cruauté, au moins inutile, de l'envoyer chercher. On le ramena, mais ce double voyage dans l'état où il était eut le résultat qu'il devait avoir : le pauvre officier mourut dès son arrivée au camp.
Il y avait quatre mois que cela durait; aussi le Chah commença-t-il à s'impatienter: les succès Babi enflammèrent sa colère qu'il exhala en ces termes, suivant l'historien persan : «Nous pensions que notre armée entrerait sans hésiter dans l'eau ou dans le feu, que sans peur elle lutterait contre un lion et une baleine. Nous l'avons envoyé combattre une poignée d'hommes faibles et sans force et elle ne fait rien ! Les grands du Mazandéran pensent-ils que ces retards nous agréent ? Laissent-ils grandir l'incendie pour grandir leurs succès ? Eh bien qu'ils le sachent, je ferai comme si Allah n'avait pas créé le Mazandéran et j'en exterminerai les habitants jusqu'au dernier.»
Les princes et les grands personnages témoins de cette colère se portèrent garants de la prise prochaine de la forteresse et du massacre des babis.
Alors sa majesté ordonna à Soleiman Khan Afchar de se rendre au Mazandéran pour faire une enquête sur ce qui se passait. Son arrivée stimula le zèle de l'armée royale : les soldats turcs attaquèrent avec vigueur la forteresse des deux côtés à la fois. On décida de faire sauter les murs à la mine et de se précipiter tous ensemble par la brèche ouverte.
La mine creusée à l'Ouest réussit fort bien : cinquante mètres de mur tombèrent sous l'explosion. La mine de l'Est au contraire mal creusée ne produisit aucun effet. Le signal de l'assaut fut donné et l'attaque générale commença. Elle fut plus vive et plus vigoureuse à l'endroit où la brèche était ouverte. On tirait à coeur joie sur les babis. Mirza Kérim Khan leva son étendard et, sans souci des balles, vint au pied de la forteresse. Un Babi sortit son fusil par une meurtrière pour abattre l'audacieux assaillant mais celui-ci saisit l'arme par le canon et par une pesée vigoureuse l'arracha des mains de l'ennemi. Il monta alors sur la tour, y planta son drapeau et cria aux soldats de se hâter de venir le rejoindre. Mohammed Saleh Khan, frère de Djaafer Kouli Khan, accourut avec les hommes de Balarestaq.
Les choses allaient tourner fort mal pour les sectaires quand, on ne sait quel vertige s'emparant du prince, il fit sonner la retraite.
Mirza Kérim Khan et Mohammed Salèh Khan furent obligés de reculer, la rage dans le coeur, les autres officiers furent stupéfaits et l'on fit comprendre au Prince ce que sa conduite avait d'étrange. Enfin on se promit qu'à la prochaine occasion on pousserait jusqu'au bout ses avantages et qu'on s'emparerait coûte que coûte de la forteresse.
Mais on changea bientôt d'avis car on apprit que les provisions de la garnison babie s'épuisaient rapidement, et qu'elle risquait de mourir bientôt de faim. C'est alors que quelques courages commencèrent à faiblir chez les assiégés. Agha Reçoul qui était un des personnages influents parmi les babis se rendit personnellement au camp du Prince et obtint son pardon ainsi que celui de trente de ses compagnons. Il revint à la forteresse chercher ceux qu'il pensait ainsi avoir sauvés et en ressortit avec eux. Quand il arriva près du camp un Laridjani, croyant à une attaque, l'abattit d'un coup de fusil, les autres soldats l'imitèrent couchant sur le carreau plus de la moitié des transfuges. Les autres surpris de cette réception à laquelle ils ne s'attendaient guère tournèrent les talons et coururent vers la forteresse ; mais leurs camarades les voyant venir, sans que rien pût expliquer leur sortie, comprirent ce dont il s'agissait et les tuèrent jusqu'au dernier.
Riza Kouli, fils de Mohammed Khan Mirakhor de Mohammed Chah fut plus heureux. Il sortit de la forteresse avec deux ou trois de ses amis et vint se réfugier au camp où il fut confié à la garde de Hadi Khan Nouri.
D'autres babis enfin parvinrent à traverser nuitamment les lignes d'investissement et rentrèrent chez eux.
Sur ces entrefaites Mehdi Qouli Mirza et Abbas Kouli Khan Laridjani allèrent visiter une tour voisine des murs de la forteresse. Les babis les saluèrent d'une grêle de balles: l'une d'elles entra par une fissure du mur et frappa Abbas Kouli Khan à l'épaule, mais sans lui faire grand mal.
Enfin la garnison assiégée était arrivée au bout de ses provisions de bouche. Comme ils ne pouvaient sortir ils mangèrent tout ce qu'ils trouvèrent : les feuilles et l'écorce des arbres, l'herbe, les cuirs de leurs ceinturons et des fourreaux de leurs sabres ; ils ramassèrent tous les ossements qu'ils trouvèrent, les firent torréfier et en préparèrent une pâte dont ils se nourrirent. On déterra le cheval de Molla Housseïn, et malgré qu'il fût à moitié pourri, ils le dévorèrent. Ils n'en étaient d'ailleurs pas moins ardents à la bataille et ne se relâchèrent pas de leur enthousiasme. A l'Ouest de la citadelle les soldats royaux avaient construit une grande tour dont le fossé avait dix mètres de profondeur et dix mètres de largeur. On y avait établi un pont composé de deux troncs d'arbres. La tour était gardée par Mirza Abdoullah Nevahi avec les gens te Béndépey, d'Eschref et de Balarestaq. Un soir pendant que ces musulmans faisaient leur prière le pont n'étant pas encore relevé trois Babis entrèrent et avec le plus grand sang froid se mirent à couper des têtes. Mirza Abdoullah Nevahi pensant avoir affaire à l'avant-garde babie fit jeter les troncs d'arbre dans le fossé. L'un de ces trois héros courut au haut de la tour, passant au fil de l'épée tous ceux qu'il rencontrait. Arrivé là il cria à ceux de Tebercy «bâtez vous ! j'ai pris la tour.»
Ses deux compagnons, tombèrent enfin après avoir fait une hécatombe de soldats ; mais lui, resté au sommet de la tour, tuait tous ceux qui osaient monter pour l'attaquer. Aussi les ennemis se lassèrent-ils bien vite de ce jeu et il fallut couvrir d'or un homme de Talech pour le décider à tenter l'aventure: il fut plus heureux que ses prédécesseurs et abattit le babi d'un coup de fusil.
Ce courage sombre et désespéré, cette ardeur invincible, cet enthousiasmé irréductible donnaient fort à penser aux chefs de l'armée impériale. Désespérant d'arriver à forcer des retranchements d'où ils avaient été si souvent repoussés, ils songèrent à la ruse. Le Prince y était naturellement porté, et Souleiman Khan Afchar envoyé en dernier lieu par le Chah pour contrôler les opérations militaires y poussait de toutes ses forces, songeant que de plus longs délais compromettaient sa fortune et sa vie. Le Prince écrivit donc à Quouddous une lettre dans laquelle, faisant ressortir les horreurs d'une guerre cruelle entre gens d'une même nationalité, il proposait une paix durable et définitive.
Quouddous crut-il à la bonne foi du Prince, cela est probable quoique l'historien Babi prétend qu'il eût flairé le piège mais qu'il résolut alors, voyant d'ailleurs toute résistance impossible, de se vouer au martyre. Il répondit donc qu'il acceptait la paix et que si on leur jurait de respecter leurs vies et leurs libertés ils partiraient immédiatement et se rendraient dans d'autres provinces.
Le Prince et Abbas Kouli Khan heureux de voir l'ennemi mordre si facilement à l'hameçon n'hésitèrent pas à écrire les termes du traité sur la feuille de garde d'un Qoran, de le sceller de leurs sceaux et de l'envoyer ainsi au chef Babi. Ils consentaient à tout ce que celui-ci avait exigé, mais ils exprimèrent le désir d'avoir une entrevue avec lui. Quouddous aurait répondu à l'envoyé : «je sais quelle est la pensée de derrière la tête du Prince, mais je veux montrer aux musulmans quel respect j'ai pour le Livre de Dieu.» Il récita en même temps la strophe du Mesnévi qui commence par ces mots : Mon âme est un oiseau d'eau, pourquoi se plaindrait-elle du déluge de malheurs qui l'environne de toutes parts ?
L'auteur musulman du Nassikh et Tevarikh prétend que le Prince mit comme condition à cette reddition que les sectaires reviendraient à l'islam. Mais les auteurs babis le nient et avec raison, je pense; D'abord il importait fort peu au Prince que ces gens crussent à Dieu ou au diable; ensuite il savait fort bien que les babis n'eussent certainement pas consenti à cette apostasie, enfin et c'est la raison la plus convaincante le Prince préparait déjà le guet-apens dans lequel il allait faire tomber ses malheureux adversaires. Dès lors il n'avait besoin de rien leur demander, risquant par une exigence inadmissible de pousser les babis à un dernier acte de désespoir qui aurait pu lui coûter beaucoup de monde.
Le Prince fit donc dresser des tentes pour les babis et envoya un cheval à Quouddous. Les sectaires sortirent avec tous les honneurs de la guerre, leur chef en tête, au nombre de 214, hâves, extenués, déguenillés. Ils se rendirent aux tentes qui leur avaient été assignées, et après s'être restaurés, s'endormirent.
Le lendemain matin le Prince invita Qouddous et les autres chefs sous sa tente, pour y régler la question du départ. Ces chefs étaient au nombre de 14 suivant les uns, de 7 suivant d'autres. On amena la conversation sur la religion : les babis ne cachèrent ni leurs convictions ni leur mépris pour l'Islam. C'est tout ce que l'on voulait, ils furent immédiatement arrêtés, et le Prince donna l'ordre de massacrer le reste, se basant sur la loi islamique d'après laquelle tout musulman qui renie sa religion doit être exécuté. Les babis exténués, étaient en train de prendre leur repas quand ils se virent tout d'un coup enveloppés par les musulmans.
On les fit aligner sur un rang et l'on s'amusa à leur fendre le ventre : opération d'autant plus réjouissante que des intestins fendus sortait de l'herbe, non encore digérée, témoignage éclatant des souffrances qu'ils avaient éprouvées, mais aussi de la foi qui les avait soutenus. Quelques-uns, bien rares, parvinrent à s'enfuir dans la forêt.
On se grise à l'odeur du sang et quand on n'eut plus rien à tuer on songea à Riza Khan et aux autres transfuges qu'on avait confiés à Hadi Khan Nouri. On les fit venir et on les tua. C'est dans cette lâche tuerie que périt le fils de Molla Abdoul Khaleq.
Le Prince fit garder à vue Quouddous et les autres chefs qu'il avait invités le matin : il réservait leur exécution aux dilettanti de Barfourouch.
Désormais libre de toute inquiétude, on alla se promener dans la forteresse : on s'accorda à admirer les travaux qui y avaient été accomplis et la science déployée dans les défenses : on s'applaudit de n'avoir pas eu à forcer les ennemis dans leur dernier retranchement; on ramassa toutes les armes qu'on rencontra et tout le butin qu'on trouva. Le tout fut porté au prince qui restitua à chacun ce qui lui appartenait: il fut tout heureux d'y retrouver son bagage pillé à Vaskès. Tout ce qui resta sans propriétaire, il se l'adjugea.
On rasa toutes les constructions élevées par les babis, on nivela le sol afin de ne laisser aucun vestige de l'héroïque défense de ceux qui étaient morts pour leur foi, s'imaginant ainsi qu'on baîllonnerait l'histoire. Ce fut alors, dit Mirza-Djani, que l'Islam donna au monde un honteux spectacle. Les vainqueurs, si l'on peut leur donner ce titre, voulurent s'offrir les ivresses du triomphe. On couvrit de chaînes Quouddous, Mirza Mohammed Hassan Khan frère du Bab el Bab, Akhound Mulla Mohammed Sadeq Khoraçani, Mirza Mohammed Sadeq Khoraçani, Hadji Mirza Hassan Khoraçani, Cheikh Ni'mêt, Oullah Amoli, Hadji Nacer Qasvini, Molla Youssouf Ardebili, A Séyyèd Abd oul Azim Khohi et quelques autres. On les plaça au milieu du cortège qui se mit en marche au son des tambours et de la musique : et on les frappait chaque fois que l'on passait dans un endroit habité. On exaltait le courage des vainqueurs, on chantait leurs hauts faits: «vraiment on eût dit que la Perse venait de battre le Russe, ou bien qu'on venait de conquérir les Indes ou soumis les Anglais, ou bien qu'on venait de se rendre maître de l'Afghanistan, du Belouchistan, de Balkh, de Bokhara, ou bien qu'on avait repris aux Turkomans les malheureux prisonniers persans qu'ils enlevèrent dans leurs razzias, ou bien enfin, qu'après avoir culbuté le Sultan, on venait d'entrer en conquérant à Baghdad et qu'on réunissait enfin à la couronne du Chah les territoires sacrés de Nedjef et de Kerbélah si longtemps souillés par la domination sunnite.»
Barfourouch fut décorée de fleurs et de tapis, les cris de joie, les feux d'artifice, les spectacles publics firent de l'entrée dans cette ville, de dix misérables qui mouraient de faim depuis trois mois, un événement dépassant les conquêtes de Cyrus.
Après l'arrivée à Barfourouch, Quouddous demanda au prince de l'envoyer à Téhéran afin que le Chah décidât lui-même de son sort : le prince y consentit. Mais Saïd el Ouléma prévenu, s'y opposa. Il vint trouver Mehdi Qouli Mirza, lui remit un cadeau de 1.000 tomans et réclama la livraison, entre ses:mains, du chef babi. «Il est astucieux et éloquent, dit-il au prince, qui sait quelle impression il fera sur l'esprit de Sa Majesté.»
Saïd el Ouléma put enfin donner libre cours à sa lâcheté et à sa haine : on lui amena l'illustre captif, et après l'avoir ignominieusement insulté, il fut pris d'un horrible accès de fureur: se précipitant sur Quouddous il lui coupa les deux oreilles à coups de canif et, l'ivresse du sang lui montant au cerveau, il empoigna une hachette et frappa sur le crâne de son ennemi jusqu'à ce que celui-ci tombât.
On transporta le corps sur la place publique, où un étudiant en théologie lui coupa la tête. Son corps fut haché et les débris jetés dans les fossés de la ville.
La tradition veut qu'une main pieuse ait recueilli ces restes et les ait pieusement ensevelis dans les ruines d'une école.
Là ne se bornèrent pas les scènes de sauvagerie. Si quelques-uns échappèrent à la mort, ayant été vendus comme esclaves, d'autres furent martyrisés. Ceux qui trouvèrent des acquéreurs bienveillants furent Akhound Molla Mohammed Sadèq Khoraçani, Molla Mohammed Mehvélati Dough Abadi, A Séyyèd Azim Khohi, Hadji Nacir Qasvini, Hadji Abdoul Medjid Nichapouri, Mirza Houssein Moutevelli Qoumi. Quatre Babi souffrirent le martyr à Barfourouch. Deux furent envoyés à Amol: parmi ces derniers, Molla Ni'mét Oullah Amoli, l'autre Mirza Mohammed Bagher Khoraçani Qahini, cousin de notre auteur babi.
Qahini demeurait auparavant à Méchhed, dans l'avenue nommée Khiaban Bala, et sa maison, qu'on avait surnommée BABIYEH était le lieu de rendez-vous des sectaires en même temps que la demeure des religionnaires en voyage. C'est là que demeurèrent Quouddous et le Bab el Bab dans leur voyage au Khorassan. Outre sa science religieuse, Qahini était fort adroit de ses mains et c'est à lui qu'étaient dues les fortifications de Cheik Tébercy.
A l'arrivée à Amol, Molla Ni'met Oullah fut torturé avec une implacable férocité. Peut-être ce spectacle porta-t-il la fureur de Qahini à son comble. Toujours est-il que, quand le bourreau s'approcha de lui, Qahini brisa les liens qui l'enveloppaient, sauta sur l'exécuteur, lui arracha son sabre et l'en frappa avec tant de violence que sa tête alla rouler à quinze pas. La foule se précipita sur lui, mais, terrible, il abattit à ses pieds tous ceux qui s'approchaient à portée de son arme. On lut obligé de le tuer de loin à coups de fusil.
Après sa mort, on trouva dans sa poche un morceau de viande de cheval rôtie, souvenir des misères qu'il avait endurées pour sa foi.
Les babis remarquent avec intérêt que quelque temps après, Saïd el Ouléma fut pris d'une maladie étrange
Marré les fourrures dont il s'enveloppait, malgré le feu qui brûlait continuellement dans sa chambre il grelottait de froid, et cependant le feu intérieur qui le dévorait était si intense, que rien ne pouvait calmer sa soif inextinguible. Il mourut, et sa maison qui était fort belle resta abandonnée. Elle tomba en ruines et, petit à petit, on prit l'habitude d'aller jeter les ordures sur l'emplacement où elle s'élevait autrefois.
Ces faits se sont gravés si profondément dans la mémoire des Mazanderanis que, quand ils s'insultent entre eux, ils finissent toujours par se dire : «Que ta maison rencontre le même sort que celle de Said elOuléma.»
Ainsi échoua le plan que les babis avaient formé d'aller; sous prétexte de pèlerinage, se grouper autour de leur chef pour le défendre ou l'enlever.
=====================================
VI. INSURRECTION DE ZENDJAN
Les événements du Mazanderan excitaient au plus haut point l'attention des Persans et la fureur des Mollas. Ces derniers, poussés par le besoin de se défendre, multipliaient les fetvas, condamnant les renégats à mort. A Tauris [Tabriz], dans l'année 1264, Mirza Ahmed Moujtéhed, pour couper le mal dans sa racine, déclara les chéïkhis infidèles et impurs : il considérait, avec beaucoup de raison, selon nous, le babisme comme l'épanouissement de la doctrine de Chéikh Ahmed -Ahçahi et de Seyyéd Kazem Rechti; mais c'était là, en réalité, augmenter le nombre des ennemis de l'Islam à un moment où il était déjà trop vigoureusement attaqué. Une insurrection faillit s'en suivre, voici dans quelles circonstances.
Comme de juste, un objet impur, lorsqu'il est mouillé, communique immédiatement son impureté à ceux qui le touchent, c'est pourquoi il est interdit aux juifs de circuler dans les rues lorsqu'il pleut, et aux chrétiens, en pareil cas, de faire visite, même pour les besoins du service, aux musulmans. Or, un chéïkhi voulut, un jour, après le prononcé du fetva, prendre un bain. Le propriétaire de l'établissement, peu soucieux de voir ainsi souiller ses bains, interdit à ce client l'entrée de son étuve. Une querelle s'en suivit à laquelle la foule se mêla bientôt. La querelle dégénéra en bataille, l'alarme se répandit en ville, et l'on ferma, en prévision d'événements plus graves, les bazars et les boutiques. Heureusement le Prince Malek Cassem Mirza était en ce montent gouverneur de la ville. Grâce à son énergie, aux mesures qu'il sut prendre à temps la sédition fut étouffée, mais on l'avait échappé belle.
Un peu dans toutes les villes des querelles éclataient ainsi, troublant l'ordre, inquiétant les consciences, exaspérant de peur les uns, de colère les autres, tant qu'enfin pour une cause des plus futiles, éclata la grave insurrection de Zendjan. (223)
Parmi les oulémas de la ville se trouvait un personnage nommé Akhouud Molla Abd our Réhim, célèbre par sa dévotion. Il avait un fils, qui se trouvait à Nedjef et à Kerbélah, où il suivait les cours du célèbre Cherifoul Ouléma Mazanderani. Ce jeune homme était d'esprit inquiet et se sentait un peu à l'étroit dans les bornes du chiisme. Quand il revint des lieux saints il passa par Hamadan où les habitants l'accueillirent admirablement et le supplièrent de rester dans leur ville. Il déféra à leurs désirs et y séjourna durant sept années. Mais son père étant venu à mourir, des notabilités de Zendjan vinrent le chercher jusqu'à Hamadan et le reconduisirent dans sa ville natale.
Tous les oulémas de la ville vinrent lui rendre visite et se retirèrent soucieux des quelques paroles qu'il avait prononcées et qui dénotaient une tournure d'esprit peu habituelle. En effet, l'attitude du nouvel arrivé ne tarda pas à démontrer à ces pieux personnages qu'ils ne s'étaient pas trompés dans leurs appréciations.
Il existait un caravansérail, du temps de Chah Abbas, qui s'était peu à peu transformé en sighé Khané : pour ne pas permettre le viol de la loi chiite un certain Molla Doust Mohammed s'était établi là à demeure et bénissait les unions passagères entre les hommes venus du dehors, et les pensionnaires de l'établissement. Houdjet oul Islam - car c'était le titre qu'avait pris notre héros - fit fermer la maison, maria la plupart de ces femmes et envoya les autres en service dans des familles honorables.
Il fit également fouetter un nommé Mourad, marchand de vins, dont il fit détruire la maison.
Mais là ne se bornait pas son action. Toujours préoccupé des problèmes que soulève une religion basée sur des hadis presque toujours contradictoires il troubla la conscience des fidèles par des fetvas singuliers qui renversaient toutes les idées reçues. Ainsi il releva le hadis d'après lequel Mohammed aurait dit : «Le mois de Ramazan est toujours plein». Sans rechercher les origines de cette tradition, sans se préoccuper de savoir si ceux qui l'avaient rapportée étaient dignes de foi, il ordonna de la suivre à la lettre, incitant ainsi ceux qui l'écoutaient à jeûner le jour du Fitr, ce qui est un grave péché.
Il permit aussi de faire les prosternations de la prière en appuyant la tête sur un caillou de cristal.
Toutes ces nouveautés lui attirèrent un grand nombre de partisans qui admirèrent sa science et son activité ; mais elles déplurent au clergé officiel dont la haine, avivée par l'inquiétude, ne connut bientôt plus de bornes.
Ils écrivirent au Chah une adresse calomnieuse contre leur concurrent que le Souverain manda aussitôt à Téhéran.
Celui-ci y vint et, par la politesse de ses manières, par le charme qui s'exhalait de sa personne, ne tarda pas à séduire toutes les personnes qui se trouvaient en contact avec lui, et même Sa Majesté.
On raconte qu'un jour qu'il se trouvait chez le Chah, avec quelques-uns de ses collègues, l'un d'entre eux, ouléma de Cachan, sortit un papier de son sein et le remit au Roi pour le faire signer. Il s'agissait d'un firman accordant des appointements. Houdjet ayant compris se leva et, avec véhémence flétrit un clergé qui se faisait pensionner par le Gouvernement. Il démontra hadis et Qoran en main tout ce qu'avait de honteux un pareil compromis dont les origines remontaient aux Béni Omméyéhs. Ces collègues furent transportés de fureur, mais le Chah auquel plut cette franchise, se tourna vers notre héros, lui remit une canne et une bague et l'autorisa à rentrer Zendjan.
Les gens de Zendjan, en foule vinrent au devant de lui, sacrifiant des boeufs, des moutons et des poules. Douze enfants de douze ans, ayant au cou un mouchoir rouge pour indiquer qu'ils étaient prêts à se sacrifier dans sa route, se tenaient au milieu du cortège. Ce fut une entrée triomphale.
Il fit de ses disciples des modèles de vertu et de tempérance : désormais les hommes se désaltérèrent à la coupe des significations religieuses. Ils jeûnèrent pendant trois mois, prolongeaient les prières en y ajoutant chaque jour celle de Djaafer Tayyar, faisaient une fois par jour leurs ablutions avec l'eau du Qor (mesure légale de pureté), et enfin le vendredi le peuple assiégeait les Mosquées.
Ce fut à ce moment que le bruit de la manifestation du Bab vient rendre toutes les oreilles attentives. Houdjet ne devait pas être le dernier à se préoccuper des nouvelles qui circulaient. Il envoya en effet un de ses confidents, Molla Ahmed, à Chiraz, pour vérifier ce qu'on disait et le tenir au courant des détails d'un événement qui stupéfiait le monde. Quelque temps se passa quand un jour au moment où Houdjet oul Islam donnait son cours à ses nombreux élèves, Molla Ahmed, ou son messager, parut dans l'assemblée. Après avoir salué, et s'être assis, il tira une lettre de son sein et la tendit à son maître. Celui-ci l'ouvrit aussitôt, la lut rapidement, puis se levant, il cria Allah ou Ekber. Il se rassit et recommença sa lecture. Il se leva derechef, prononça les mêmes paroles et, se tournant vers ses disciples il leur dit : «Rechercher une preuve après que l'on est arrivé au but, est chose honteuse. Rechercher la science alors qu'on est en possession de son objet, est chose surérogatoire. Fermez vos lèvres car le Maître s'est levé : apprenez-en la nouvelle. Le soleil qui nous montre la direction est apparu, la nuit de l'erreur et de l ' ignorance est anéantie».
Il demanda alors un Koulah, et, quand on le lui eut apporté, il s'en coiffa en rejetant loin de lui le turban et prononça ces paroles :
Tête nue vaut mieux que tête revêtue du turban des guêbres.
Quelle honte peut-il y avoir pour les amoureux éhontés à n'avoir pas de chapeaux.
Enfin, il se mit à prononcer à haute voix la prière du Vendredi, qui doit remplacer celle de tous les jours quand apparaît l'imam.
Alors il commenta quelques-unes des paroles du Bab et termina ainsi : «Le but que le monde poursuivait est entre nos mains aujourd'hui, sans rideau, sans obstacles. Le soleil de la Vérité s'est levé et les lumières de l'imagination et de l'imitation se sont éteintes. Que vos yeux se fixent sur le Bab, non sur moi qui suis le plus humble de ses esclaves. Ma science auprès de la sienne est comme une chandelle éteinte auprès de l'astre du jour. Connaissez Dieu par Dieu et le soleil par ses rayons. Donc, aujourd'hui est apparu le Sahah èz-zéman, le Sultan des Possibilités est vivant.»
Je laisse à penser si ce discours fit une profonde impression sur son auditoire. Presque tous se laissèrent convaincre et ne disputèrent plus entre eux que de la véritable qualité du Bab,
Désireux de faire connaître son adhésion à son nouveau maître, il envoya Mechedi Iskender à Isfahan avec ordre de remettre diverses lettres à son Altesse le Bab, et de lui rapporter les réponses. Le messager s'acquitta de sa commission, mais au voyage de retour il s'arrêta quelques jours à Casvine. Mal lui en prit, car la populace ayant compris qui il était, le massacra sans pitié.
Ce fut à peu près à ce moment que le Bab fut envoyé à Makou par la route de Casvine, Zendjan, Tébriz.
Arrivé à Soultanièh, à une station de Zendjan, le Bab reçut des lettres de Houdjet dans lesquelles ce dernier demandait la permission de le voir, d'abord, puis de l'enlever à ses gardiens. Le Maitre ne permit ni l'une, ni l'autre de ces deux choses, se bornant à répondre : «Bientôt nous nous verrons dans l'autre monde.»
Le lendemain de ce jour l'apôtre arriva à Zendjan avec Séyyèd Kazem Zendjani, son serviteur; on les conduisit dans le caravanserail de Hadji Seyyèd Mahçoum, qui existe encore. Cette nuit même, sur l'ordre du Chah, Qelitch Khan, le Kurde, chef de la tribu des Vends, avec 17 cavaliers, enleva secrètement Houdjet et se mit en route pour Téhéran pendant qu'on expédiait le Bab sur Tauris [Tabriz].
C'est qu'en effet la conversion de Molla Mohammed Ali et de ses nombreux partisans, avait encore une fois fait perdre patience à l'imam Djoum'éh et au Cheikh oul Islam. Ils écrivirent des lettres furibondes à S. M. qui leur répondit en faisant arrêter le coupable.
A peine arrivé à Téhéran, il fut conduit chez Sa Majesté qui lui dit : «O Houdjet oul Islam ! tu m'as beaucoup plu la première fois que je t'ai vu, je me sentais attiré vers toi et je t'eusse accordé sans hésitation tout ce que tu m'aurais demandé. Mais voilà que tu t'es abîmé toi-même et que tu t'es laissé séduire par un jeune et ignorant Seyyèd de Chiraz. Il ne t'est plus permis de retourner à Zendjan, tu dois rester ici.»
Houdjet se défendit longuement, sans parvenir à persuader son impérial adversaire à qui il promit qu'il ne tenterait pas de s'échapper.
L'historien musulman passe - et pour cause - ces détails sous silence. Il se borne à dire que Molla Mohammed Ali fut retenu à Téhéran où il habita la maison de Mahmoud Khan, le Kalenter.
Quoi qu'il en soit, les deux historiens sont d'accord pour dire qu'il était à Téhéran jusqu'au moment où Mohammed Chah étant mort, Nassr ed dine Mirza, devenu Nassr ed dine Chah, nomma Gouverneur de Zendjan, un de ses oncles, Emir Aslan Khan Medj ed Dowlèh qui était Ichiq Aghassi du Palais.
Pendant que ce personnage allait prendre son poste, Houdjet s'enfuit - déguisé, dit-on, en soldat - avec deux compagnons et se dirigea hâtivement sur Zendjan. Mohammed Bek Tchapar annonça son arrivée et Kerbélahi Véli, parfumeur, parcourut la ville en criant la bonne nouvelle.
Medj ed Dowlèh, gouverneur de la ville, homme cruel et sévère, furieux de voir revenir un personnage aussi importun que Houdjet, fit fouetter Mohammed Bek et couper la langue à Kerbélahi Véli.
L'auteur du Nassiklh-et-tévarikh reconnaît lui-même qu'un bon nombre d'habitants de Zendjan, et parmi eux de hauts fonctionnaires de la ville, vinrent jusqu'à deux stations au-devant du fugitif. Il fut reçu comme un vainqueur, et l'on immola un grand nombre de moutons en son honneur. Personne, dans le camp adverse, n'osa lui demander compte de sa fuite de Téhéran et de son retour là Zendjan. Mais l'Islam en vit de dures, car le Zendjani ne se gêna nullement pour prêcher à tous les échos du bazar la nouvelle doctrine. L'auteur musulman remarque que tous les Zendjani étant des imbéciles donnèrent immédiatement dans le panneau ; mais s'infligeant aussitôt un démenti à lui-même, il déclare que seuls les gueux, envieux des richesses de ce monde et les hommes sans religion se groupèrent autour du nouveau chef. Ils étaient en grand nombre, s'il faut l'en croire, car il les estime à 15.000 personnes, ce qui me semble un peu exagéré.
La situation n'était pas très gaie pour Emir Arslan Khan : il crut bien faire en avisant le pouvoir central et en demandant des instructions ; on les lui donna et fort nettes : il fallait simplement enrayer le mouvement afin qu'il ne prit pas les proportions de l'insurrection du Mazanderan et arrêter le Molla.
C'était bien facile à dire, mais autre chose était de commander et autre chose d'exécuter l'ordre donné; d'autant que Molla Mohammed Ali, évidemment prévenu, ne sortait plus qu'accompagné de plusieurs milliers de personnes toutes armées. Un jour même, il poussa l'audace(224) jusqu'à aller faire visite à l'Emir lui-même ; comme il était fortement accompagné, l'Emir en passa par où il voulut.
Houdjet, bien entendu, continuait ses prédications, et avait interdit aux babi de Zendjan d'aller rejoindre au Mazanderan l'armée de Molla Housseïn Bouchrouyéhi. Il préparait évidement son monde et prenait souvent pour texte de ses sermons ces deux versets du Qoran :
- LXIII-9. - O croyants ! que vos richesses et vos enfants ne vous éloignent pas du souvenir de Dieu !
- LXII-9. - O croyants ! lorsqu'on vous appelle à la prière du jour du Vendredi, empressez-vous de vous occuper de Dieu.
Ce fut à ce moment qu'un incident s'éleva, qui mit le feu aux poudres. Agha Naqd Ali Zendjani raconte ainsi cet événement dont il fut le héros:
«J'avais iti peu près 15 ans à ce moment-là et je prenais des leçons de Molla Abd oul Ali, dans la mosquée même, au premier étage. Une nuit, nous sortions tous deux de la mosquée, nous dirigeant vers nos demeures, quand, au milieu du chemin, un musulman de nos voisins, ivre, nous insulta, et, sortant son couteau, nous barra le chemin. Nous fîmes ce que nous pûmes pour le calmer, mais, comme il nous menaçait toujours, je sortis mon couteau et le lui plongeai dans le ventre. Il s'enfuit en hurlant, mais les témoins de cette scène ameutèrent les gens contre moi. Fort heureusement mon père, attiré par le bruit, vint me délivrer, mais on avait arrêté mon professeur. J'étais depuis un instant chez moi, quand j'entendis des cris retentir dans la maison de Naièb-ous-Sadr, notre voisin. Je montai sur la terrasse pour voir ce qui se passait et, de là haut, je vis l'individu que j'avais blessé étendu comme un mort au milieu de la cour. Saisi de peur, je descendis, j'annonçai à mon frère la mort de ce pauvre diable et lui dis que j'allais m'enfuir jusqu'à ce que se calmât le bruit soulevé autour de cet événement.»
«Je sortis de la maison, me dirigeant vers le Nord de la ville dont je sortis et arrivai à l'imam Zadé Ebrahim. Je m'y reposai quelque temps et vis venir un homme que je se reconnaissais pas, mais qui me reconnut et me dit : «Agha Naqd Ali, les gens de la ville assaillent ta maison et te cherchent,»
«Cela augmenta ma terreur et je m'enfuis jusqu'au village Guirdkendi qui est à environ un farsakh et demi hors de la ville. J'envoyai prendre des nouvelles à Zendjan, et l'on me répondit que le blessé allait mieux.»
«Je restai six jours dans ce village pendant que les ferraches du Gouverneur me recherchaient dans toutes les maisons. On avait pris cents tomans d'amende de mon père, et deux cent tomans comme garantie de ma personne.»
«On avait visité le «birouni» de Molla Mohammed Ali qui avait envoyé trente tomans de cadeau au blessé, par l'intermédiaire de Seyyèd Djélil, père de Seyyèd Achref.»
«Ceci fait, il s'était occupé de Molla Abd oul Ali, mon professeur, injustement arrêté. Il avait écrit au Gouverneur, à ce sujet, une lettre que celui-ci avait refusée. Il envoya alors Mir Djelil, porteur d'une certaine somme. Quand celui-ci se présenta à la porte du palais, les ferraches et les soldats «lui en interdirent l'entrée».
«Fort surpris, Mir Djélil leur demanda de quel droit ils s'opposaient au passage de l'envoyé de Houdjet et ces gens-là lui répondirent par des injures. Djélil tira son poignard et, appelant à l'aide, se précipita sur les soldats. Les babis accoururent aussitôt, on jeta bas la porte de la prison et l'on délivra Molla Abd oul Ali, qu'on ramena en triomphe.»
Il semblait dès lors difficile que les choses pussent s'arranger. Les oulémas accoururent dès le lendemain au conseil du Gouverneur et cherchèrent à le pousser dans la voie de la violence. Péhlevan Aced Oullah et Péhlevan Cheikh Ali, deux athlètes de Lendjan, vinrent demander la permission d'aller arrêter Houdjet au milieu de ses partisans. Certes la proposition fut vivement accueillie mais les oulémas, toujours prudents, firent remarquer que les babis étaient toujours dépourvus d'armes à la prière de midi. Il faudrait donc profiter de cette occasion, envoyer les deux athlètes suivis de 30 ou 40 hommes bien armés et bien déterminés: on pensait que, devant une attaque soudaine, les babis, désarmés, lâcheraient immédiatement pied et que Houdjet, resté seul, serait alors facile à prendre.
Péhlevan Aced Oullah et Péhlevan Cheikh Ali se revêtirent de cottes de mailles et de cuirasses, et le moment venu, se dirigèrent vers la mosquée suivis d'une troupe plus ou moins décidée.
Mais les babis se tenaient sur leurs gardes, se doutant bien que les musulmans chercheraient à se venger. Ils avaient disséminé des sentinelles armées autour de la mosquée.
Celles-ci aperçurent donc les musulmans qui s'approchaient et, Mir Sélah les interpellant d’une voix de stentor, leur cria :«Où allez-vous, péhlevans ?»
Les musulmans, le voyant seul, se raillèrent de lui et lui répondirent: «Nous allons prendre votre Houdjet et le conduire chez les Oulémas.»
Mir Sélah, furieux de l'outrage, poussa son cri de guerre Ya sahab éz zeman, qui attira instantanément des babis autour de lui, et, le sabre haut, il se précipita sur Aced Oullah. Il le frappa de son sabre à la tête, fort heureusement le bouclier amortit son coup, mais le malheureux n'en tomba pas moins par terre la face ensanglantée. Les musulmans s'enfuirent à ce spectacle, et le blessé fut soigné par la propre tante de Mir Sélah, dans sa maison.
Les Persans, en cours de route, rencontrèrent un Babi- Cheikh Ali Bek-dont ils se saisirent. Après lui avoir fait subir maintes tortures, ils le conduisirent en présence du Gouverneur. Là se trouvait l'imam Djoum'èh qui, saisi de fureur à la vue de la misérable victime, sortit le canif qu'il avait dans son écritoire et l'enfonça à plusieurs reprises dans le ventre de Cheikh Ali.
Ce fut la première victime de cette lutte fratricide.
Le Gouverneur et les Oulémas écrivirent à Sa Majesté des rapports où ils laissaient percer leur peur et leur embarras. Le Chah, à peine délivré de la guerre du Mazandéran, furieux de voir une autre sédition sur un nouveau point de son empire, poussé d'ailleurs par son Sadr Aazam et par les oulémas qui avaient déclaré la guerre sainte donna l'ordre de tuer les babis et de piller leurs biens.
Ce fut le vendredi 3 de Recljeb, que 1'ordre arriva à Zendjan. Aussitôt les crieurs publics se répandirent dans les bazars où ils crièrent au peuple :
«O musulmans, ceci est l'ordre des oulémas et de Sa Majesté. Quiconque veut conserver ses biens, ses femmes et sa vie doit se séparer immédiatement des babis et aller résider à l'occident de la ville. Sous deux ou trois jours, les troupes vont arriver qui massacreront tous les infidèles.»
Ce fut un beau tumulte. Les musulmans affolés couraient de tous côtés, cherchant leurs femmes, leurs enfants, telle partie de leur mobilier. Ils allaient et revenaient, fous, éperdus, pleurant ce qu'ils ne pouvaient emporter. On voyait des familles se séparer, des pères repousser leurs fils, des femmes leurs maris, des enfants leurs mères. Des maisons entières restèrent abandonnées tant la hâte était grande, et le Gouverneur envoya dans les villages avoisinants racoler des hommes par force pour la guerre sainte.
Deux régiments qui venaient de l'Azerbaidjan se rendant vers Téhéran, s'arrêtèrent à Zendjan et se préparèrent à la guerre.
Les babis de leur côté, ne restaient pas inactifs : ils s'organisaient et préparaient leur défense. Houdjet les exhortait à ne jamais attaquer, mais à toujours se défendre : «O frères, leur disait-il, n'ayez pas honte de moi. Ne croyez pas que parce que vous êtes les compagnons du Sahab-èz-Zéman vous deviez conquérir le monde à la pointe de votre sabre. Non, j'en jure par Dieu. On vous tuera, on vous brûlera, on enverra vos têtes de villes en villes. La seule victoire qui vous reste consiste à vous sacrifier, vous, vos femmes et votre bien. Dieu a toujours voulu qu’à chaque époque le sang des confesseurs fût l'huile de la lampe de la religion. Vous avez entendu raconter les tourments au milieu desquels sont morts les saints martyrs du Mazandéran. On les a tués parce qu'ils affirmaient que le Mehdi promis était apparu. Je vous le dis, quiconque n'a pas la force de supporter les tourments, s'en aille de l'autre côté, car nous serons martyrisés : notre maître n'est-il pas entre leurs mains ?»
A tous les carrefours, les babis élevèrent des retranchements et ils en construisirent ainsi 31. Les gens chargés de la défense de ses remparts s'élevaient, pour chacun d'eux, au nombre de trois fois dix-neuf. Dix-neuf personnes reçurent l'ordre de s'occuper des approvisionnements. Chaque retranchement avait un cri spécial qu'il n'avait qu'à pousser en cas d'attaque pour qu'on sût immédiatement dans quelle direction envoyer des renforts.
Dix-neuf surveillants généraux furent nominés, chargés de tout examiner chaque jour etde dresser un rapport de tout ce qu'ils voyaient. Ces dix-neuf surveillants reçurent le titre de «Reçouls» car il entrait dans leurs fonctions de crier les nouvelles ou les ordres.
Molla Mohammed Ali nomma Hadji Ahmed Zendjani son lieutenant, fit son confident de Hadji Abd Oullah, le mercier. Hadji Abd Oulla le boulanger fut institué Gouverneur de la place, et Abd oul Baghi, préfet de police avec le surnom de Mir Seyyarèh. Mechedi Souleïman, prévôt des marchands, devint son ministre.
Ce fut à ce moment que le feu fut mis au bazar, il m’a été impossible de savoir par qui. Les musulmans comme les babis, se plaignent vivement d'un acte qu'ils qualifient de criminel, mais un fait est certain c'est que les babis avaient déjà fait toutes leurs provisions et qu'ils ne subirent du fait de cet incendie aucun dommage appréciable.
Toujours est-il qu'il y eut une rencontre entre les deux partis qui coûta la vie à quarante combattants dans les deux camps. Parmi les musulmans tués on cite Aced Oullah, cavalier géorgien de l'Emir, qui succomba à cinq blessures, Aced Oullah, fils de la soeur de Hadji Dadach le négociant, et Seyyed Hassan Chéikh onl Islam Taroumi. Mais les musulmans firent prisonnier un babi renommé pour sa force et son courage et qui portait le nom de Agha Feth Ali Chéikhi. Les Moujtéhèds A Seyyèd Mohammed et Hadji Mirza Aboul Cassem rendirent un arrêt le condamnant à mort : il fut immédiatement exécuté sur l'ordre de l'Emir.
A ce moment se place un incident que je n'ai vu rapporté par aucun auteur musulman. Le chef des troupes impériales aurait été un certain Seyyèd Ali Khan, homme d'un naturel porté à la mansuétude et qui voulut chercher à terminer cette guerre par la douceur. Il se serait rendu au camp des babis, aurait eu avec Houdjet une conférence qui dura cinq heures. A la suite de cette conversation Seyyèd Ali Khan se serait retiré converti et aurait prévenu ses sous-ordres de ne rien tenter contre ses nouveaux amis.
D'où plainte des oulémas et du Gouverneur au Chah qui fit arrêter le Seyyèd et nomma à sa place Mohammed Khan, Emir Touman qui se mit aussitôt en route avec sept régiments. Avant qu'il fut arrivé à destination les babis sous la direction de Mir Sélah et de Mir Djelil (d'autres disent Mirza Riza) s'étaient emparés de la citadelle d'Ali Merdan Khan sise au milieu de la ville. Ils établirent là un dépôt d'armes et de provisions. Ils y mirent garnison et l'occupèrent jusqu'au jour où, après la mort de Molla Mohammed Ali, Hassan Ali Khan, général du contingent de Guerrous s'en empara avec son régiment et en tua les défenseurs.
La prise de la citadelle enorgueillit singulièrement Molla Mohammed Ali qui, ne doutant plus de rien ordonna à Mir Sélah d'aller chercher l'Emir lui-même et de le lui apporter mort ou vif. Donc Mir Sélah et ses hommes attaquèrent la maison où résidait ce personnage. Mais, Mohammed Taghi Khan, Colonel d'artillerie, Ali Qouli Khan fils de Nassr Oullah Khan, Mehdi Khan Khamséï et Beuyuk Khan Poucht Kouhi sortirent tous quatre avec leurs hommes et les ferraches du gouverneur pour repousser les assaillants. La lutte fut vive et ardente mais Abdoullah Bek de Kengaver ayant déchargé son fusil sur Mir Sélah, l'atteignit a la tête et l'étendit raide mort. Les babis consternés retournèrent sur leurs pas, sans avoir réussi dans leur entreprise.
Vingt musulmans furent tués dans cette bataille, parmi lesquels Ali Khan Bek Melayéri et Nour Mohammed, le ferrache.
Les deux partis restèrent immobiles plusieurs jours pendant lesquels les musulmans virent arriver à leur aide : le 20 Redjèb, Sadr ed Dowlèh, petit-fils de Hadji Mohammed Housseïn Khan Isfahani, chef des cavaliers du Khamsèh et venant avec ses hommes de Soultanièh ; le 2 Chahaban, Seyyèd Ali Khan de Firouz Kouh, avec deux cents cavaliers, et Cha baz Khan de Meragha, également avec deux cents cavaliers. Le même jour, arrivèrent Mohammed Ali Khan Chahisoun Afchar avec le même nombre d'hommes et Kazem Khan, chef des troupes afchars. Enfin l'armée de secours se compléta par la venue le 5 Chahaban de Mohaulmed Khan de Khoï, accompagné de 50 artilleurs, de 2 canons de 6 livres et de 2 obusiers.
L'armée royale ainsi renforcée établit des barricades vis-à-vis de celles de Mirza Faradj Oullah et de la forteresse de Véli Mohammed Khan. Enfin, le 20 Chahaban, Mirza Soultan, de l'Arsenal et Abdoullah Soultan firent sauter à la mine les retranchements de Méchédi Péri.
Emir Aslan Khan, Mirza Ebrahim Khan, général du Khamsé, Sadred Dowlèh, Chah'baz Khan, Mohammed Thagi Khan, Seyyèd Ali Khan et d'autres chefs se précipitèrent à l'assaut. La bataille fut opiniâtre et sanglante. Parmi les musulmans, se trouvait un individu nommé Qarétchi - il était de la tribu Qouli, surnommée ainsi par les Turcomans,-qui était allé se poster au haut du deuxième étage de la Mesdjid Djoum’èh, juste en face des maisons habitées par les babis. Là, protégé par le mur percé de meurtrières, son adresse rendait la position intenable aux babi. Nour A1i, fameux tireur babi, vint se poster derrière un mur, en face de ce Qarétchi. Avec un de ses amis, il observa longtemps le tir de son ennemi et finit par comprendre ses mouvements, c'est-à-dire quand et par quelle meurtrière il visait, quand il rechargeait son arme. Alors Nour Ali visa l'une des meurtrières derrière laquelle il savait que se trouvait à ce moment le Qarétchi et tira. Le long silence qui suivit démontra d'éloquente façon que le coup avait porté. Nour Ali tua également Hassan Ali Khan, oncle de Beuyuk Khan Taroumi de Poucht Kouh.
Bien d'autres musulmans succombèrent, mais enfin ils restèrent maîtres du champ de bataille.
Fatigués de cet effort, les deux partis restèrent plusieurs jours sans combattre, se contentant de s'épier mutuellement de derrière leurs barricades.
Les babis avaient vu la mort s'abattre largement sur eux, mais rien, semblait-il, ne pouvait les décourager, et chaque chef tué était immédiatement remplacé par un autre qui effaçait le souvenir de son prédécesseur. Ceux qui se distinguèrent le plus furent :Ali Asker Bi Sahèb, connu comme jardinier de Mir Riza. Il devait son nom de Bi Sahèb à ceci, qu'avant ces événements, il avait tué de ses propres mains et mangé avec ses amis un cerf appartenant au Gouverneur et qui vaguait à travers la ville, causant mille inquiétudes aux négociants. Arrêté pour ce fait, il fut bâtonné avec une rigueur extrême, car à toutes les questions qu'on lui posa touchant ses relations, sa parenté, ses maîtres, il répondit uniformément : «Je suis sans maitre.»
Un autre était Mir Sélah, que nous avons vu à l'oeuvre et qui possédait une voix tonitruante, d'une portée incroyable. On va jusqu'à dire que les éclats de cette voix allaient importuner Medjd ed Dowlèh, qui s'était retiré à Ejdéha déh, à moins d'un farsakh de la ville. Quand il fut tué, il fut remplacé par Ali Asker le cordonnier, qui dépassa encore ses prouesses.
Bakhch Ali, le menuisier, qui mourut en rapportant à son retranchement un drapeau qu'il était allé chercher au milieu des musulmans.
Mais tout cela durait depuis trop longtemps et le Gouvernement s'impatientait. Aussi chargea-t-il Moustapha Khan Kadjar, frère du Kéchiktchi Bachi de prendre avec lui le 16e bataillon Chéqaqi, de rejoindre en toute hâte l'armée et de prévenir les officiers de la terrible responsabilité qu'ils encourraient, s'ils persistaient dans leurs tergiversations et leurs lenteurs.
Moustapha Khan remplit en conscience la mission qui lui avait été confiée et ses paroles énergiques réveillèrent l'ardeur somnolente de ses compagnons d'armes. On résolut de venger les défaites précédentes et la mort de Mirza Feredj Oullah.
On creusa donc une mine sous la principale barricade babie et, la nuit du quinze Ramazan, une heure avant le lever du soleil, toutes les dispositions étant bien arrêtées, on y mit le feu. La barricade sauta et vingt babi furent tués. Alors le bataillon d'Endjerdân commandé par Mehdi Khan, celui d'Eriavi commandé par Abdoullah Khan fils de Souleïman Khan, le 16e bataillon, les cavaliers du Kha.msé se lancèrent à l'assaut. Nazer Ali Khan Erbadi fut tué le premier et 50 impériaux mordirent la Poussière ; les babis se défendirent vaillamment, mais ils durent céder sous le nombre : ils se retirèrent derrière une autre barricade et les impériaux campèrent sur celle qu'ils venaient de conquérir et à laquelle on avait donné le nom de barricade de Feredj Oullah.
Néanmoins ce succès ne répondait pas aux désirs de Téhéran et n'était pas suffisant pour calmer l'impatience du Gouvernement. L'émir Nizam, Mirza Taghi Khan, profondément irrité de ce qu'il appelait des preuves d'incapacité, envoya à Zendjan Mohammed Agha Ghilani, fils de Hadji Youssef Khan, colonel du régiment Nassiriéh, et Cassem Bek, fusilier particulier du Chah ; il les prévint que s'ils n'envoyaient pas à très bref délai à Téhéran, vaincue et enchaînée l'armée de Molla Mohammed Ali, on leur fournirait immédiatement l'occasion de se repentir amèrement de leur incapacité.
Ceux-ci, comprenant ce que parler veut dire, organisèrent, dès leur arrivée, une action qui devait être décisive. Elle eut lieu le 23 Ramazan.
Moustapha Khan Qadjar, avec le 16e régiment Chéqaqi, Sadr el Dowlèh, avec les cavaliers du Khamséh, Seyyèd Ali Khan de Firouz Kouh, avec son propre régiment, Mohammed Agha Ghilani avec le régiment Nasserièh, Mohammed Ali Khan, avec les cavaliers Afchars, Nabi Pek, yaver, avec les cavaliers Mouqaddem, prirent part à la bataille.
Elle dura du matin jusqu'au soir. Les babis subirent de grandes pertes : Bakhch Ali, le menuisier, Khodadad, Fath Oullah Bek, Feradj Oullah Bek y succombèrent.
Bien des musulmans furent tués, mais Molla Mohammed Ali sentant que ses troupes allaient plier, fit incendier le bazar.
Les musulmans coururent en grand nombre - sous prétexte d'éteindre l'incendie, mais peut-être bien pour fuir une si chaude bataille ou tout au moins pour profiter d'une aussi belle occasion de pillage.
Les babis assaillirent avec fureur ceux qui restèrent et les repoussèrent, l'épée dans les reins, hors des barricades qu'ils reconquirent et qu'ils réparèrent. Cette victoire fut heureuse pour les babis, ils avaient, en effet, depuis plusieurs jours, perdu tout contact avec la forteresse d'Ali Merdan Khan où étaient enfermées toutes leurs provisions. Désormais, la place étant déblayée, ils reprirent courage en retrouvant des vivres. Ils y trouvèrent un canon que Hadji Cazem, fabricant de sabres, avait fait pour eux avec du fer. Comme il était fort lourd et sans roues, un certain Seyyèd Ramazan de Bakou, se l'étant fait charger sur les épaules, le porta jusqu'au premier retranchement où il fut fixé. Ils l'essayèrent immédiatement, et, ramassant les boulets ennemis dont leur camp était jonché, ils visèrent un cheval qu'ils tuèrent du coup, à la grande stupéfaction des musulmans.
Le 8 chevval les musulmans virent arriver à leur aide trois mille hommes des régiments des gardes et Chéqaqi avec six canons et deux obusiers, commandés par Mohammed Khan Beglierbéghi, général de brigade (Mir Pendj).
Cassem Khan, neveu de Fazl Ali Khan Qarabaghi, Aslan Khan yaver Karakani, Ali Ekber soultan Khoyi arrivèrent le même jour avec quelques troupes.
Sans laisser à ses hommes un instant de repos, le Berglierbéghi donna, dès son arrivée, l'ordre d'attaquer les babis de deux côtés à la fois.
Cette attaque réussit admirablement et Molla Mohammed Ali ne parvint à éviter une défaite complète qu'à l'aide d'un stratagème.
Il avait fait barrer les rues conduisant à son quartier général, par des barricades placées les unes derrière les autres et séparées par une certaine distance. Pour préserver ses hommes des balles ennemies, il avait fait défoncer les murs intérieurs de toutes les maisons bordant ces rues, de sorte que les babis pouvaient aller et venir sans se soucier le moins du monde des balles musulmanes. Profitant de ces habiles dispositions, il envoya aux défenseurs de la barricade la plus avancée, l'ordre de résister jusqu'au moment où le signal leur serait donné de se replier à travers les maisons sur la seconde barricade.
Dans l'une de ces maisons il fit entasser une partie du butin qu'il avait conquis précédemment, de telle sorte que ces richesses débordassent jusque dans la rue.
Ceci fait, il donna le signal convenu, et les babis de la première barricade se retirèrent.
Les musulmans s'en emparèrent aussitôt, l'escaladèrent, et leurs yeux tombèrent aussitôt sur l'appât qu'on leur avait préparé. N'écoutant que leurs instincts, ils oublièrent les babis et se ruèrent au pillage.
Pendant qu'ils se livraient a cette occupation, les babis revinrent, en firent un horrible massacre et reconquirent les positions d'où ils avaient été chassés.
Décidément les choses tournaient mal pour les musulmans et il semblait qu'on ne pourrait jamais venir à bout d'une pareille résistance.
Au surplus, pourquoi se donner tant de mal, pourquoi risquer inutilement la vie, non des soldats, chair à canon, mais des officiers et des généraux ; pourquoi s'exposer quotidiennement au ridicule et au danger de défaites successives ? n'avait-on pas l'exemple de Cheikh Tebercy? ne pouvait-on user de ruse? ne pouvait-on prêter tous les serments imaginables, quitte à massacrer ensuite les imbéciles qui s'y seraient fiés.
Ces pensées commencèrent à agiter l'âme du Béglierbéghi quand Aziz Khan Mékri, adjudant Bachi, envoyé par le Chah pour aller à Tiflis complimenter le Grand-Duc, héritier de Russie, vint à passer par Zendjan. Il fut absolument de l'avis du Béblierbébhi et fit renvoyer au camp babi quelques sectaires prisonniers qu'il chargea d'une lettre des plus flatteuses pour leur chef.
Mirza Hassan Khan, Vézir Nizam, frère de l'Émir Nizam qui, à ce moment revenait de l'Azerbaïdjan en route pour Téhéran, passa également à Zendjan.
Il complimenta les deux compères de leur diplomatie, multiplia les lettres, les promesses, les flatteries, serments, mais, disent les musulmans, tout fut inutile.
Les babis disent au contraire que les musulmans leur ayant envoyé un Qoran signé d'eux-mêmes avec promesse de leur accorder la vie sauve, on alla prévenir Houdjèt de ce fait. Celui-ci fit remarquer qu'il s'agissait là d'une ruse indigne comme celle que les musulmans avaient employée au Mazandéran, mais que néanmoins ils étaient obligés de faire semblant d'y croire car il leur était impossible sous peine de forfaiture d'avoir l'air de soupçonner de mensonge un serment si solennel. Mais pour ne pas risquer inutilement la vie de braves guerriers il fut décidé d'envoyer en députation des vieillards et des enfants.
C'est ce qui fut fait, et ce furent en effet des enfants et des vieillards qui allèrent reporter le Qoran à l'Emir.
Celui-ci s'étonna de la composition de cette députation et demanda des éclaircissements. «C'est, reprit Mir Salèh, vieillard à la longue barbe blanche, que les nôtres n'ont pas eu grande confiance en tes serments.
«Vraiment, reprit le serdar, vous n'avez pas de honte : vous vous révoltez contre l'autorité légitime de S. M., vous venez ici m'insulter, et vous pensez vous en tirer ?»
«Sans honte sont ceux qui se prétendent les bergers du troupeau de Mohammed, répondit Méchedi Ismaïl Qasvini. Et quand le véritable berger se présente, ceux-là se lancent contre lui en aboyant !»
Serdar furieux fit arrêter tous les vieillards. Il fit couper la barbe à Salèh et le renvoya ainsi ; quant aux autres, il les fit dépouiller de leurs vêtements, les fit enduire de jus de raisin et exposer en plein soleil aux mouches et aux abeilles. Le soir venu, il les fit tuer.
Houdjèt, prévenu de ces événements, rassembla ses fidèles et leur dit : «O mes frères, nous avons fait tout ce qui était humainement possible pour faire reconnaître par ces gens-là le Témoin de Dieu. Nous savons tous que ces fonctionnaires ne sont pas encore arrivés à l'idée de justice et n'ont pas encore compris pourquoi nous versions ainsi notre sang. Or dès aujourd'hui nous devons changer de manière d'être : attaquons au lieu de nous borner à nous défendre et mourons glorieusement pour notre Dieu.»
«Mais la guerre prenant une autre tournure, j'autorise ceux qui se sentent quelqu'hésitation dans le coeur de s'enfuir et à se cacher. Dieu ne leur en voudra pas, car ils ont assez fait pour lui.»
Quelques babis, profitant de cette autorisation, s'enfuirent la nuit venue ; un certain nombre d'entre eux, honteux de ce qu'ils considéraient comme une marque de faiblesse revinrent le lendemain, d'autres furent arrêtés par les gens de Dizedj, remis à Tavakkoul Khan qui vint les livrer à l’Emir, d'autres enfin, plus heureux, disparurent.
Toujours est-il que nos deux voyageurs qui s'étaient arrêtés quelques jours dans l'espérance d'assister à l'exécution des babis, furieux de ne pas avoir la réalisation de leurs désirs, ordonnèrent de reprendre les hostilités.
Mirza Abd Oullahi attaqua la barricade de Molla Bérat, on mina celle que défendait Molla Véli. Le régiment des gardes se lança à l'attaque et le régiment Mouqbéran ainsi que le 16e Chéqaqi vinrent appuyer son action.
Le régiment Mouqbéran s'empara, non sans peine, de la barricade de Molla Véli où il fit prisonnier le fils de Abd ouf Bagher Zendjani qui fut immédiatement mis à mort sur l'ordre d'Aziz Khan.
On ne sait pour quelle raison le 16e Chéqaqi fut à ce moment pris de panique : il lâcha pied, entraînant les autres musulmans dans sa fuite : la bataille était perdue.
Aziz Khan fit arrêter le chef de ce bataillon, Abou Taleb Khan et le fit fouetter avec tant de violence qu'il en pensa mourir. Il ne fut relâché que sur l'intercession de l'Emir Aslan Khan.
Toutes ces nouvelles arrivant à Téhéran excitèrent au plus haut point la colère de S M. Celle-ci estimant que Sadr ed Dowlèh, Seyyèd Ali Khan Firouz Kouhi et Moustapha Khan colonel (sertibe) du 16e Chéqaqi n'avaient pas fait leur devoir, destitua Sadr ed Dowlèh et nomma général des cavaliers du Kamsèh Ferroukh Khan, fils de Yahyah Khan Tébrizi et frère de ce Souleiman Khan que nous verrons par la suite sauver le cadavre du Bab et mourir en chantant au milieu des supplices les plus atroces.
Ferroukh Khan arriva à Zendjan le 4 du mois de Zil Qaadé. La nouvelle de la mort de son père lui parvint le jour même, et il resta trois jours à se consacrer aux cérémonies de deuil. Puis il reprit avec courage les hostilités. I1 fut fortement secondé par Ali Khan, fils de Aziz Khan adjudant bachi colonel du quatrième régiment de Tébriz qui vint le rejoindre avec sa troupe presque en même temps que Haçan Ali Khan (225) général des troupes de Guerrous, venait avec ses soldats. Ces deux officiers furent presque immédiatement rejoints par Mourad Khan Béyât, qui vint avec son régiment de Zérend.
La première mesure qu'ils prirent fut humanitaire ; elle consista, en effet, à dégager de troupes un des côtés du quartier babi de façon à permettre à ceux qui regretteraient de s'être embarqués dans cette histoire de s'enfuir sans être inquiétés. Il est vrai que l'auteur du Nassikh et Tévarikh s'empresse d'ajouter – un babi n'eût pu trouver mieux - que ces officiers craignaient de pousser les réformés au désespoir, et l'on sait qu'un homme poussé au désespoir est terrible.
Enfin, la lutte continua et les babis se servirent très Habilement de la ruse qui leur avait déjà si bien réussi. Ils abandonnaient des richesses dans la rue, et tuaient à coups de fusil les soldats qui venaient les ramasser.
Pendant le feu de la guerre une lettre parvint de Mirza Taghi Khan Emir Nizam à Ferroukh Khan lui disant : «J'ai appris que tu t'es distingué dans cette guerre. J'espère que tu continueras, et quand tu reviendras, je te donnerai une bonne récompense et un rang élevé.»
Ici, j'ouvrirai, avec l'auteur babi, une parenthèse pour expliquer un fait, qui dès qu'il fut comme des musulmans, se propagea de bouche en bouche en prenant à tout instant une tournure de plus en plus libidineuse. L'auteur du Nassikh et Tevarikh raconte en effet que pendant une bataille, une jeune fille, vierge, de 15 à 16 ans fut tuée à la barricade. Je dois reconnaître qu'il se borne à mentionner le fait, sans y insister autrement. La tradition orale est beaucoup moins circonspecte. Or le fait se borne à ceci qu'un vieil élève de Houdjèt vint à mourir laissant deux filles: l'une Zéinèb Khanoum, l'autre Chah Sénèm Khanoum. Zeinéb réclama de Houdjèt le droit de se livrer à la guerre. Celui-ci, après maintes circonlocutions finit par y consentir, et la jeune fille reçut, en même temps que des vêtements d'homme, le titre de Roustem Ali. Un jour que les musulmans attaquèrent le retranchement qu'elle défendait elle se lança à l'encontre de l'ennemi qui avait pris la fuite. Quand ses camarades la rappelèrent, il était trop tard. Les troupes musulmanes tirèrent de tous côtés sur elle, et elle tomba, frappée de multiples blessures.
Nous rendons ici la parole à l'auteur du Nassikh et Tévariklz, qui déclare que la lettre de l'Emir Nizam rendit Ferroukh Khan absolument fou de joie. Ayant été distingué par le second personnage du royaume il se disait qu'il fallait chercher le moyen de fixer cette attention et d'arriver ainsi au plus haut degré de l'échelle sociale.
Il en était là de ses réflexions quand, dans la nuit du 15 Zil Hedjé, il reçut la visite de quelques soi-disant transfuges des babis. C'étaient, dit l'auteur du Nassikh et Tévarikh, Ali Kouli Khan fils de Nassr Oullah Khan Khamséhi et Kerbélahi Chahaban avec quelques autres. Ils venaient faussement proposer à Ferroukh Khan de le conduire par une route sûre, qui était du côté de la porte de Casvine, pour l'amener, avec un certain nombre d'hommes, à la maison de Molla Mohammed Ali Zendjani, qu'il serait facile ainsi d'arrêter. Ferroukh Khan, jeune homme sans expérience, crut à ses promesses et à un avenir brillant. Il prit avec lui cent cavaliers et se mit en route avec Ali Qouli Khan et Kerbélahi Chaaban. Les babis, qui étaient au courant de cette entreprise avaient évacué quelques barricades. La troupe s'engagea dans le dédale des rues quand des quatre côtés à la fois les babis les entourèrent et les accablèrent de coups de fusil. Il ne resta bientôt plus de vivants que Ferroukh Khan, douze cavaliers, et deux individus nommés Ismaïl tous les deux et qui, après avoir été babi, étaient revenus à l'islam.
Ces gens furent faits prisonniers et conduits immédiatement auprès de Houdjèt qui les regarda avec colère, et insulta véhémentement Ferroukh Khan. Il fit allumer un grand feu, y fit rougir des fers et on le brûla en plus de quarante parties du corps en même temps qu'on le tailladait à coups de ciseaux. Quand il fut tué, on coupa sa fête ainsi que celles des deux Ismaïl et on les jeta dans le camp des musulmans.
Voici la version babie de cet événement.
On vint annoncer à Houdjèt que deux babi, respectivement nommés Ismaïl se montraient d'une cruauté répugnante : ils coupaient le nez et les lèvres des soldats musulmans qui leur tombaient entre les mains et les renvoyaient au camp dans cet état. Houdjét les fit chasser du camp babi, disant que la lumière de la foi ne peut rayonner clans les coeurs des gens cruels. Ils partirent donc, mais furieux, résolurent de se venger. Ils s'entendirent avec Ferrouhh Khan pour le mener lui et trente hommes bien armés, par des chemins à eux connus, jusque dans la maison de Houdjet pour le saisir et le tuer.
Ils le conduisirent par un retranchement gardé par des vieillards babi dont ils espéraient avoir facilement raison ; mais le bruit de la lutte attira Nour Ali avec ses hommes qui, après quelques coups de fusils firent prisonniers Ferroukh Khan, les deux Ismaïl et quelques autres.
Il semble que Ferroukh Khan ait été ce soir-là pris de boisson : toujours est-il que la lune resplendissait d'un merveilleux éclat - on était le 15 du mois - et que sa lumière permettait de voir d'assez loin. Au moment où on l'arrêtait une vieille femme sortait de chez elle et reconnaissant l'ennemi juré de sa secte se précipita sur lui en l'insultant et lui plongea un couteau dans le ventre. Ferroukh tomba, frappé à mort. On apporte son cadavre à Houdjèt qui regretta amèrement cet accident.
L'un des deux Ismaïl arrêtés était le neveu (par la soeur) de Nour Ali. Celui-ci était du retranchement qui avait pour cri de ralliement le cri de Soubbouhoun Quouddous. Il s'approcha du transfuge et lui dit : «O fils de ma soeur ! tu t'es détourné de Dieu et tu n'a pas eu honte de toi-même ! Tu t'es fait, contre nous, le guide d'un homme sans religion. Ton châtiment doit être celui du fils de Omar Sa`ad (226).» Et sur ces mots il lui coupa la tête qu'il porta dans son retranchement.
Or il arrivait assez souvent que les soldats de l'armée musulmane venaient vendre a prix d'or quelques provisions aux assiégés. Un jour un soldat, de bonne humeur, vint lancer dans le retranchement de Nour Ali un morceau de viande à moitié pourrie, eu lui criant : «Tiens, il y a longtemps que tu n'en as mangé, régale-toi.»
«Approche-toi, lui cria Nour Ali, que je paye ta viande.» Et comme le soldat tendait le pan de sa tunique, il lui jeta la tête d'Ismaïl en lui disant : «Régale-toi à ton tour 1»
Le soldat s'enfuit, mais les musulmans furent convaincus que les babis se nourrissaient de viande humaine.
La nouvelle du meurtre de Ferroukh Khan émut le Chah au plus haut point. Il envoya aussitôt Baba Bek yaver, avec 2 canons de dix-huit livres et quatre canons de 12 livres. Quand ils furent parvenus à Zendjan toutes les troupes s'entendirent et donnèrent, des quatre côtés à la fois, l'assaut aux retranchements babi. Le régiment de Guerrous s'empara de la forteresse d'Ali Merdan Khan, le 4e bataillon conquit la maison de Agha Aziz qui était proche de celle de Houdjèt. Les autres troupes cherchaient à s'emparer des barricades. La bataille dura toute la journée.
Les guerroussis trouvèrent dans la forteresse toutes les dépouilles que les babis avaient enlevé aux musulmans depuis le commencent de la guerre, et ce fut un pillage indescriptible.
Le bataillon des gardes assaillait le caravansérail de pierre qui, bien fortifié, se défendit longuement. Le capitaine et bien des soldats y furent tués, mais, soutenus par l'espoir, les musulmans ne se laissèrent pas abattre, tant et si bien qu'ils s'en emparèrent enfin et y firent prisonniers 20 babi, qui sur l'ordre d'Aslan Khan furent décapités près de la tour de Zoulfékhar Khan.
La nuit qui suivit ce combat, plusieurs babi s'enfuirent, et parmi eux Nedjef Kouli fils de Hadji Kazem le forgeron qui avait fabriqué le canon de fer, Hayder, l'épicier qui, dit l'auteur musulman, luttait avec avantage contre 50 hommes, Feth Ali, le chasseur, l'Emir Seyyarèh. Ils furent arrêtés et Emir Aslan Khan fit exécuter Feth Ali le chasseur et Nedjef Kouli le forgeron : on emprisonna les autres qui ne furent mis à mort qu'après la victoire finale.
Molla Mohammed Ali se multipliait cependant et soutenait ses hommes de son ardeur et de sa conviction. Mais un jour qu'il combattait avec ses compagnons, Hadji Ahmed, le fabricant de peignes et Hadji Abd Oullah, le boulanger, tombèrent à ses côtés, et lui-même fut atteint grièvement au bras. Ses compagnons le relevèrent et le portèrent dans une maison où ils le soignèrent en secret.
Les babis ne possédaient guère plus de dix retranchements quand le ciel, habile prestidigitateur commença pour eux de nouveaux tours de, passe-passe. Le destin tamisa sur eux la poussière du deuil et du malheur. On annonça l'exécution de leur chef à Tébriz.
D'abord les babis, stupéfaits, ne sûrent que dire ni que faire. Mais bientôt envahis d'une rage froide, ils ne laissèrent plus de repos aux ennemis. Ils se lançaient de tous côtés sur les musulmans et tuaient jusqu'à ce qu'ils fussent tués. Le désespoir inspira des héroïsmes fous, hélas! inutiles, car ce qui devait arriver arriva. Houdjèt mourut.
A Dine Mohammed, le Ministre, prit des hommes sûrs, enterra le Molla dans la chambre même où il était mort et fit égaliser le sol avec le plus grand soin, de façon à ne pas laisser soupçonner l'endroit où avait été déposé le corps. Ensuite on éleva des retranchements autour de la maison et, après y avoir réuni toutes les femmes, les babis, abandonnant les autres retranchements, vinrent s'y réfugier.
Un jeune homme nommé Ali Asker, cordonnier de son état, réunit quelques-uns des sectaires autour de lui et leur tint le langage suivant : «Bon nombre des nôtres ont été tués, et voici que notre heure approche. Ou l'on nous tuera, ou l'on nous prendra vivants. Dans l'un comme dans l'autre cas, nous laisserons nos femmes en butte aux outrages des musulmans. Or il m'est venu l'idée de tuer, cette nuit, toute jeune fille nubile et toute femme jeune et jolie. Nous ne laisserons ainsi que les tout petits enfants auxquels l'ennemi n'osera toucher, et les vieilles femmes que leur fige ou leur laideur met à l'abri des entreprises du vainqueur.» Ce discours étonna fort les babis, et ils le discutaient, quand l'un d'entre eux alla prévenir de ce qui se passait Abdoul Baqi, Mir Riza et Agha Dine Mohammed. Ceux-ci s'empressèrent de faire venir Ali Asker et les quelques partisans qui s'étaient laissés convaincre par ses discours. On les sermonna un peu vivement, et on parvint à leur faire jurer d'abandonner leur idée.
Quelques femmes, au nombre de 42, furent prises de peur, et, cette nuit même, elles s'enfuirent avec leurs enfants jusque hors de la ville, près des jardins de Kerbélahi Allah Verdi. Celui-ci, berger de son état, les recueillit et les cacha dans le souterrain qui lui servait de bergerie. Il les garda ainsi trois jours, mais, pauvre lui-même, il dut les dépouiller de leurs bijoux pour louer des montures et les disperser dans différentes directions.
Le nombre des babis diminuait tous les jours, et, bientôt, il n'y eut plus personne pour défendre leur dernier asile. D'après les musulmans, une transaction serait intervenue. Mirza Riza, Hadji Mohammed Ali, Hadji Ali Chirazi, Soleïman, Diné Mohammed, Hadji Kazem Qaltougi écrivirent à l'Emir et au Béglierbèhi une lettre dans laquelle ils disaient : «Si vous nous pardonnez, nous abandonnerons la guerre et nous viendrons vous rejoindre.» Emir réfléchit que la victoire pourrait lui coûter encore cher, due, d'un autre côté, la loi religieuse condamnant à mort les babis déclarait par cela même qu'aucune convention avec eux n'était valable : il pensa qu'on ne pourrait lui faire aucun reproche s'il usait de traîtrise. Il leur répondit donc dans les termes les plus favorables et les babis sortirent de leur retranchement hâves et exténués.
Aussitôt le serdar, les officiers, les oulémas prirent leurs précautions pour empêcher les soldats de piller la dernière citadelle babie : se réservant à eux-mêmes ce triste droit. On envoya toutes les femmes, dans la maison de Hadji Ghoulam, Ket Khoda de la ville, et celles-ci à peine parties, le pillage commença qui, commandé et mêrne exécuté par des officiers supérieurs fut admirablement conduit. Il ne resta guère que les murs de la demeure. Les soldats durent se contenter de piller les maisons avoisinantes.
Le lendemain, on ordonna aux femmes d'aller à la maison du Moujtéhèd Mirza Aboul Cassem. Kerbélahi Eva, Qoulsoum Khanoum et une autre femme du même nom on raconté que quand elles sortirent de la maison, elles étaient fort nombreuses, chacune portant un paquet ou un enfant. Elles allèrent ainsi jusqu'au Tékié de Mir Kérim Khan au milieu des quolibets des goujats qu'elles rencontraient sur leur route. Arrivées au Tékié, elles se croisèrent avec 3 ou 400 soldats de Guerrous qui ayant appris qui elles étaient, se jetèrent sur elles avec une brutalité inouïe et voulurent les dépouiller de ce qu'elles possédaient encore. Ce fut une scène atroce, mais leurs gardiens, assistés de la population de Zendjan indignée de voir comment on traitait leurs soeurs, leurs femmes ou leurs filles, se précipitèrent sur les guerroussis : la bataille fut ardente et sauvage, et bien des femmes et combien d'enfants trouvèrent la mort dans ce tumulte. Enfin les femmes furent délivrées par leurs concitoyens.
Elles restèrent emprisonnées durant quatre jours dans la maison du Moujtehed, en butte à la curiosité plutôt malveillante du public, en proie à la faim, et des petits enfants moururent faute de lait et de soins. L'un des fils de Houdjet, Mehdi mourut dans ces conditions. Enfin, le 58 jour, quelqu'un vint de la part du Moujtehèd dire aux femmes de se rendre par groupes à l'endéroun, où on recevrait les marques de leur repentir, et d'où elles pourraient aller où bon leur semblerait.
On les y conduisit donc par groupes séparés, et là, elles furent en butte aux insultes et aux violences des femmes du Moujtehèd qui ne se gênèrent, pas pour voler d’elles tout ce qui leur plaisait. Enfin, sorties de cet enfer, les unes retournèrent chez leurs parents, d'autres errèrent sans savoir où aller, jusqu'à ce qu'elles eussent trouvé un refuge quelconque en n'importe quel endroit.
Les prisonniers étaient encore dans la maison du Moujtehèd que les autorités songèrent à retrouver le corps dé Houdjet. Il ne leur suffisait pas d'être vainqueurs, il leur fallait insulter le cadavre de leur ennemi. On songea à interroger les babis, mais, quels que fussent les supplices qu'on leur infligea, ils se refusèrent à parler. Agha Dine Mohammed eut le crâne arrosé d'huile bouillante, mais il se tut. Enfin le serdar fit venir le propre fils du chef défunt, âgé de 7 ans et nommé Agha Housein : par d'habiles menaces et d'insidieuses flatteries, il parvint enfin à le faire parler. Alors on alla violer la sépulture, on trouva le cadavre qu'on sortit de son tombeau, on attacha une corde à son pied et on le traîna à travers les rues et les bazars, témoins muets de sa belle défense. Les hommes crachaient sur le cadavre, lui jetaient des pierres ou des chiens. Enfin on jeta le corps dans un coin des vieilles fortifications et l'on mit deux Karaouls pour le garder. Les uns prétendent qu'il fut dévoré par les bêtes errantes, d'autres qu'il fut enterré pêle-mêle avec les autres cadavres, d'autres enfin que des babis vinrent et l'ensevelirent.
Dés le premier jour, on fit sonner les trompettes pour appeler les troupes sous les armes, comme pour une revue, et les troupes assemblées, on fit venir cent babi qui furent passés au fil de l'épée pendant qu'on soufflait à la bouche d'un canon Hadji Kazem Qeltouki et Mechedi Souleïman.
A ce moment arriva Cassem Bek, fusilier, porteur d'une lettre de S. M. félicitant l'armée de sa belle victoire et du magnifique courage qu'elle avait déployé. Mohammed Khan Beghlérbéghi recevait en même temps la permission de rentrer à Téhéran. Avant de quitter Zendjan, il voulut donner une seconde fête aux habitants de la ville. Il fit venir sur la place soixante-six babi pour être exécutés. Tout était prêt et l'exécution allait commencer quand midi sonna. A ce moment Hadji Mohammed Housseïn, père de Aba Bacir, se mit, du côté des babis, à entonner l'Azzan.
Les soldats du contingent de Hamadân, qu,i devaient procéder à l'exécution, se refusèrent alors à exécuter les ordres qu'ils avaient reçu sous prétexte que les condamnés étant musulmans, il ne leur convenait pas de tuer des frères sans défense. On prit trois krans de chacun d'entre eux, on fit venir le régiment de guerrous auquel on remit cet argent, et celui-ci, sans retard, procéda à l'opération.
Cependant un des officiers fit sortir des rangs babi un individu nommé Agha Nedjef Ali, probablement son parent, qui subit par la suite le martyre à Téhéran.
L'exécution faite, les spectateurs envahirent le champ de mort, quelques-uns pour chercher et enterrer le corps d'un ami, d'autres poussés par une curiosité malsaine. On raconte qu'un musulman nommé Véli Mohammed arriva près du corps d'un de ses voisins nommé Agha Riza, et s'aperçut qu'il n'était pas tout à fait mort. Il l'appela et lui dit : «Si tu as besoin de quelque chose, dis-le moi, je suis ton voisin Véli Mohammed.» L'autre lui fit comprendre qu'il avait soif. Aussitôt notre musulman alla chercher une énorme pierre et, revenant vers le malheureux : «Ouvre la bouche, lui dit-il, je t'apporte de l'eau», et comme celui-ci avait obéi, il lui écrasa la tète.
Enfin le Béglierbéghi se mit en route pour Téhéran emmenant avec lui 44 prisonniers parmi lesquels se trouvaient le fils de Mirza Riza, Hadji Mohammed Ali, Hadji Mohcen le chirurgien. Ces trois individus furent exécutés dès leur arrivée, le reste pourrit en prison.
Mouzaffer ed Dowlèt Zendjani avait été chargé de conduire la famille de Houdjet à Chiraz. En effet, Houdjet avait trois femmes : l'une, Khadidjè fut tuée pendant la guerre; les deux autres, Soultan Khanoum Hamadani et Chah senem Khanoum Zendjani vivaient encore. Il restait aussi quatre filles, deux fils et deux servantes.
Soit parce qu'il était leur concitoyen, soit pour toute autre raison, Mouzaffer ed Dowlèh leur témoigna beaucoup de respect et d'égards et les fit voyager le plus commodément possible dans des Kedjavés.
Quand il fut parvenu à Chiraz, la population sortit pour venir se repaître de la vue des prisonnières. Elle fut stupéfaite en voyant dans quel appareil elles étaient venues. Elle injuria Mozaffer el Moulk, fit jeter bas les Kedjavès, pilla ce qu'il y avait à prendre et fit entrer à pied dans la ville les malheureuses voyageuses.
Nassr ed dine Chah leur fit donner une maison et des appointements.
=====================================
VII. LE BAB A MAKOU - SON EXÉCUTION
C'est le Bab (227) lui-même qui nous indique comment sa vie se passait dans la prison où il était enfermé. Ses plaintes, si fréquentes dans le Béyân, doivent, je pense, être dues à des resserrements de discipline provenant d'ordres venus de temps en temps de Téhéran. Tous les historiens, en effet, tant les babis que les musulmans, nous disent que, malgré les ordres sévères d'empêcher toutes communications du prisonnier avec le monde extérieur, le Bab recevait une foule de disciples et d'étrangers dans sa prison.
Quoi qu'il en soit - car les documents manquent absolument sur cette période - le lecteur jugera par lui-même, s'il veut bien jeter un coup d'oeil sur les passages du Béyân que j'ai réunis ici.
«Oh ! quel est ton aveuglement, ô ma créature ! Ce que tu fais, tu le fais pensant me (228) contenter ! Et malgré ces versets qui me prouvent moi-même, ces versets qui découlent de ma puissance et dont le trésor est l'être même de ce personnage (le Bab), malgré ces versets qui ne sortent de sa bouche qu'avec ma permission, voilà que, sans aucune espèce de droit, vous l'avez mis au sommet d'une montagne dont les habitants ne sont même pas dignes qu'on les cite. Près de lui, ce qui est près de Moi, il n'y a personne, si ce n'est une des Lettres de la Vie de mon livre. Entre ses deux mains, qui sont Mes deux mains, il n'y a même pas un serviteur, pour allumer, la nuit, la lampe. Et voilà que les hommes qui sont sur terre n'ont été créés que pour son existence : c'est par sa bienveillance qu'ils sont dans la joie, et ils ne lui donnent même pas une lumière !» II unité - porte 1.
«Le fruit (de la religion islamique) c'est de croire à la manifestation (du Bab) et on l’emprisonne à Makou !» IIe unité - porte 7.
«Tout ce qui appartient à l'homme du Paradis est en Paradis. Cette chambre solitaire (dans laquelle je suis) et qui n'a même pas de porte est aujourd'hui le plus grand des jardins du Paradis, car l'arbre de la Vérité y est planté. Tous les atomes qui la composent crient : En vérité, il n'y a pas d'autre» dieu que Dieu ! En vérité, je suis Dieu, et il n'y a pas d'autre dieu que moi le Seigneur de l'Univers!» II unité - porte 16.
«Le fruit de cette porte est que les hommes voyant qu'il est permis de faire tout cela pour le Béyân (dépenser tant d'argent) qui n'est que la trace de Celui que Dieu doit manifester, doivent se rendre compte de ce qu'il faut faire pour Celui que Dieu doit manifester quand il apparaîtra, afin qu'il ne (lui) arrive pas ce qui (m') arrive aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a de par le monde beaucoup de Qorans valant mille tomans, alors que Celui qui fait descendre des versets (le Bab) est mis sur une montagne, dans une chambre construite en briques séchées au soleil. Et cependant cette chambre est l'Arche (9e ciel, séjour de la Divinité) même. Que cela serve d'exemple aux Béyânis afin qu'ils ne fassent pas envers Lui, ce que les Qoranis ont fait vis-à-vis de moi.» Unité III porte 19.
Dans la IXe Unité porte II il fait remarquer qu'on avait le plus grand respect pour-lui quand il était simplement Seyyèd, et que c'est à partir du moment où il s'est manifesté comme envoyé de Dieu qu'on a commencé à l'accabler d'injures et de mépris.
Dans la VIe unité, porte 8, il reproche encore aux musulmans d'avoir attendu avec impatience le Mehdi, pour l'emprisonner aussitôt qu'il a paru.
C'est toujours dans le même ordre d'idées qu'une fois enfermé à Makou, il adresse une longue lettre au Chah (Mohammed Chah) que nous allons analyser ici.
Le document commence, comme presque tous les documents littéraires du Bab par une louange exaltée de l'Unité Divine. Le Bab continue en louant, comme il convient, Mohammed et les douze imams, qui, comme on le verra dans le second volume de cet ouvrage, sont les pierres angulaires de l’édifice du Béyân. «Et moi j'affirme, s'écrie-t-il, que tout ce qui est dans ce monde de possibilités autre qu'eux n'est auprès d'eux que le néant absolu, et si on peut le mentionner, ce tout, ce n'est que comme l'ombre d'une ombre. Je demande pardon à Dieu de ces limites que je viens de leur assigner, car en vérité le dernier degré des louanges qu'on en peut faire, est de reconnaître en face d'eux, qu'on ne peut les louer….. C'est pourquoi Dieu m'a créé d'une boue n telle que personne n'a été créé d'une boue pareille. Et Dieu m'a donné ce que les savants dans leur science ne peuvent comprendre, ce que personne ne peut connaître à moins d'être complètement anéanti en face d'un signe d'entre mes signes...
«Sache, qu'en vérité, je suis une colonne de la première parole : cette parole que quiconque l'a connue a connu Dieu tout entier et est entré dans le bien universel. Celui qui n'a pas voulu la connaître est resté ignorant de Dieu et est entré dans le mal universel. J'en jure par ton Dieu, le Maître des deux mondes, celui qui vit ici-bas aussi longtemps que le permet la nature, et reste toute sa vie l'esclave de Dieu dans toutes les oeuvres de bien qu'embrasse la science de Dieu, s'il a dans son coeur de l'inimitié contre moi, fût-ce si peu que -Dieu seul le pusse comprendre, alors toutes ses bonnes oeuvres et toute sa piété sont sans utilité et Dieu ne le regarde que d'un regard de châtiment, et celui-là est de ceux qui meurent. Dieu a fixé tout le bien que lui-même reconnaît comme bien dans l'oeuvre de m'obéir, et tout le mal qu'il connaît dans l'acte de me désobéir. En vérité, aujourd'hui je vois, dans le rang que je tiens, tout ce que je viens de dire et les gens de mon amour et de mon obéissance dans les plus hautes demeures des cieux, tandis que mes ennemis sont plongés dans les profondeurs du feu !»
«Sur mon existence, je le jure, si je n'avais pas été obligé d'accepter d'être le houdjet de Dieu, je ne t'eusse pas averti...»
Comme on le voit, le Bab continue ici très nettement et renouvelle ses affirmations du Kétab béïn el Harémein. Il n'y ajoute rien, mais n'en retranche rien non plus.
«Moi donc, dit-il, je suis ce Point d'où tout ce qui existe a trouvé l'existence. Je suis cette face de Dieu qui ne meurt pas, je suis cette Lumière qui ne s'éteint pas. Celui qui me connaît est accompagné de tout le bien, celui qui me repousse a derrière lui tout le mal.»
«En vérité> Moïse, quand il demanda à Dieu ce qu'il demanda (il voulut voir Dieu) Dieu rayonna
sur la montagne, de la lumière d'un des sectateurs d'Ali, et, comme l'explique le hadis «cette lumière j'en jure par Dieu, était ma lumière.» Ne vois-tu pas que la valeur numérale des lettres qui
composent mon nom est égale à la valeur numérale de celles qui composent le mot Rebb (Seigneur). Or Dieu n'a-t-il pas dit dans le Qoran : Et quand ton Rebb rayonna sur la montagne.»
Le Bab continue en étudiant les prophéties faites dans le Qoran puis dans quelques hadis au sujet de la manifestation du Mehdi. Il rapporte le fameux hadis de Moufazzal qui est l'un des arguments les plus forts pour la vérité de sa mission.
Dans le Qoran il est dit Chap. XXXII verset 4: Dieu conduit les affairer, (du monde) du ciel à la terre puis (tout) remonte à lui dans un jour dont la durée est de mille années de notre comput.
D'autre part le dernier imam a disparu en l'an 260 de l'Hégire, c'est à ce moment que la manifestation prophétique est terminée et que «la porte de la science est fermée.»
Or Moufazzal interrogea l'imam ous Sadeq sur les signes de l'arrivée du Mehdi, et l'imam lui répondit : «Il se manifestera en l'année soixante et son nom sera élevé.» Ce qui veut dire en l'année 1260 qui est précisément l'année de la manifestation du Bab.
«J'en jure par Dieu, dit à ce sujet Seyyèd Ali Mohammed, je n'ai pas pris de leçons et mon éducation a été celle d'un marchand. En l'année 60 j'ai eu le coeur rempli de versets solides de sciences certaines et du témoignage de Dieu. Et j'ai proclamé ma mission en cette année même…
«Et cette année même je vous ai envoyé un messager (Molla Housseïn Bouchrouyéhi)» porteur d'un Livre afin que le Gouvernement put faire ce qu'il avait à faire vis-à-vis de l'houdjet. Mais la volonté de Dieu étant que s'élevassent des guerres civiles qui assourdissent les oreilles, aveuglassent les yeux, et rendissent les coeurs endurcis, c'est pour cette raison qu'on n'a pas laissé mon messager parvenir jusqu'à vous. Ceux qui se considèrent comme patriotes s'y opposèrent et jusqu'à aujourd'hui - quatre ans presque ont passé - sans que personne vous ait rien dit de la vérité de la question.»
«Et maintenant, comme mon temps est proche, comme mon oeuvre est oeuuvre divine et non pas humaine, c'est pourquoi je vous en ai écrit brièvement.»
«J'en jure par Dieu ! si tu savais ce qui pendant ces quatre ans m'est advenu de tes fonctionnaires et de tes délégués ! Si tu le savais, la peur de Dieu t'empêcherait d'achever le souffle qui s'exhale en ce moment de tes lèvres, à moins que tu ne formes le dessein d'entrer dans l'obéissance de l'ordre du Houdjet, et de réparer immédiatement ce qui a eu lieu.»
«J'étais à Chiraz, et de ce gouverneur mauvais et maudit, je subis des tyrannies telles que si tu en connaissais la moindre part, de par ta justice tu exercerais sur lui la peine du talion, car sa violence a attiré la punition du ciel jusqu'au jour du jugement sur l'étendue de l'Empire. Cet homme très orgueilleux et toujours ivre ne donnait aucun ordre empreint d'intelligence. Je fus forcé de sortir de Chiraz et je me dirigeai vers Téhéran pour aller te voir, mais feu Men'témed ed Dowlèh comprit la vérité de ma mission et fit ce qu'exigeait la déférence vis-à-vis des élus du Seigneur.»
«Des ignorants de la ville commencèrent une émeute, et c'est pourquoi je me cachai dans le palais Sadr jusqu'au moment où Meu'témed mourut. Que Dieu le récompense ! Il n'y a pas de doute que la cause de son salut du feu de l'enfer soit ce qu'il a fait pour moi.»
«Ensuite Gourguine me fit durant sept nuits voyager avec cinq individus, sans rien de ce qui est nécessaire au voyage et avec mille mensonges et mille violences. Hélas ! Hélas ! sur ce qui m'est arrivé ! Enfin le Sultan ordonna de me diriger sur Makou, sans même me donner une monture que je pusse monter ! Hélas ! Hélas ! il m'est arrivé ce qui m'est arrivé ! Enfin je parvins à ce village dont tous les habitants sont ignorants et grossiers. Ah ! j'en jure par Dieu, si tu savais en quel lieu je demeure, le premier qui aurait pitié de moi, ce serait toi-même ! C'est un fortin, au sommet d'une montagne, et c'est à ta bienveillance que je dois une pareille demeure I Ceux qui y habitent sont deux hommes et quatre chiens ! Pense à quoi je passe mon temps !»
«Je remercie Dieu, comme il doit être remercié, et je jure par Dieu que celui qui m'a emprisonné là est content de ce qu'il a fait. Et cependant, s'il savait avec qui il a agi ainsi, jamais plus il ne serait heureux.»
«Et maintenant, je t'avise d'un secret : cet homme a emprisonné (en ma personne) tous les prophètes, tous les saints et celui que la science de Dieu a embrassé. Et il n'est resté de péché d'aucun genre sous lequel je n'ai gémi»
«Quand j'eus appris l'ordre que tu avais donné (de me conduire à Makou) j'ai écrit au Sadr A'azam: tue-moi et envoie ma tête où tu voudras, car vivre sans péché et aller où sont les pécheurs ne peut me convenir. «Il ne me répondit rien : et je suis convaincu qu'il ne connaissait pas la vérité de la question, car attrister sans raison les coeurs des croyants et des croyantes est pire que de détruire la maison de Dieu.»
«Or, j'en jure par Dieu, c'est moi aujourd'hui la vraie maison de Dieu. Tout le bien s'attache à ceci que quelqu'un me fasse du bien, car c'est alors comme s'il faisait du bien à Dieu, à ses anges, à ses amis. Mais peut-être Dieu et ses amis sont trop élevés pour qu'arrive jusqu'à la poussière de leur seuil le bien ou le mal de quelqu'un; mais ce qui arrive à Dieu m'arrive à moi. J'en jure par Dieu, celui qui m'a emprisonné s'est emprisonné lui-même, et il ne m'arrive que ce que Dieu a ordonné. Alors hélas ! hélas sur celui dont la main laisse échapper le mal, bien heureux celui qui prodigue le bien.»
Enfin, et pour résumer cette trop longue missive : «L'autre question est affaire de ce bas monde. Feu Meu'témed, une nuit, fit retirer tous les assistants et même Hadji Molla Ahmed, puis il me dit : «Je sais fort bien que tout ce que j'ai acquis, je l'ai acquis par la violence, et cela appartient au Sahab ez-Zéman. Je te le donne donc en entier, car tues le Maître de la Vérité et, je te demande la permission d'en devenir possesseur. «Il retira même une bague qu'il avait au doigt, et me la donna. Je pris la bague et la lui rendis et l'envoyai en possession de tout son bien. Dieu est témoin de ce que je dis là, et son témoignage suffit.» «Je ne veux pas un dinar de ces biens, ajoute le Bab, mais c'est à vous à ordonner comme bon vous semblera.» Mais comme pour toute contestation Dieu a demandé lui-même le témoignage de deux témoins, au milieu de tous les savants, faites venir A Seyyèd Yahya et Akhound Molla Abdoul Khaleq. Ils vous montreront et vous expliqueront mes versets et de cet entretien ne subsistera qu'une seule chose, c'est la perfection de mon témoignage.»
«De ces deux personnages, l'un m'a connu avant la manifestation, l'autre après ; tous deux me connaissent fort bien, et c'est pourquoi je les ai choisis.»
Et la lettre se termine par des preuves cabalistiques et des hadis.
Ainsi donc le Bab se déplaisait vivement dans sa prison et il y resta relativement longtemps puisqu'en somme le document que nous venons de citer est de 1264 et l'exécution du martyr n'eut lieu que le 27 Chahaban de l'an 1266 .(8_luillet 1850).
Mais l'exécution fut précédée d'un changement de prison : on lui fit, en effet, quitter Makou pour Tchéhériq. Mirza Taghi Khan, Emir Nizam qui était alors premier ministre, voyant que la révolution babie se dessinait de plus en plus et prenait une formidable apparence s'avisa que le meilleur moyen d'apaiser toutes ces révoltes serait de supprimer celui qu'il considérait comme le chef de tous ces mouvements, c'est-à-dire le Bab lui-même.
Il en référa au Chah qui crut devoir lui faire remarquer que tous ces ennuis étaient dus à Hadji Mirza Aghaci, l'ancien Sadr A'azam de son père, qui ordonna l'emprisonnement du Réformateur à Makou sans l'avoir fait venir à Téhéran où on l'aurait soumis à une enquête. «Aussi le vulgaire a-t-il cru qu'il y avait en lui une science ou un miracle quelconque. Si on l'avait laissé venir à Téhéran et y discuter publiquement, on se serait vite aperçu qu'il n'y avait rien en lui.»
Ces réflexions judicieuses attirèrent une réponse digne d'admiration: «Les paroles des Rois, sont les Rois des Paroles», fit observer le premier vizir d'un ton convaincu «ce qui n'empêche pas, ajouta-t-il, que nous n'avons plus aujourd'hui d'autre moyen que de le tuer.»
Je ne sais si la conversation dura longtemps sur ce ton, toujours est-il que Soleïman Khan Afchar fut envoyé à Tauris [Tabriz] pour y procéder à l'exécution.
Quand Soleïman Khan fut arrivé à destination, Hamzé Mirza lchmèt ed Dowlèh - qui était alors gouverneur de l'Azerbaïdjan - ordonna de faire venir le Bab de Tchéhériq. On fit amener en même temps ses disciples qui le suivaient partout, c'est-à-dire A Séyyèd Housseïn et Molla Mohammed Yezdi.
On invita alors les oulémas à une grande conférence, mais ceux-ci s'y refusèrent, déclarant que les idées de l'accusé étaient hérésiarques et que, par cela même il méritait la mort.
Ichmèt ed Dowlèh, voyant le dégoût -je traduis en ce moment un auteur musulman- des oulémas, fit venir de nuit le Bab qui se sont rencontré, dans une réunion préparée à cet effet, avec Mirza Hassan Khan Vézir Nizam et Hadji Mirza Ali. Ceux-ci l'auraient interrogé sur l'explication d'un hadis difficile et le Réformateur serait - ce qui est invraisemblable - resté coi. Alors Ichmet ed Dowlèh, prenant la parole, lui demanda de faire descendre des versets au sujet des flambeaux de cristal : le Bab obéit, mais on écrivit ce qu'il répondit. Quelques instants après, invité à répéter une seconde fois les mêmes versets, il ne put le faire. Dès lors, il était jugé, et il fut condamné a mort.
Cependant on voulut que l'exécution fut publique, car on pensait que si elle avait lieu secrètement, rien ne pourrait empêcher le peuple de croire à une ascension miraculeuse au ciel. On décida donc que le Bab serait promené à travers les rues de la ville et exécuté sur la grande place - qui, chose étrange, porte à Tauris [Tabriz] le nom de Place du Sabab-èz Zéman.
On prit donc le Séyyèd avec Molla Mohammed Ali Yezdi et Seyyèd Housseïn : on les conduisit chez Hadji Mirza Bagher Imam Djoum'èh de la ville, chez Molla Mohammed Mamaqani et chez A Seyyèd Ali Zénouzi. Ceux-ci délivrèrent un fetva ordonnant l'exécution.
Dès lors commença la promenade douloureuse à travers les bazars, au cours de laquelle A Seyyèd Housseïn - chargé par son Maitre de l'exécution die ses dernières volontés se rétracta, renia le Bab, et sur l'ordre des bourreaux lui cracha à la face.
Il accomplit la mission qui lui avait été confiée et fut, un peu plus tard, exécuté à Téhéran.
Arrivé sur la place fatale, on fit en vain tous les efforts pour détacher Molla Mohammed Ali de ses convictions ; on fit venir sa femme et ses petits enfants : il refusa obstinément de les écouter, se bornant à demander comme dernière grâce d'être tué avant son maître.
C'est alors que se passa un fait étrange, unique dans les annales de l'humanité. Les deux compagnons solidement attachés virent se placer devant eux le régiment chrétien des Bahadourans. A un signal donné par leur chef les soldats tirèrent. On vit alors, on vit Molla Mohammed Ali couvert de blessures, mourir en se tournant vers son maître, et ses paroles, vinrent épouvanter les assistants: «Maître, disait-il, maître, es tu content de moi ?»
Les balles étaient venues couper les cordes qui retenaient le Bab, celui-ci retomba sur ses pieds, sans une égratignure. «Ah !si à ce moment il avait découvert sa poitrine» dit l'historien des Moutanabyins, et s'il se fut mis à crier : O soldats, o hommes, vous êtes vous-mêmes témoins de ce miracle que sur 1000 balles pas une seule n'a pu m'atteindre, et quelques unes sont venues couper mes liens, tous se fussent en hurlant, précipité à ses pieds.» Mais, continue notre auteur, Dieu voulut faire connaître la vérité : c'est pourquoi il le fit fuir.
Je ne suis, et ne puis être, en ce qui concerne ces derniers mots de l'avis d'Ethézad ès Saltaneh : les chrétiens sont en effet convaincus que si Jésus-Christ avait voulu descendre vivant de la croix, il l'eût fait sans difficulté : il est mort volontairement, parce qu'il devait mourir et pour accomplir les prophéties. Il en est de même pour le Bab, disent les babis, qui voulut donner aussi une sanction évidente à ses paroles. Lui aussi mourut volontairement, parce que sa mort devait sauver l'humanité.
Qui dira jamais les paroles que le Bab put prononcer au milieu du tumulte sans nom qui accueillit son départ: qui saura quels souvenirs agitaient sa belle âme, qui nous dira jamais le secret de cette mort.
Quoiqu'il en soit, les soldats le reprirent, l'attachèrent de nouveau au poteau infâme, et cette fois Seyyèd Ali Mohammed rendit son âme à Dieu.
Ce fut le lundi 27 chahaban qu'eut lieu cet événement.
=====================================
VIII. LE CADAVRE DU BAB
M. de Gobineau. d'accord en cela avec les auteurs du Nacikh-et-tevarikh, du Roouzet-ès-Séfa, du Mirhat el Bouldan, en un mot avec tous les historiens officiels, rapporte qu'après l'exécution, le cadavre du Bab fut jeté dans les fossés de la ville et dévoré par les chiens.
En réalité il n'en a pas été ainsi, et nous allons voir pourquoi ce bruit a été répandu tant par les autorités de Tauris [Tabriz] peu soucieuses de s'attirer les réprimandes du gouvernement pour une complaisance chèrement vendue, que par les babis désireux de prévenir ainsi les recherches de la police.
Les témoignages les plus sûrs des spectateurs même du drame ou de ses acteurs ne me laissent aucun doute que le corps de Seyyéd Ali Mohammed n'ait été recueilli par des mains pieuses et n'ait enfin, après les péripéties que je vais raconter, reçu une sépulture digne de lui,
Quand l'exécution fut terminée, les troupes se retirèrent, la foule s'écoula et les corps furent confiés aux soldats de garde. M. de Gobineau veut, avec quelques autres auteurs, que le cadavre ait été promené durant trois jours à travers les rues de la ville. Malgré que ce fait, soit en général nié par la tradition, je l'accepte comme vrai parce qu'il est vraisemblable. Mais de deux choses l'une où la nuit venue on laissait le corps où il était, seul et abandonné, ou on le faisait garder par les soldats. Dans le premier cas il est de toute impossibilité que les nombreux babi qui se trouvaient dans la ville eussent hésité un seul instant à aller dérober le cadavre que personne ne veillait. Ils ont donné trop de preuves de leur courage, de leur conviction et de leur enthousiasme pour admettre, même une seconde, qu'ils aient abandonné ainsi sur la voie publique le corps de celui qu'ils considéraient comme leur Dieu et qu'il leur était si facile de recueillir.
Mais, si les historiens officiels ont raison, si le cadavre, le troisième jour a été jeté dans les fossés de la ville pour devenir la proie des animaux errants, il est bien clair qu'à partir de ce moment il n'a plus été gardé et les sectaires pouvaient facilement se l'approprier.
Enfin, en dernier lieu, même gardé nuitamment, l'enlèvement était relativement aisé. On a pu voir au cours de cette histoire ce que sont les sentinelles persanes: leurs fonctions consistent essentiellement à dormir auprès du dépôt qu'ils sont sensés garder. Si l'on ajoute que les arguments sonnants et trébuchants ne laissent en Perse que bien peu de personnes insensibles, on se rendra aisément compte que les babis pouvaient facilement trouver la route qui conduisait au fond du coeur de ces pauvres diables de soldats toujours si mal payés. Enfin le courage n'étant pas surtout en cette circonstance, la marque dominante des ennemis du Babisme, si l'on veut bien admettre que la garde se composait de deux ou trois soldats, ceux-ci eussent très probablement fui à une première attaque sérieuse.
C'est ce à quoi les babis se résolurent d'abord. Les chefs, réunis chez Souleïman Khan de Saïn Qal'éh afin d'aviser aux mesures à prendre pour soustraire le corps du martyr aux insultes et, aux brutalités des infidèles décidèrent de mobiliser leurs hommes, de se rendre en troupes sur le lieu où gisait le Bab, de livrer au besoin bataille mais de dérober coûte que coûte la précieuse relique. Souleïman Khan, homme considérable, chef d'une grande famille était lié d'amitié avec le Kalenter de Tauris [Tabriz]. Il pria ses coreligionnaires de lui permettre d'aviser ce fonctionnaire de la décision qui venait d'être prise et de lui faire connaître qu'il valait mieux faire lui-même la remise du corps plutôt que de risquer de déchaîner en ville la guerre civile. Le Kalenter, frappé -de l'imminence du péril, et de la somme qui lui était offerte, remercia Souleïman Khan de son message, le pria de dire à ses compagnons de ne pas bouger et d'attendre qu'il leur envoyât lui-même le cadavre du Bab qu'il ferait enlever par ses gens. Mais les babis lui répondirent qu'ils ne permettraient pas aux assassins de souiller de leur attouchement le corps de l'auguste victime.
Le Kalenter consentit donc à ce que quelques babis, se rendissent sur le lieu de l'exécution pour enlever le cadavre et il leur adjoignit quelques-uns de ses hommes pour imposer silence aux soldats de garde, qui, recevant le prix convenu consentirent facilement à se taire.
Tout le monde ainsi satisfait, on convint de dire que le Bab avait été dévoré par les bêtes errantes : la chose pouvait facilement être crue, car elle était vraisemblable et ainsi la combinaison offrait l'immense avantage de maintenir la paix dans une cité essentiellement turbulente, d'enrichir les acteurs de la comédie, de les dégager de toute responsabilité et de fermer d'un autre côté les yeux de l'autorité.
Les deux cadavres furent donc relevés, celui de Mohammed Ali Zendjani fut enterré et celui du Bab enseveli dans une caisse et caché dans une maison.
Je dois ici ouvrir une parenthèse, afin de rapporter, ce que m’a raconté Soubh i Ezel, durant mon séjour à Chypre
«Avant sa mort le Bab m'ordonna dans un de ses versets d'enfermer son cadavre dans un cercueil de diamants, si Dieu le permettait, et de l'enterrer en face de Chah Abdoul Azim. Il décrivait l'endroit de la sépulture de telle sorte que seul je pouvais comprendre ce qu'il voulait dire.»
«Il mourut ainsi que Mohammed Ali Zendjani. Les exécuteurs jetèrent pêle-mêle les uns sur les autres les membres des deux martyrs de telle sorte qu'il devint impossible de les différencier.»
«Je les mis tous deux dans un cercueil de cristal, ne pouvant en faire en diamants et le fis enterrer à l'endroit même que le Prophète m'avait indiqué. Le lieu de la sépulture resta trente ans secret. Les Behahis surtout l'ignoraient complètement, mais un traître la leur révéla. Ces blasphémateurs déterrèrent le cadavre et l'anéantirent. S'ils ne l'ont pas anéanti, et s'ils indiquent une nouvelle sépulture contenant réellement le cercueil de cristal et le corps du Prophète qu'ils ont dérobés, nous ne pourrions nous résoudre à considérer ce nouveau tombeau comme sacré car il n'est pas au lieu indiqué par le Bab (229).»
Cette version que j'ai rapportée aux Behahis de Téhéran a eu le don de les exaspérer et de leur faire renouveler leurs anathèmes contre le solitaire de Chypre.
Voici donc comment les choses se seraient passées.
Nous avons dit que le cadavre du Bab fut caché dans une des maisons de Tauris [Tabriz]. C'était celle de Souleïman Khan lui-même. Celui-ci prévint Béha Oullah de ce qui s'était passé et lui demanda ses instructions. Béha, conformément à l'ordre qu'il en avait reçu dans le testament du Bab ordonna le transport de cette caisse à Téhéran.
Elle fut ainsi portée jusqu'à l'imam Zadé Mahsoum - devenu depuis le cimetière favori des babis - en dehors de la porte dite de Casvine parce que c'est là qu'aboutit la route qui conduit de cette ville à la capitale. Elle fut placée dans une niche que l'on mura avec des briques. Les choses restèrent ainsi fort longtemps quand, il y a 29 ans, Mirza Housseïn Ali Beha, étant encore à Andrinople, donna l'ordre à Hadji Ali Ekber Chahmirzadèh et à A Djemal de l'enlever de l'endroit où elle était pour la transporter ailleurs. Ceux-ci obéirent sans comprendre pourquoi on leur ordonnait ce changement : mais ils le comprirent quand quelque temps plus tard l'imam Zadé qui menaçait ruine fut démoli pour être reconstruit à nouveau. Sa démolition - si Beha n'eût pas pris cette précaution - eut mis la caisse à découvert et les précieuses reliques fussent tombées erre des mains profanes.
Je cède ici la parole à Hadji Molla Ali Ekber Chahmirzadèh qui ma raconté toute cette histoire en ces termes : «Après avoir reçu l'ordre en question nous allâmes, A Djemal et moi, chercher la caisse à l'imam Zadé Mahsoum. Nous la retrouvâmes derrière le mur en briques que nous dûmes détruire et nous la transportâmes du côté de Chah Abd oul Azim. La nuit était venue et nous ne savions que faire ne trouvant aucun endroit où nous puissions déposer en sûreté la caisse qui nous était confiée. Nous traversâmes tout le village et nous nous rendions du côté de Tchechmé Ali quand nous passâmes devant la Mosquée Machallah alors à moitié en ruines et fort éloignée de tout lieu habité.
«Nous trouvâmes l'endroit favorable, et nous nous arrêtâmes. Nous ouvrîmes la caisse et nous trouvâmes, le corps enseveli dans le linceuil ; nous le laissâmes tel qu'il était, mais nous enfermâmes le tout dans un linceul de soie que nous avions apporté. Dans cette opération, nous trouvâmes sur sa poitrine un bouquet de fleurs qu'on y avait placé et qui était tout desséché. Nous prîmes ce bouquet et nous en partageâmes les fleurs. Alors nous remîmes le corps dans la caisse que nous portâmes dans la mosquée et que nous plaçâmes sous une petite voûte restée debout. Puis, dans l'ouverture des deux arceaux nous élevâmes un mur avec les briques gisant sur le sol ; du plâtre nous avait été apporté par un de nos coreligionnaires.
«Pendant que nous étions ainsi occupés, nous ne nous aperçûmes pas que nous étions épiés par des cultivateurs que notre entrée dans ce lieu solitaire avait intrigués.
» Après avoir fini notre ouvrage, nous nous rendîmes à Qoutch Eçar, village situé au bas de Chah Abdoul Azim, où nous nous reposâmes toute la journée.
» Le soir venu, nous nous dirigeâmes vers Téhéran. Arrivés à Chah Abdoul Azim à l'endroit où se rencontrent les deux routes, l'une conduisant vers Tchechmé Ali, l’autre vers Téhéran, Djemal prit la route de la ville. Je l'arrêtai en lui disant que nous ferions bien de retourner à la Mosquée Machallah pour voir si nous n'avions pas laissé de traces trop apparentes de notre passage et si notre dépôt était réellement en sûreté. Comme vous le verrez ce fut là une inspiration du ciel.
» Nous nous mîmes en route et Djemal dont la monture était moins fatiguée ou plus robuste que la mienne me précéda. Je lui criais que je l'attendrais à l'endroit où je me trouvais. Il partit donc et je restai seul. J'attendis fort longtemps, si longtemps même que l'inquiétude me prit et que je me hâtai de rejoindre mon compagnon.
» Sur le seuil je le trouvai évanoui. Je m'empressai de le faire revenir à lui, mais il était si troublé, si ému, qu'il n'avait pas la force de répondre à mes questions sur les causes de son évanouissement. J'entrai alors dans la Mosquée craignant qu'un malheur ne fut arrivé, et, comme il y faisait obscur, je tâtai avec les mains le mur que nous avions construit. Je sentis qu'on l'avait détruit ; à moitié fou j'étendis les mains en avant, elles rencontrèrent la caisse, mais elles constatèrent en même temps que la caisse était brisée. Je la tirai à moi dans un violent mouvement de désespoir et, l'ayant trouvée fort lourde, je fus repris d'espoir. J'eus en effet bientôt l'immense joie de constater que le corps s'y trouvait encore. Rassuré, je tranquillisai mon compagnon et nous tînmes conseil sur ce qu'il y avait lieu de faire.
» Nous ne vîmes d'autre moyen que de nous en remettre à la Providence et de tâcher de faire entrer la caisse en ville. Nous la mîmes donc sur l'un de nos ânes et nous nous mîmes en route.
» Arrivés près des fortifications nous nous arrêtâmes très embarrassés ; si nous voulions faire entrer notre fardeau par la porte, les douaniers et les soldats nous eussent arrêtés pour en visiter le contenu, puis, on nous eut emprisonnés après avoir confisqué notre caisse. Passer à travers le fossé et remonter sur le talus était difficile et dangereux. Nous étions sur le point de nous désespérer quand l'orage qui menaçait depuis longtemps éclata soudain. La pluie faisait rage et les pèlerins attardés se précipitèrent en foule vers la porte. Profitant de l'occasion nous nous ruâmes au milieu d'eux et, étendant notre aba sur la caisse nous pûmes passer dans ce désordre sans être remarqués.
«Nous portâmes la caisse chez l'un des nôtres, A Mirza Hassan Vezir, gendre de Seyyèd Ali Medjd oul Achrab ; je m'installai dans sa maison sans lui révéler le secret.
» Je restai ainsi quatorze mois gardien de ce dépôt. Je ne sais comment nos coreligionnaires furent avisés de cette sépulture provisoire toujours est-il que je reçus bientôt des lettres de toutes les provinces à ce sujet et que de tous les points de l'Empire les babis commencèrent à venir en pèlerinage. J'eus beau répondre à tout ce monde que je ne savais pas de quoi il s'agissait, que tout ce qu'on racontait était faux, le pèlerinage n'en continuait pas moins.
» Dès le début, alarmé de ces allées et venues qui pouvaient éveiller l'attention des autorités, j'en référai à Béha en le prévenant même que quelques Isfahanis avaient l'intention d'acheter le terrain où s'élevait la maison pour y construire un tombeau définitif.
» Enfin, au bout de quatorze mois, comme je l'ai déjà dit, arriva de Saint-Jean d'Acre, Hadji Chah Mohammed surnommé Emine. Il était porteur d'un ordre m'enjoignant de lui remettre ce dépôt sans lui poser aucune question sur ce qu'il allait en faire. Je le lui remis sans lui demander aucune explication.
» Hadji Chah Mohammed, qui plus tard fut tué à Tauris [Tabriz] dans l'insurrection de Cheikh Obéid Oullah, porta en grand secret le cadavre dans un endroit inconnu, probablement la maison d'un de ses coreligionnaires.
» Les choses restèrent en l'état, et tous, nous ignorions le lieu où se trouvaient les restes de notre prophète quand, il y a dix-sept ans, un nommé A Mirza Aced Oullah Isfahani vint de Saint-Jean d'Acre à Téhéran. Il se chargea du dépôt, mais nul ne sut où il l'alla prendre et à qui il le confia. Enfin, il y a deux ans, ce même Aced Oullah revint et transporta les reliques jusqu'à Saint-Jean-d'Acre. On dit que la sépulture définitive se trouve au pied du mont Carmel.»
Ainsi ce n'est que bien longtemps après sa mort, que Seyyèd Ali, la plus grande figure des temps modernes, celui qui, par amour de ses semblables, se lança dans la plus effroyable aventure qu'on puisse rêver, avec un courage d'autant plus merveilleux, qu'il était tranquille et continu, et qui en fait certes un héros qu'aucun héros n'égala jamais, repose enfin dans la paix éternelle. Que la terre lui soit légère !
=====================================
IX. EVENEMENTS DE YEZD ET INSURRECTION DE NEIRIZ
Pendant que ces événements se déroulaient au Nord de la Perse, les Provinces du centre et du Sud étaient profondément remuées par les prédications enflammées des Missionnaires de la nouvelle doctrine. Le peuple, léger, crédule, ignorant, superstitieux à l'excès était frappé de stupeur par les miracles continuels qu'à chaque instant il entendait raconter ; les Mollas anxieux, sentant leur troupeau frémissant prêt à leur échapper, redoublaient de calomnies et d'imputations infamantes ; les mensonges les plus grossiers, les imaginations les plus sanglantes étaient par eux répandus dans la populace hésitante, partagée entre l'horreur et l'admiration.
Certains auteurs veulent que le Chah, indécis sur la conduite à tenir vis-à-vis de cette révolution religieuse, ait voulu être exactement renseigné, par un homme de confiance, sur la valeur et la portée de la Réforme. Il fit, pour cette mission, choix d'un homme déjà célèbre, quoique jeune encore, et descendant d'une famille illustre par sa science et ses vertus.
A Seyyèd Yahyah Darabi était fils de A. Seyyèd Dja’afer Darabi. Ce dernier était un des plus illustres oulémas de la Perse, et ses études passionnées sur les mystères divins lui avaient valu le surnom de Kéchchaf c'est à dire «Celui qui découvre les secrets célestes.» Il était étranger aux doctrines chéikhies comme à celles de Molla Sadra. Cependant, son zèle emporté, son imagination ardente l'avaient, vers la fin de sa vie fait sortir un peu des sentiers étroits de l'orthodoxie chiite. Il commentait les hadis d'une autre façon que ses collègues, et prétendait même, dit-on, avoir pénétré les soixante et dix significations intimes du Qoran. Enfin, il affirmait, en certaines circonstances, avoir accompli quelques voyages en compagnie de Khizr.
Ces étrangetés déplaisaient au clergé officiel, qui se gardait cependant de les attaquer par respect pour l'âge, la science et la haute piété de leur auteur. Les livres qu'il écrivit sont encore aujourd'hui fort estimés et très lus.
Son fils - qui, par la suite devait dépasser ces étrangetés - était à cette époque un homme de 35 ans environ qui, ses études terminées, était venu se fixer à Téhéran où il s'était lié avec tout ce que la Cour comptait de grands personnages et d'hommes distingués.
Ce fut sur lui (230) que se porta le choix de S.M. Il fut donc chargé de se rendre à Chiraz, de se mettre en rapport avec le Bab et de renseigner - aussi exactement qu'il le pourrait - l'autorité centrale, des conséquences politiques que l'on pouvait tirer d'une réforme qui semblait devoir bouleverser la face du pays.
Il se mit donc en route et arriva bientôt à Chiraz avec beaucoup d'autres pèlerins que leur soif de la vérité attirait en cette ville.
Notre Seyyèd commença aussitôt son enquête et demanda à voir le Bab. Sous plusieurs prétextes cette audience lui fut longtemps refusée. On voulait évidemment qu'avant l'épreuve décisive il eût respiré quelques jours l'atmosphère frémissante de Chiraz: si celle-ci semblait influer sur lui, il serait toujours temps alors de le mettre en présence de la «Porte de la science divine». Cependant on l'endoctrinait, on lui montrait les oeuvres du nouveau prophète. La lecture des versets le frappa et il s'écria qu'ils ne laissaient aucun doute sur la vérité de Celui qui les avait écrits : Si, en plus de ces versets, il m'est donné d'être le témoin de prodiges et miracles, je n'aurais plus qu'à m'incliner. Le Babi chargé en apparence de le recevoir, mais en réalité de l'instruire, lui fit remarquer que, pour des hommes instruits et intelligents il n'y avait aucun besoin de demander des miracles à la Vérité Eternelle et Absolue. Elle même parlait plus haut que tous les prodiges de la terre, et si «quand on se trouvait face à face avec elle on exigeait encore uns preuve quelconque, c'était sur une route illuminée par le soleil demander un flambeau».
Enfin, après diverses péripéties qu'il est inutile d'enregistrer de nouveau ici, puisque nous les avons déjà racontées, il donna sa foi définitive et complète, devenant bientôt l'un des plus ardents et des plus hardis missionnaires de la religion nouvelle.
Les uns veulent qu'il ait écrit à Mohammed chah pour lui faire part de sa conversion; d'autres disent, et ce sont les plus nombreux, qu'il revint à Téhéran où il chercha à convertir ses anciens amis. Il semble n'y avoir pas réussi et nous le retrouvons à Yezd où il s'était rendu pour y semer la bonne parole. C'était au mois de Moharem 1266.
Son ardeur l'entraînait, et, rempli de l'amour de Dieu, il voulut faire connaître à la Perse tout entière la gloire et la joie de l'unique et éternelle Vérité.
«Aimer et cacher son secret est chose impossible» a dit le poète : aussi notre Seyyèd se mit-il à prêcher ouvertement, dans les mosquées, dans les rues, dans les bazars, sur les places publiques, enfin partout où il rencontrait des auditeurs.
Un tel enthousiasme porta ses fruits, et les conversions vinrent à lui, nombreuses et désintéressées : les mollas s'émurent et dénoncèrent violemment le sacrilège au Gouverneur de la ville. Celui-ci s'empressa d'envoyer ses hommes avec ordre d'arrêter immédiatement le prédicateur. C'était là un ordre plus facile à donner qu'à exécuter car déjà le parti de Seyyèd Yahyah était trop nombreux dans la ville pour qu'une pareille arrestation pût s'opérer sans scandale : il éclata en effet. Les hommes du gouverneur Agha Khan furent reçus à coup de sabres et de fusils : la plupart restèrent sur le carreau. Agha Khan, surpris d'une résistance à laquelle il ne s'attendait pas, fit appel aux soldats de la garnison. Pendant qu'on réunissait les troupes, Seyyèd Yahyah, à la tête de ses compagnons, courut se réfugier dans une vieille forteresse de la ville. Les soldats se lancèrent à l'assaut, mais furent repoussés, perdant trente des leurs dans la bataille et n'arrivant qu'à tuer sept babis.
Les choses restèrent en l'état pendant quelques jours, mais Seyyèd Yahyah ne voyant pas la ville se soulever, comme il l'avait espéré, comprenant qu'avec le petit nombre de babi enfermés avec lui dans la citadelle, manquant d'approvisionnement et de munitions, la défense serait inutile, résolut d'aller ailleurs tenter la fortune. Avant de partir il eut soin d'écrire une lettre à ses compatriotes de Neïriz, quartier de Tchénar Soukhté, pour les aviser qu'il avait trouvé la vérité. Puis, un certain Haçan, qui depuis longtemps lui servait de domestique s'offrit à aller lui chercher un cheval. Mais il fut pris et conduit chez Agha Khan qui ordonna son exécution immédiate. On voulut donc l'attacher à la bouche d'un canon, mais comme on le liait le dos tourné contre l'arme, il demanda que par faveur spéciale on voulut bien l'attacher la face tournée vers l'artilleur chargé de mettre le feu à la pièce, curieux qu'il était, disait-il, de voir comment celui-ci s'y prenait. Ce sang-froid stupéfia les assistants qui déférèrent d'ailleurs à son désir.
La nuit suivante Seyyèd Yahya sortit secrètement de la forteresse avec ses compagnons, se dirigeant vers la province du Fars.
Agha Khan, quand il eut constaté la disparition du rebelle, poussa un soupir de soulagement. Il jugea d'ailleurs que la poursuite des fugitifs pouvait offrir quelques dangers et qu'il était infiniment plus pratique, plus salutaire, plus profitable et moins dangereux de torturer - à la condition qu'ils fussent riches - les babis ou soi-disant tels qui restaient dans la ville: Il fit donc rechercher les plus opulents, les fit mettre à mort et confisqua leurs biens, vengeant ainsi la religion outragée, ce qui peut être lui importait peu, mais remplissant ainsi ses coffres, ce qui lui plaisait infiniment.
Cependant les fugitifs continuèrent leur route et arrivèrent bientôt à Bévanat (231) qui est village du district de Chiraz.
Là, notre Seyyèd convertit quelques habitants, entr'autres Hadji Seyyèd Esmaïl, Chéikh oul Islam de l'endroit. Ceci fait et accompagné d'une escorte relativement nombreuse, il gagna Féçah.
Il y fut tout d'abord très bien reçu par le gouverneur A Mirza Mohammed. Il se mit à prêcher et convertit quelques personnes. Le Gouverneur, mis au courant de ces faits, crut devoir lui conseiller d'aller plus loin exercer ses talents oratoires : «Vous avez. affaire ici, lui fit-il dire, à des musulmans de vieille roche : s'ils comprennent où vous tendez, ils vous tueront.» N'ayant pu arriver à le convaincre et à se débarrasser de lui A Mirza Mohammed en référa directement à Chiraz.
Ceci se passait à l'époque où, le prince Bahram Mirza destitué de son gouvernement du Fars vivait à Téhéran. Son frère, Firouz Mirza Nousrèt ét Dowlèh, nommé à sa place n'était pas encore arrivé au siège de son gouvernement. Les affaires étaient gérées par Mirza Tazi Oullah Nacir el Moulk, ministre de la Province. C'était donc au commencement de 1266.
Nacir el-Moulk peu soucieux de prendre, en cette affaire, la responsabilité d'une guerre civile, crut plus prudent d'écrire à Seyyèd Yahya une lettre lui transmettant les plaintes qu'il avait reçues contre lui.
Le Seyyèd lui répondit courrier pour courrier que ces plaintes étaient très exagérées et ressemblaient fort à des calomnies. Il lui promettait en outre, - sans doute ironiquement - de venir le retrouver bientôt à Chiraz où il pourrait le convaincre plus facilement de la pureté de ses intentions.
En attendant, ses prédications avaient réuni autour de lui cinq cents hommes déterminés. Les Mollas craignant dès lors plus pour leur vie que pour les intérêts de la religion adressèrent un appel désespéré à Nacir el Moulk. Celui-ci inquiet de la tournure que semblaient prendre les événements, envoya en toute hâte un messager priant le chef babi de venir le rejoindre le plus tôt possible à Chiraz.
Seyyèd Yahya avait déjà, vers la fin du mois de Sefer quitté Feçah pour se rendre à Estahbanat. Mais les villageois s'opposèrent à son entrée dans le village, et il fut obligé de continuer sa route. Ce fut à ce moment que le rejoignit l'envoyé de Nacir el Moulk.
Mais Seyyèd Yahya apprenait en même temps que les habitants d'un gros village des environs, Neïriz, avaient vivement à se plaindre de leur Gouverneur Mirza Zeïn el Abédine Khan. Trouvant l'occasion propice, il refusa de recevoir le messager du Gouverneur de Chiraz et se dirigea, sur Neïriz.
Les Neirizis accueillirent Seyyèd Yahya avec le plus grand enthousiasme; il n'y avait pas deux jours qu'il était arrivé qu'une foule de gens venaient le voir de nuit, par crainte du Gouvernement, dit le Fars Namèh, et se mirent à sa disposition en haine de l'autorité. D'autres, fort nombreux, et habitant plus particulièrement le quartier de Tchénar Soukhté se convertirent en masse. Ceci en entraîna d'autres et bientôt les babis comptèrent dans leurs rangs les Toullab de Tchènar Soukhté qui étaient environ une centaine, leur chef Hadji Cheikh Abdoul Ali - père de la femme de Seyyèd Yahya, - feu Akhound Mollah Abdoul Houssein, homme fort âgé et versé dans les lettres religieuses, Akhound Mollah Bagher, Pichnamaz du quartier Molla Ali Kateb, un autre Molla Ali avec ses quatre frères, et le Ket Khoda, et des Rich Sefid, et des gens du quartier dit Bazar, tels que feu Mechedi Mirza Housseïn surnommé Qoutb, avec toute sa famille et ses parents, feu Mirza Aboul Cassem qui était neveu du Gouverneur, feu Hadji Mohammed Taghi, surnommé Eyyoub et son gendre, Mirza Honsseïn et bien d'autres du quartier des Sadats (Seyyèds), et le fils de Mirza Noura, et Mirza Ali Reza, fils de Mirza Hosseïn, et le fils de Hadji Ali etc., etc. Tous se convertirent, les uns de nuit et en tremblant, les autres sans peur et en plein jour.
Mirza Zeïn el Abédine Khan, quoiqu'il eût reçu dès les premiers jours son hôte avec toutes les marques du plus profond respect, ne tarda pas à comprendre que ses ennemis avaient trouvé en ce Seyyèd un chef trop disposé à se mettre à la tête de leurs revendications. Aussi lui envoya-t-il dire que dans l'état de trouble où se trouvaient les esprits, il valait infiniment mieux pour lui quitter la ville et éviter ainsi la terrible responsabilité qu'il allait encourir si ses partisans surexcités levaient les premiers l'étendard de la révolte.
«Qu'ai-je à voir dans toutes vos affaires, lui fit répondre le Seyyèd. Je suis venu en ce pays pour y voir mes amis et mes parents, et je m'occupe fort peu de vos dissensions intestines. N'as-tu pas peur de Dieu, n'as-tu pas honte du Prophète pour renvoyer ainsi un hôte que ta religion te rend sacré.»
Mirza Zéïne el Abédine Khan prit cette réponse pour ce qu'elle était, c'est-à-dire pour une déclaration de guerre ; il s'occupa dès lors à rassembler ses hommes pour expulser par la force le perturbateur. I1 eut d'ailleurs soin de lancer une proclamation déclarant en substance que: «Quiconque était sorti de Néïriz pour aller à Rouniz (232) se mettre aux ordres du Seyyèd, pouvait se préparer à voir la ruine de sa maison, l'arrestation de sa femme, et à subir le martyr». Puis, voyant le peu d'effet de sa proclamation, il sorti de Néïriz et se rendit à huit farsakhs de 1à, à Qouthrah village dont il était originaire, et là il s'occupa à préparer tout ce qu'il fallait pour la lutte.
Seyyèd Yahya sortit lui aussi de Rouniz, et se rendit aux environs d'Esteh'banat dans un tombeau à coupoles nommé Pir Mourad, et y resta deux jours, puis, les oulémas du village voisin ayant lancé contre lui l'excommunication, il se dirigea de bon matin, avec une vingtaine de personnes vers la Mosquée de Tchénar Soukhté et là, après avoir accompli les cérémonies de la prière, il monta sur la chaire et s'écria : «Ne suis-je donc pas celui que vous avez toujours considéré comme votre pasteur et votre guide ? N'est-ce pas sur mon avis et sur mes ordres que vous dirigiez vos consciences dans la voie du salut? Ne suis-je pas celui dont vous avez toujours écouté la parole et les conseils? Que s'est-il donc passé que vous me traitiez aujourd'hui en ennemi de votre religion et de vous mêmes. Quelle chose licite ai-je défendue? Quelle chose défendue ai-je permise ? Quelle impiété ai-je commise ? Dans quelle erreur vous ai-je engagés ? Et voilà que parce que j'ai dit la vérité, que pareil que loyalement j'ai cherché à vous instruire, on m'opprime et on me torture! Mon coeur brûle d'amour pour vous, et vous me martyrisez. Souvenez-vous, souvenez-vous bien que quiconque me contriste, contriste mon aïeul, Mohammed le radieux Prophète, et quiconque me vient en aide vient à son secours. Au nom de tout ce que vous avez de plus sacré, quiconque aime le Prophète me suive !»
Il annonça aussi en termes touchants son intention de partir. Puis il sortit de la mosquée, accompagné d'une foule de gens qui le suppliaient de rester. Ils y mirent tant d'instance que le Seyyèd, convaincu d'avance, finit par y consentir.
Dix jours s'écoulèrent en sermons et en exhortations quand on prévint Darabi que Mirza Zeïn el Abédine Khan venait de passer la revue de 2.000 hommes qu'il avait réunis, et qu'il se préparait à marcher sur Tchénar Soukhté, ayant eu soin de prévenir l'autorité de ce qui se passait.
Darabi envoya immédiatement sous les ordres de Acheikh Hadi, fils de Kerbelahi Mohammed Hassan des hommes mettre en défense une antique forteresse nommée Khadjèh, très voisine de Tchénar Soukhté. On en répara les brèches en grande hâte et l'on y réunit quelques provisions.
Les gens de Mirza Zeïn el Abédine Khan arrivèrent de nuit à Neïriz et campèrent dans le quartier Bazar, autour de la maison de leur chef, qui était en réalité une solide forteresse dominant tous les environs. Une partie d'ailleurs habita la maison de A Seyyèd Abou Taleb, Ket Khoda du quartier, récemment converti au babisme, et de laquelle ils s'emparèrent : leur chef était Mohammed Ali Khan, beau-frère du gouverneur.
Au matin, du côté Babi, Akhound Mollah Abdoul Hosseïn était monté sur la terrasse de la forteresse pour observer ce qui se passait en ville; les soldats musulmans l'aperçurent, tirèrent sur lui et le blessèrent au pied. Ce fut le premier sang répandu sur cette terre qui devait, sous peu, en recevoir des flots.
On annonça cette nouvelle à Seyyèd Yahyah qui écrivit une lettre de félicitation à l'Akhound. Mais, la nuit venue, quelques uns des défenseurs de la forteresse pris de peur, abandonnèrent leurs rangs et s'enfuirent. Seyyèd Yahyah, pour éviter de nouvelles défections vint à cheval, entouré d'une assez grande foule de gens partager le sort de ses compagnons.
Aussitôt qu'il fut entré, le Khan gouverneur et son frère Ali Asker Khan vinrent environner la forteresse avec leurs soldats, et s'empressèrent de détourner le cours d'eau qui alimentait les babis.
Ce jour même il y eut une rencontre entre les babis et les troupes royales : les sectaires perdirent Tadj ed dine, qui était très renommé pour son courage, Zéïne el Abédine fils d'Iskender. Mirza Aboul Cassem fut blessé et mourut quelques jours après de ses blessures.
Sur ces entrefaites arriva le courrier envoyé par le gouverneur de Chiraz en réponse à une lettre que Zéïne el Abédine Khan lui avait écrite pour dénoncer ce qui s'était passé. Le Khan envoya le messager chez Vahid - car tel est le titre que les babis avaient donné à Seyyèd Yahyah - et celui-ci s'acquitta de son message qui en deux mots engageait le chef babi à éteindre l'incendie qu'il avait allumé avant qu'il ne le dévorât lui-même.
Vahid, sachant bien que sa réponse serait connue du camp ennemi, résolut, de profiter d'une occasion si belle pour endormir la vigilance de ses adversaires. Aussi répondit-il que c’était malgré lui qu'il était lancé dans cette aventure, qu'il était moins le chef que le prisonnier de ses compagnons, qu'il craignait qu'une tentative de fuite de sa part, si elle ne réussissait pas, ne se termina par son exécution par les révoltés. Il suppliait donc son correspondant d'envoyer des troupes suffisantes pour que ses compagnons comprissent que la lutte était inutile: il attendrait avec impatience ce moment de recouvrer sa liberté (233).
Quand la nuit fut venue Seyyèd Yahyah sortit avec ses hommes - 14 d'après le second auteur - de la forteresse et se dirigea dans le plus grand silence vers le camp des musulmans.
Quand ils y furent arrivés les babis se jetèrent sur leurs ennemis endormis au cri de Ya Sahab èz Zéman et en firent un carnage affreux. Ali Asker Khan, frère aîné de Mirza Zéïne el Abédine, sa famille, tous les fonctionnaires furent passés au fil de l'épée. Trois fils d'Ali Asker Khan furent fait prisonniers. Les babis, renversant tout sur leur passage pénétrèrent jusqu'à Neïriz qu'ils mirent à feu et à sang. Le gouverneur faillit vingt fois être pris et ce n'est qu'avec la plus grande difficulté qu'il parvint à s'enfuir; aussi en profita-t-il pour fuir jusqu'à Qouthrah.
La déroute était complète, d'autant plus complète que ce qui restait de Neirizis se convertit comme un seul homme au babisme et vint grossir d'une façon sensible le nombre des défenseurs de la forteresse. Ceux.ci, disent les musulmans se montrèrent bientôt au chiffre de 2000 hommes - 7 à 800 suivant l'auteur babi.
Mirza Zéïne el Abédine Khan ne manqua pas d'écrire à Chiraz sa propre défaite, la victoire de Seyyèd et les conversions de ses administrés. Nacir el Moulk voyant les choses se gâter envoya la lettre au Prince Firouz Mirza Nousrët ed Dowlèh, gouverneur de la ville qui, venant de Téhéran pour rejoindre le siège de son gouvernement, se trouvait à ce moment à 4 stations de Chiraz.
Vahid songea à organiser sa conquête; il fit fortifier les tours et creuser un immense ab-embar, - réservoir, - en même temps qu'il faisait dresser tout autour de la forteresse les tentes qu'il avait pillées à l'ennemi.
Furent nommés: gardien de la porte, Kerbélai Mirza Mohammed; gardien du trésor,Cheikh Youçouf; commandant des environs et des remparts extérieurs Kerbélaï Mohammed fils de Chems ed dine; commandant de la tour du moulin Khabar situé tout à proximité, Mirza Ahmed; bourreau, Chéikha; gardien des prisons Mechedi Taghi, l'épicier ; comptable Hadji Mohammed Taghi. Quiconque voulait s'enrôler dans l'armée de Dieu devait tirer de lui un papier : on évitait ainsi les discussions, et celui qui entrait savait, par ce fait même, qu'il sacrifiait tout ce qu'il avait de cher au monde.
Mirza Djaafer, neveu du Gouverneur se fit babi : il composa une ode en l'honneur de la guerre et l'on chargea Mirza Fazl 'Oullah de la lire aux troupes.
Enfin, le commandement suprême fut donné à Agha Ghoulam Riza Yezdi, qui avait jadis accompagné Vahid à Yezd.
Quelques-uns reçurent des grades dans la ville même : tel celui qui fut nommé commandant militaire de la mosquée Djam'èh, point militaire de premier ordre.
Vahid semble avoir pris ses fonctions tout à fait au sérieux; il était, s’il faut en croire une anecdote que je vais dire, fort sévère, dur d'aspect et son port terrifiait ceux qui avaient affaire à lui. Tout individu convaincu d'avoir manqué de respect à la nouvelle religion était immédiatement saisi, amené à la forteresse, condamné et exécuté par Cheikha.
Or donc un jour, un étranger vint offrir un superbe fusil à Vahid. Celui-ci le prit, l'examina avec attention et dit au gardien du Trésor: «Chéïkh Youçouf prends ce fusil.» Le mot chéïkh n'était pas encore terminé que l'étranger, s'imaginant que l'on appelait Cheikha pour lui couper le cou, se trouva mal, verdit, vomit et mourut.
La tradition ajoute même qu'on prit son corps, qu'on le mit sur un mulet et qu'on le portait chez lui pour l'enterrer, quand un vieux Seyyèd, du nom de Motalleb, interpella les porteurs et leur demanda ce qui était arrivé.
Sur leur réponse, il fut tellement saisi de l'aventure qu'il en mourut aussitôt.
L'histoire babie intervient ici dans la correspondance entre Zeïn el Abédine et le sous-gouverneur de Chiraz. Nous avons raconté que le gouverneur de Neïriz avait écrit à Nacir el Moulk; or, il avait confié sa lettre - contenant un cadeau de 5.000 tomans - à Molla Bagher, qui était de ses intimes, et dans lequel il avait la plus grande confiance : il l'avait chargé de corroborer le récit qu'il envoyait, et de presser l'envoi des renforts. Or, ce messager, pour plus de sûreté, prit la route de Houdechtèq.
Il se rencontra précisément que Hadji Seyyèd Ismaïl. qui était Cheikh oul Islam de Bavanat, avait pris de Vahid la permission de rentrer dans ses foyers et s'était mis en route, suivant le même chemin que l'envoyé de Zeïne el Abédine Khan.
A une station de Neïriz se trouve une immense plaine servant de lieu de pâture aux tribus qui y viennent camper et qui est dominé par une forteresse nommée Houdechtèq.
Le Cheïkh, arrivé vers midi, s'était arrêté là et déjeunait paisiblement quand son regard tomba sur un beau cheval tout harnaché : La réflexion lui vint qu'une pareille bête ne pouvait qu'appartenir à un étranger de passage. Il s'enquit donc du propriétaire, et quand on lui eut répondu que c'était un des hommes du gouverneur de Neïriz, il se leva tout d'un coup, et monta sur la bête.
Molla Bagher était sous une tente voisine, en train de causer avec un individu quelconque. Le cheikh, le sabre à la main, s'élança vers la tente et s'adressant à l'interlocuteur de Molla Bagher, il lui cria à haute voix : «Fais immédiatement arrêter cet homme, car il fuit le sabre du Sahab-èz-zéman, dont je suis le serviteur.»
Des gens, qui avaient entendu, accoururent, et tous, terrifiés par l'attitude, le geste et la voix du cheikh, se précipitèrent sur Molla Bagher qu'ils remirent lié à son vainqueur.
Le cheikh s'empara donc du messager et le conduisit à coups de fouet jusqu'à 2 farsakhs de Neïriz dans un village nommé Roustaq ; là, il le confia à un de ses coreligionnaires, Hadji Akber Ket Khoda, en lui annonçant que le prisonnier était un lâche déserteur de Vahid, et qu'il ait à le faire parvenir au chef babi.
Hadji Akber, convaincu de l'importance de la prise, la conduisit lui-même à Vahid. Celui-ci interrogea le messager qui, avec beaucoup plus de courage qu'on ne pouvait en attendre d'un persan, avoua hardiment qui il était et pour quelle oeuvre il s'était mis en route. Comme il refusa de se faire babi, il fut exécuté séance tenante, et cette exécution sommaire mit le comble à la fureur de Zeïne el Abédine Khan.
Quoi qu'il en soit, le prince gouverneur de Chiraz finit par recevoir les lettres du gouverneur de Neïriz, et, décidé à frapper un grand coup, nomma Mehr Ali Khan Choudja el Moulk serdar du contingent Hamadani, et Moustafa Kouli Khan, colonel du bataillon silakhouri. Il les envoya contre les babis, en même temps qu'il faisait annoncer la levée des hommes disponibles à Estéh'banat, Iredj, Pendj Maaden, Qouthrah, Bouchné, Dèh Tcha, Mouchkan, Roustaq, etc.
Mehr Ali partit le premier, immédiatement suivi de Moustapha Kouli Khan, pendant que les habitants du village s'assemblaient peu à peu.
Les trois armées se réunirent à Neïr,iz où elles investirent complètement le camp babi. Il y eut dès ce jour-là une légère escarmouche qui coûta la vie à un babi qui se tenait à cheval devant la porte de la forteresse et qui fut tué d'un coup de canon ; mais un de ses camarades ayant réussi à abattre l'artilleur d'un coup de tromblon; les choses en restèrent là, et chacun se retira derrière ses tranchées.
L'auteur du Nassikh-et-tévarikh constate sans la moindre mélancolie que les troupes impériales étaient mal exercées et fort peu désireuses de se battre : aussi, ne songeant pas une seconde à donner l'assaut, elles établirent un camp qu'elles se hâtèrent de fortifier le plus possible.
Durant cinq jours les armées s'observèrent; la sixième nuit Vahid choisit 300 hommes (234) parmi les plus déterminés de son armée et les envoya en silence contre le camp. A minuit, ils sortirent de la forteresse armés de sabres, et, quand ils furent près de l'ennemi ils se précipitèrent sur lui en poussant leur cri de guerre. Les impériaux, affolés, cédèrent comme toujours, mais leurs chefs se multipliant, ils revinrent au combat. La bataille dura huit heures, et le matin venu, les babis, las de carnage, rentrèrent triomphalement chez eux. Il y eut, dit le Fars-Nameh 300 musulmans tués et 150 babi, mais l'auteur babi, qui se tait sur le nombre des ennemis tués, accuse pour cette nuit-là la mort de 60 des siens (235).
Ce fut certes un beau triomphe, mais malgré notre auteur babi qui se tait sur les désertions, nous sommes bien obligés, avec le Fars Nameh, d'admettre qu'il s'en produisit.
Ce nombre de 150 ou de 60 tués fit réfléchir quelques-uns des nouveaux convertis qui, en bons persans qu'ils étaient eussent voulu voir dans cette victoire un miracle ; avec la meilleure volonté du monde, ils n'y pouvaient parvenir et cette difficulté les poussa petit à petit à sortir de la forteresse et à rentrer chez eux pour voir de loin, et à l'abri des coups; ce qui se passerait.
La désertion allait en augmentant et Seyyèd Yahyah, craignant de se voir bientôt abandonné de la plupart de ses compagnons résolut de se les attacher définitivement par une grande victoire. Il tenta une nouvelle surprise, mais le hasard voulut que ses hommes fussent aperçus au moment où ils sortaient de leur citadelle. Aussi furent-ils reçus à coups de canon ; cinquante d'entre eux mordirent la poussière. Les autres n'hésitèrent pas cependant ; ils entrèrent dans le camp, le sabre haut, et massacrèrent 100 soldats. Choudjah el Moulk eut toutes les peines du monde à empêcher ses gens de lâcher pied, admirablement secondé par Moustapha Kouli Khan, si bien que les babis durent se retirer(236).
Qnoique les pertes fussent à peu près égales cette fois, les troupes impériales n'en avaient pas moins fort peur : les choses traînaient en longueur, et pouvaient au surplus tourner à la confusion des musulmans. Ceux-ci résolurent donc d'user de ruse. Ils envoyèrent un messager à Vahid, chargé de lui présenter leurs excuses en même temps que de lui remontrer l'inutilité de verser le sang pour une cause sur laquelle on pouvait s'entendre sans tant de querelles. Ce messager remit en outre à Vahid un Qoran signé des principaux musulmans comme signe de sa sauvegarde et de leur bonne foi, et l'invita à avoir une entrevue avec les chefs musulmans.
Vahid, à l'audition de ce message et à la vue da Qoran se contenta de prononcer ces paroles: «Nous venons de Dieu et nous retournons à Lui. Voilà que la promesse de Dieu est arrivée à son terme fatal.» Il se leva et se rendit au camp accompagné de cinq personnes parmi lesquelles Akhound Molla Ali, l'enlumineur, et Hadji Seyyèd Abed, le traître.
Avant de quitter ses compagnons, il leur fit adieux et leur recommanda de rester fermes à leur poste jusqu'à ce qu'il leur arrivât des nouvelles sûres de lui.
Le serdar, Zéine el Abédine; Moustapha Kouli Khan et d'autres vinrent au-devant de lui et le conduisirent avec toutes les marques du respect jusqu'à une tente qu'on avait ornée de tapis. Il resta là 3 jours, pendant que ses compagnons laissés dans la forteresse attendaient sa décision (237).
Pendant ce temps les musulmans étaient fort embarrassés. Ils tenaient bien le chef, mais n’osaient rien tenter contre sa personne de peur de voir ses terribles compagnons de la forteresse voler à son secours. Il fallait se débarrasser d'eux d'abord, puis on traiterait Seyyèd Yahyah suivant ses mérites. Le plus simple conclurent-ils est d'obtenir de Vahid une lettre annonçant que la paix était définitivement conclue et que chacun n'avait plus qu'à rentrer chez soi.
Ils furent un peu étonnés de voir que Seyyèd Yahyah était absolument de leur avis : il consentit immédiatement à ce qu'on lui demandait.
Il écrivit donc cette lettre, mais en écrivit secrètement une seconde donnant l'ordre de ne tenir aucun compte de la première et de tenter cette nuit même une surprise qui réussirait, il en était sûr.
Il confia les deux plis à Hadji Seyyèd Abed, le traître, avec des recommandations particulières. Ce maudit s'empressa d'aller porter les deux missives à Mirza Zéïne el Abédine Khan. Celui-ci remercia vivement le messager, lui fit les plus belles promesses du monde et l'envoya porter la première lettre en l'invitant à se taire sur ce qui s'était passé entre eux.
Les gens du château furent convaincus, tant par la lettre qui était incontestablement de Vahid, que par les dires de Abed. Quoique fort étonnés, ils se préparèrent à obéir, et, la nuit venue, s'en allèrent, la plupart abandonnant leurs armes.
Les musulmans avaient envoyé une première colonne pour s'opposer à leur passage, et une seconde pour leur couper la retraite. Les babis, se heurtant aux premiers musulmans qu'ils rencontrèrent, comprirent immédiatement le piège dans lequel ils étaient tombés. Ils se jetèrent sur les assaillants avec tant d'ardeur et de courage, qu'ils traversèrent leurs lignes, et, après maintes difficultés, vinrent se réunir à la mosquée Djam'èh qu'ils considéraient comme une forteresse. Mais là une nouvelle surprise les attendait. Ils y avaient été précédés par Molla Hassan, fils de Molla Ali Mohammed, qui s'était emparé des hauteurs et qui fusillait quiconque se présentait. Molla Housseïn, l'un des babis, monta dans le minaret et le jeta en bas d'un coup de fusil, mais les religionnaires ne purent entrer et durent se cacher un peu partout.
Molla Hassan fut d'ailleurs guéri de ses blessures et se montra par la suite l’un des pires adversaires de la secte nouvelle (238).
Le lendemain les musulmans arrêtèrent l'un après l'autre tous les babis qui leur tombèrent sous la main; on pilla ou on incendia leurs maisons, et eux-mêmes, le carcan au cou, les menottes aux mains, furent amenés au camp. Deux jours après, le bourreau étant venu de Chiraz exécuter quelques-uns des sectaires, refusa d'accomplir son office sur la personne de Seyyèd Yahyah, craignant, disait-il, d'être maudit par le Prophète pour avoir versé le sang d'un de ses descendants.
C'est qu'en effet, depuis quelques jours, les musulmans cherchaient a rompre le serment qu'ils avaient signé sur le Qoran. Ce refus du bourreau les remplissait de terreur. Enfin, celui qui commandait les cavaliers, et qui avait eu deux de ses plus proches parents tués dans cette guerre, s'avança vers le Seyyéd et se tournant vers les musulmans. «Vous avez juré, dit-il, de respecter sa vie, mais moi je n'ai rien juré du tout ; d'ailleurs personnellement je suis chargé de martyriser jusqu'à ce que mort s'en suive tout individu accusé. Venez, ô vous tous qui avez laissé des parents sur le champ de bataille, venez, et prenez de ce Seyyéd le sang que vous avez perdu.» Le premier qui se rendit à cet appel fut Molla Riza, fils de Méchedi Mohammed et frère de ce Molla Bagher qui avait été exécuté sur l'ordre de Vahid. Il s'empara de la ceinture verte de Yahyah, symbole de sa descendance sacrée, la lui noua autour du cou par un noeud et se prit à le traîner par terre. Puis vint Séfer, dont le frère Chahaban était tombé victime de la guerre; puis Agha Djan, fils de Ali Asker Khan, frère de Zeïne el Abédine Khan. Et les musulmans, excités par ce spectacle, lapidèrent le malheureux et l'achevèrent à coups de bâton. On lui coupa alors la tête, on en arracha la
peau qu'on remplit de paille et l'on envoya ce trophée à Chiraz.
On restait maître de trente-deux prisonniers, hommes, femmes et enfants. On résolut de les envoyer vers le Prince Firouz Mirza Nousret ed Dowlèh.
«C'était un jour de fête, ce jour-là, raconte un témoin oculaire. Les habitants s'étaient répandus dans les campagnes avoisinantes, apportant leur repas et beaucoup d'entre eux buvant, à la dérobée, de pleines bouteilles de vin. L'air retentissait des sons de musique, des chants des musiciennes, des cris et des rires des filles publiques : le bazar était pavoisé, la joie éclatait partout. Soudain se fit un grand silence. Le peuple venait d'apercevoir trente-deux chameaux, chargés, chacun d'un malheureux prisonnier, d'une femme ou d'un enfant, ficelés et jetés en travers de la selle comme un paquet. Tout autour des soldats portaient de longues lances au bout desquelles étaient fichées les têtes des babis tués à Neïriz. La hideur du spectacle saisit violemment la mobile population de Chiraz, et chacun rentra tristement chez soi.»
«L'horrible caravane traversa les bazars et parvint jusqu'au palais du Gouverneur. Celui-ci se trouvait dans son jardin et avait réuni dans son kiosque, surnommé Koulah Frenghi, tout ce que Chiraz comptait d'hommes riches ou éminents. La musique se tut d'elle-même, les danseurs s'arrêtèrent et Mohammed Ali Khan ainsi que Mirza Néhime, deux petits chefs de tribu qui avaient pris part à la campagne, vinrent raconter leurs hauts faits et nommer les prisonniers un à un.»
Les hommes furent exécutés :(239) ils étaient d'ailleurs peu nombreux, les femmes furent emprisonnées et l'on ne sait ce qu'elles devinrent par la suite : quant aux deux jeunes fils de Seyyèd Yahyah, trop jeunes pour être tués, ils furent envoyés à Bouroudjird et confiés à leur grand-père, Seyyèd Djaafer.»
Il semble, hélas ! que tout ce sang répandu eût dû suffire à apaiser la haine et la cupidité des musulmans ; il n'en fut rien. Mirza Zéïne el Abédine Khan, se sentant menacé par le désir de vengeance des gens qu'il avait trompés et vaincus, ne laissa ni trêve ni repos aux survivants de la secte : sa haine s'était déchaînée, elle ne devait finir qu'avec sa vie.
C'était, en effet, les pauvres diables qu'on avait envoyés à Chiraz, les riches avaient été retenus. Zéïne el Abédine Khan les confia à un individu chargé de les promener en les bâtonnant à travers la ville. On s'amusait à Neïriz, en ce moment-là. On pendait les babis à quatre clous, et chacun venait se repaître de l'angoisse du malheureux supplicié, on leur mettait des roseaux enflammés sous les ongles, on les brûlait au fer rouge, on les privait d'eau et de pain, on leur faisait un trou dans le nez, on y introduisait une ficelle et on les promenait ainsi comme des ours. A Seyyèd Djaafer Yezdi vit les bourreaux lui brûler son turban, puis le promener lui-même de porte en porte en réclamant de l'argent aux propriétaires ; comme on était en plein hiver on en profita pour jeter Hadji Mohammed Taghi surnommé Eyyoub dans un bassin, et quand il sortait la tête pour respirer, les assistants le frappaient, à coups de bâton pour le faire rentrer sous l'eau. D'autres fois on prenait les plus considérables d'entre les babis, A Seyyèd Djaafer, Hadji Cheikh Abd Ali, Eyyoub, A Seyyèd Housseïn : on les faisait gravement asseoir sur des chaises puis on invitait la population à venir leur cracher à la face.
A Seyyèd Abou Taleb, qui était fort riche, fut chargé de chaînes, envoyé par le Gouverneur de Neïriz à Maaden et là empoisonné par Hadji Mirza Nacir, le même qui à Chiraz avait ordonné au Bab de baiser la main de Cheikh Abou Tarab.
Deux femmes babises, avant d'être faites prisonnières, se jetèrent dans un puits et se tuèrent.
Quelques babis, désireux de se venger de Mirza Zéïne el Abédine Khan se dirigèrent sur Téhéran pour aller se plaindre à S. M. des atrocités qui avaient été commises. Ils étaient arrivés jusqu'à 2 ou 3 stations de la capitale et se reposaient des fatigues du voyage quand une caravane de Chirazi vint à passer qui les reconnurent, les arrêtèrent tous, sauf un certain Zéïne el Abédine qui put parvenir à Téhéran. On conduisit les autres à Chiraz où le prince les fit exécuter aussitôt. Là moururent Kerbélahi Aboul Hassan, faïencier, A Cheikh Hadi oncle de la femme de Vahid, Mirza Ali et Aboul Cassem ibn Hadji Zeïna, Akber ibn Abed, Mirza Hassan et son frère Mirza Baba.
Ces plaisanteries durèrent deux ans, c'est-à-dire jusqu'en 1268-1269. On conçoit que la plupart des babis aient fui la ville et se soient réfugiés dans les montagnes des environs ; mais une chose à peine croyable c'est que leur nombre augmentait et qu'ils se virent bientôt assez forts pour tenter d'exécuter leur projet favori, l'assassinat de Mirza Zéïne el Abédine Khan.
Mais celui-ci se gardait, et ne se hasardait à sortir qu'accompagné d'une escorte formidable. Les babis furieux - on était à ce moment en automne, à l'époque où l'on boit le jus de raisin - attaquèrent, dans la montagne Bala Taroun une fabrique qui lui appartenait et tuèrent ou blessèrent 3 ou 4 hommes. Zéïne el Abédine Khan envoya des soldats pour se venger et arrêter les coupables, mais ses envoyés revinrent les mains vides. '
Pendant cette période de deux ans un certain individu était revenu à Neïriz après une assez longue absence. Il était Babi, se nommait Ali et avait reçu le surnom de Serdar. Cet Ali Serdar sortait toutes les nuits de chez lui, un sabre à la main avec lequel il épouvantait les musulmans qu'il rencontrait. Il se rendait chez ses coreligionnaires, les soutenait, les secourait, donnait à ceux qui n'avaient pas, prêchait, conseillait, entretenait en un mot la foi et l'enthousiasme des babis.
Mirza Zéïne el Abédine Khan le fit arrêter, mais comme on n'avait rien à lui reprocher, il fallut bien l'élargir et Ali Serdar continuait son travail occulte avec la même ardeur et la même conviction.
Enfin Mirza Housseïn Qotb, qui était à Téhéran vint à Neïriz. C'était un homme d'un courage éprouvé, loyal, disert, et qui fit vite la conquête des babis. Celui-ci ne cessait chaque nuit de les exciter à tirer vengeance sur Mirza Zéïne el Abédine Khan, de la mort de Vahid.
II fit tant et si bien qu'en fin de compte il réussit.
Cinq individus jurèrent de le tuer ; c'étaient Kerbélahi Mohammed, ses trois fils Khadjé Mohammed, Khadjé Hassan, Khadjé Ali et Oustad Cassem le propre maçon du Khan.
Un Jeudi soir, le Khan dit à son ferrach bachi Kerbélahi Sadeq qu'il irait le lendemain matin de très bonne heure au bain, puis en sortant qu'il monterait à cheval. «Toi, cependant, tu prendras les gens nécessaires et tu iras arrêter les soixante-dix babi dont les hommes sont inscrits sur cette liste.»
Un homme sûr vint prévenir les cinq compagnons de ces dispositions. Ceux-ci firent leurs adieux à leurs femmes et à leurs parents, et pénétrèrent dans le bain bien avant que le Khan n'eût envoyé ses soldats et ses fusiliers, ainsi qu'il le faisait chaque fois qu'il s'y rendait.
Le Khan arriva enfin, et à peine fut-il entré que les cinq babi se précipitèrent sur lui et se mirent à le frapper avec une violence inouïe. Le Khan, couvert de blessures se défendait fort mal, mais les baigneurs coururent prévenir les ferrachs de ce qui se passait. Ceux-ci se précipitèrent dans le bain et, après une lutte sommaire mirent à bas quatre babi. Le cinquième Ousta Cassem parvint à s'enfuir et déjà il avait gagné la seconde salle, celle où les clients se dépouillent de leurs vêtements, quand il entendit s'élever soudain la voix de sa victime. Saisi de fureur il s'écria :«Quoi ! chien maudit ! tu vis encore !» Et il se précipita, armé d'une alêne de cordonnier, renversant tout sur son passage. Arrivé près de Zéïne el Abédine, il se pencha sur 1ui, introduisit sa main dans une blessure qu'il avait au ventre, saisit avec force les intestins et les arracha. Il tomba, massacré aux pieds de sa victime expirante.
Le Gouverneur du Fars était à ce moment le prince Thamasp Mirza, Mouayyéd ed Dowléh. On lui raconta ce qui s'était passé et il nomma Mirza Néïme Gouverneur de Neïriz.
Celui-ci envoya d'abord son oncle Mirza Baba avec des cavaliers. Puis, environ un mois après il vint lui-même accompagné de nombreux fantassins et de cavaliers. Ali Serdar et ses compagnons vinrent au devant de lui et tout semblait s'être apaisé. Mais la femme de feu Mirza Zeïne el Abédine Khan ne pouvait pardonner le meurtre de son mari. Elle intrigua tant et si bien quelle fit entrer Mirza Néïme dans ses intérêts.
Celui-ci qui se montrait très affable avec les sectaires, résolut de faire arrêter les babis sans aucun risque. I1 envoya un homme chez eux; chargé d'annoncer que quiconque avait eu à se plaindre de son prédécesseur n'avait qu'à venir tel jour, à telle heure, se présenter au divan, qu'on examinerait sa plainte et qu'on restituerait tous les biens injustement confisqués.
Le jour indiqué venu, un certain nombre de babi se présentèrent. On les laissa passer, mais à peine furent-ils entrés qu'on ferma les portes et que les soldats parurent prêts à faire feu.
Le coup de filet rapportait cent cinquante babi, et parmi eux Mirza Housseïn Qotb et Ali Serdar.
Quelque temps se passa et Mirza Néïme eut besoin d'aller à Chiraz. Il fit faire une liste exacte des prisonniers et les confia à son oncle Mirza Baba.
Choudja el Moulk écrivit au Sadr A'azam la nouvelle de ces arrestations, fit ressortir l'immense service que Mirza Néïme avait rendu à l'Islam sans qu'une goutte de sang fut répandu: le Chah donna l'ordre d'envoyer les prisonniers à Téhéran.
Or, il arriva que durant l'absence de Mirza Néïme les habitants de Qouthrah se révoltèrent contre Mirza Baba et refusèrent de payer l'impôt. Fort embarrassé, il n'eut plus bientôt qu'un seul moyen de vaincre ces résistances : il fit appel au dévouement d'Ali Serdar, qu'il envoya comme négociateur. Celui-ci revint à Neïriz après avoir réussi dans sa mission. Il conserva sa liberté et consacra tous ses soins à adoucir le sort des prisonniers.
Ce fut à ce moment qu'arrivèrent à Chiraz les gens chargés par S. M. de conduire les prisonniers à Téhéran. Mirza Néïme les envoya à Neïriz avec des troupes.
Mais, avant qu'ils fussent arrivés les babis de Chiraz prévinrent leurs coreligionnaires de Neïriz. Ceux-ci se réunirent pour aviser aux mesures à prendre, mais comme ils étaient trop nombreux ils se divisèrent en trois groupes : les Akhounds se réunirent dans la maison de Molla Mohammed Mo'men ; Ali Serdar fit venir les fusiliers chez lui; Méchedi Mirza Housseïn Qotb entraîna les autres au Bostan Rézi qui est en dehors de la ville. Ils se tenaient mutuellement au courant des résolutions prises à l'aide de messagers qu'ils s'envoyaient d'instant en instant.
Mirza Baba était extrêmement embarrassé. Il arrêta bien des gens quelconques qu'il se réservait d'envoyer à Téhéran comme babi, mais il comprenait bien qu'il lui fallait quelques véritables religionnaires. Après mûres réflexions il ordonna aux cavaliers et aux soldats de cerner le jardin Rézi. Ceux-ci le firent, mais refusèrent énergiquement d'entrer dans le jardin. Mirza Baba envoya des ferrachs, mais ceux-ci furent reçus à coups de pierres, de revolver et de bâton. Alors les babis sortirent du jardin en criant Allahou Ekber ce qui attira les deux autres groupes qui vinrent les rejoindre.
Les soldats les environnèrent, et les babis s'étant fortifiés derrière le qanat, la bataille commença. Quelques babis furent faits prisonniers. Ce furent Molla Mohammed Ali surnommé Qabèz; Mohammed ibn Mir Ahmed, Mahmoud ibn Hayder Bèk, Abdoullah ibn Asker, Ahmed ibn Mechedi Ismaïl, Ali et Mourad Sirdjani, Riza Qanqari. Ces sept derniers furent emprisonnés avec Khadjèh Kaffar dans une prison qui se trouvait située sous le mur de la tour de la maison de Zeïne el Abédine Khan. Ils résolurent de faire un trou dans le mur pour s'enfuir: et se mirent immédiatement à l'oeuvre. Quand le travail fut sur le point d'être terminé, Khadjèh Ka,ffar en prévint le Gouverneur, se prévalant de cette dénonciation qui démontrait, d'après lui, qu'il n'était pas babi.
On envoya donc chercher les sept individus et on les amena jusque devant la Mosquée Nazar Bek. Là Mohammed fut tué d'un coup de pistolet que lui tira Agha Ali Naghi ; les six autres eurent le col tranché par Khadjèh Kaffar qui décidément donnait des gages sérieux de son islamisme.
La nuit venue, les babis se retirèrent à un demi farsakh de la ville dans un jardin nommé Bidleng, et dont les arbres avaient été pour la plus grande partie plantés par Vahid même. Ils restèrent là deux jours pour laisser aux retardataires le temps d'arriver. Dès qu'ils furent en nombre, ils pénétrèrent dans les nombreux jardins des environs et y massacrèrent tous ceux qu'ils y rencontrèrent, se vengeant ainsi d'avance de leur propre mort.
Mirza Baba prévint le prince qui envoya des troupes et ordonna la levée militaire dans les villages des environs.
Les babis firent une incursion dans la ville, rassemblèrent leurs femmes et leurs enfants, les conduisirent au jardin Rézi et allèrent eux-mêmes au sommet de la montagne, dans des endroits inaccessibles où ils s'installèrent. Il se passa environ vingt jours sans incidents. Alors mille fusiliers d'Estébahnat, avec la tribu d'Inanlou, sous le commandement de Mahçoum Ali Khan, vinrent camper dans la montagne par la route d'Iredj. Mirza Neïm avec le camp impérial et des soldats vint par la route de Derb-é-Chikaf; les Neïrizis, au nombre de mille, sous le commandement de Mirza Youçouf, qalenter de Neïriz, Mohammed Riza Khan, frère du défunt gouverneur, et Molla Hassan - celui qui tirait du haut de la mosquée sur les babis - vinrent par la route de Doour-é-Koulat.
Les babis construisirent près de quarante remblais dont le commandement fut donné à un individu. Le remblai Dèr-é-Chikaf fut confié à Méchedi Dervich, un autre à Khadjè Qoutbi, un autre à Mir Ismaïl, un autre à Hadji Cassem, un autre enfin à Molla Cha Ali.
Ail Serdar, qui avait des connaissances militaires, en instruisait ses compagnons ; les akhounds, tels que Hadji Cheikh Abd Ali Qazi, Akhound Molla Abdoul Housseïn, Molla Ali, Kerbelahi Hadi, un autre Molla Ali, leur démontraient la vérité du babisme ; le service de l'intendance était assuré par le fils aîné de Molla Abdoul Housseïn et Molla Ali Naghi. Enfin Bagher, fils de Mir Ahmed, Kerbelahi Asker, le porte-drapeau, Hadji, fils d'Asker, Ali fils de Ahmed Guermsiri, Housseïn fils de Haji Khéiri, Hassan, fils de Mirza, exhortaient les babis et enflammaient leur courage.
Les babis furent rejoints par le fils cadet de Molla Abdoul Housseïn, Molla Mohammed Naqhi, qui était allé au village de Hérat pour visiter A Seyyèd Djaafer, et qui revint, dès qu'il apprit la situation critique dans laquelle se trouvaient ses compagnons. Cinq mollas Estéh 'banati apportèrent des armes aux sectaires : ce furent Molla Fazl Oullah, Molla Mohammed Ali, Molla Mohammed Bagher, Kerbélahi Sefer, et Moharnmed Ismâïl.
La guerre s'annonça mal pour les babis. Les Inanlou et les Estéh'banati leur prirent environ trente retranchements, si bien qu'ils durent reculer et se borner à défendre trois ou quatre des remblais qui leur restaient. Les musulmans vinrent s'établir si près d'eux, dit l'historien babi, que si un moustique se levait dans un camp, on pouvait l'apercevoir de l'autre.
Un fusilier Estéh'banati s'était caché derrière une pierre d'où il abattit successivement Ismaïl Khadjèh Ahmedi, qui était moutevalli du tombeau de Khadjéh Ahmed à un farsak de Neïris, Chahaban fils de Abédine et Mohammed, fils de Molla Housseïn.
Mohammed fils de Molla Ali et Mohammed fils de Agha baba, furent blessés et moururent des suites de leurs blessures. Taghi, fils de Sefer, se cacha, et à peine l'Estéh'banati eût-il tiré son cinquième coup de fusil, se jeta sur lui, d'un coup de sabre en pleine figure, l'abattit à ses pieds et rentra dans son retranchement.
Ce fut à ce moment qu'Ali' serdar arriva, s'assit et demanda à manger. On lui apporta du pain et des noix. Il réclama le qalian. Un nommé Mohammed le lui apportait quand il tomba soudain raide mort d'une balle dans la tête. Ali serdar furieux se précipita sur les musulmans, et, suivi de ses compagnons, en fit un carnage affreux. L'ennemi s'enfuit jusqu'à Iredj et les babis rentrèrent victorieux, ramenant 21 prisonniers qui furent précipités du haut de la montagne.
Mirza Neïme qui ignorait ce désastre écrivit une lettre qu'il confia à un nommé Mechedi Djaafer. Il ordonnait aux Inanlou et aux Estéh'banati d'environner de tous les côtés les babis. Venez, disait-il, par la route du Sud, les Neirizis et les Veïsbaqlouyèh viendront par le Nord sous le commandement de Mohammed Riza Khan; Mirza Youçouf qalenter viendra par l'Orient et moi-même par la route de Derb-éChikaf.»
Le courrier fut arrêté par les babis et immédiatement mis à mort. Alors les babis, prévenus, se préparèrent à attendre l'ennemi.
Les Tufengdjis parurent les premiers au nombre de 400. Parmi eux, il se trouvait des gens dont les femmes étaient babies tandis qu'eux-mêmes étaient hostiles à la nouvelle religion. Les babis les interpellèrent et une conversation s'engagea à la faveur de laquelle Ali serdar les fit tourner par une partie de ses troupes.
Ce fut Hassan, fils de Mirza qui fut chargé de ce mouvement. Il réussit admirablement, et les musulmans s'enfuirent éperdus abandonnant leurs armes et leurs provisions.
A peine cette bataille était-elle terminée que les sentinelles vinrent annoncer l'arrivée de Mirza Néïme à Derb-è-Chikaf. Quoique très fatigués les babis résolurent de les combattre immédiatement.
Ali Serdar envoya une troupe d'individus au seuil de Derb-è-Chikaf sous le commandement de Mechedi Mirza Housseïn, et une seconde troupe vers le bas de la montagne, au mont Asbouran. Il fut convenu qu'on attendrait la nuit pour se jeter sur l'ennemi endormi.
Malheureusement le premier groupe comptait un certain Seyyèd Hassan, qui, ayant la vue basse, se cogna à une grosse pierre. Celle-ci, se détachant de son alvéole roula sur le flanc de la montagne et alla, par le bruit qu'elle faisait, prévenir les musulmans que quelque chose se préparait.
Les babis, voyant la surprise manquée, se précipitèrent néanmoins à l'attaque en poussant leur cri de guerre. La confusion se mit immédiatement dans le camp, les soldats perdirent la tête et se sauvèrent de tous les côtés. Les babis mirent le feu aux tentes, ce qui permit à bon nombre de musulmans de voir la route et de s'enfuir; quelques soldats prirent Mirza Néïme sur leur dos et l'emportèrent loin de cette scène de carnage.
Les babis firent un immense butin, et s'amusèrent à transporter jusque dans leurs repaires un canon que les Impériaux avaient abandonné.
Pendant cm mois ils furent les maîtres des environs. Ils purent ainsi mettre la main sur quelques musulmans qu'ils martyrisèrent. Le premier fut Hadji Seyyèd Abed qui fut exécuté, pour avoir manqué de respect à Vahid; on tua aussi Mirza Housseïn, Roouzé Khan, qui venait la nuit trouver les babis, comme étant des leurs, et le jour les trahissait auprès de Mirza Zéïne el Abédine Khan.
Une nuit même Kerbélahi Ali prit avec lui une centaine de compagnons, pénétra jusqu'à Neïriz, alla au quartier des Sadats, dont les femmes avaient jeté de la boue sur le cadavre de Vahid, et commença un tel massacre que les malheureux s'enfuirent dans la direction de Zendjan. Trente-cinq femmes furent déchirées, deux babi furent tués.
Mirza Néime fut obligé, une fois de plus, d'en référer à Chiraz.
Cette fois, Moayyèd ed Dowléh jura d'exterminer les babis. Il envoya Loutf Ali Khan avec le régiment Kachgaï, et le régiment de Goulpaïgan, il leur adjoignit d'autres soldats et des cavaliers : il fit battre le rappel à Servestan, Esteh' banat, Iredj, Pendj Maaden, Qouthrah, Bechné, Dèh Tchah, Qouri, Mouchkan, Sartiq, Dehmourd, Khadjèh Djemali, Tchéhar Rahi, Qarahi. Il mit les fusiliers de Neïriz et la tribu de Baharlou sous le commandement de Ahmed Khan, Khan Mirza et de Mahçoum Ali Khan. On réunit ainsi 12.000 hommes qui cernèrent la montagne.
Mirza Néïme, avec les grands de Neïriz et le régiment Goulpaïgani vint établir son campement dans les champs dits de Béïd Nedjiriyèh qui se trouvaient juste sous le camp babi.
Les Impériaux menèrent grand bruit alors que les babis, comprenant que leur fin était proche étaient au contraire calmes et recueillis.
Mirza Néïme, après quelques jours, s'avança jusqu'à Der-è-Chikaf, tout près d'un jardin nommé Emiri et éleva un retranchement en face de celui des Religionnaires. Il en profita pour s'emparer d'une source nommée Yaqouti, qui se trouvait là et à laquelle les babis venaient s'approvisionner.
Ali Serdar, à la tête des siens, se précipita sur l'ennemi. Les fusiliers qui gardaient la source les reçurent à coups de fusils : Kerbélabi Asker, le porte-drapeau, reçu une balle à la main droite, mais il planta son drapeau dans le sol et, prenant son sabre de la main gauche, se jeta sur les musulmans.
Mirza Zéïne el Abédine, le fils de la soeur de Mirza Housseïn, prit le drapeau et se lança aussi sur les musulmans.
Ils en tuèrent un grand nombre et rentrèrent victorieux dans leur camp. Ils y arrivèrent pour y subir l'attaque des Baharlou, fameux tireurs, réputés dans toute la Perse. Les musulmans s'emparèrent des deux retranchements de Hadji Cassem et de Hadji Qoutbahi.
Les musulmans eurent le soin de cacher un certain nombre de bons tireurs dans les bois voisins et recommencèrent à mener grand tapage.
Un jour qu'ils s'amusaient à des courses de chevaux Ali Serdar sortit avec quelques compagnons et s'approcha tout doucement du camp, non sans être vu par les soldats cachés derrière les arbres. Il se présenta au moment où les cavaliers s'y attendaient le moins : aussi commencèrent-ils à fuir. Ce fut juste à ce moment que retentirent les coups de fusils des autres musulmans. Une balle vint frapper au pied Ali Serdar qui, malgré une défense courageuse, périt sous le nombre. Ses compagnons: Mirza Mohammed, fils de Molla Mouça, Agha Seyyèd Ali, Mirza Abd oul Housseïn furent tués comme lui.
Un nommé Ali, fils de Kerbélahi Bagher et frère de Tadj oud dine (240), se trouvait au sommet d'une éminence d'où son regard embrassait l'horizon. Il vit la chute d'Ali Serdar et tout pleurant, vint se jeter sur le cadavre, sur lequel on le tua.
Les musulmans coupèrent les têtes des victimes, sauf celle de Seyyèd Ali qui, la nuit venue, tout couvert de blessures, rentra au camp babi. Il ne devait être exécuté qu'à Téhéran.
Les Impériaux ne se doutaient point le moins du monde de la victoire qu’ils venaient de remporter; ce ne fut qu'au soir que les Neirizis qui accompagnaient l'armée en qualité de guides, reconnurent la tête qu'on leur présentait.
Une autre version prétend que ce fut Khan Mirza, Baharlou, qui ayant tué le chef babi, lui coupa la tête et la porta tout courant à Mirza Néïme qui lui donna une robe d'honneur et de l'argent.
Quoi qu'il en soit, les musulmans exultaient de joie. Ahmed Khan et Khan Mirza Baharlou, envoyèrent un messager aux babi pour leur dire : «Maintenant que Ali Serdar est mort, nous ne désirons plus rien de vous. Le Gouvernement voulait la tête de votre chef et le destin nous venant en aide, nous l'avons conquise. Donc, maintenant qu'il fait nuit, prenez vos femmes et vos biens et fuyez; vous ne pouvez lutter contre nous, car il ne se passe pas un jour sans que nous ne recevions mille hommes de renfort.»
Les babis répondirent : «Il est arrivé ce qui n'aurait jamais dû arriver. Vous nous témoignez votre bienveillance aujourd'hui, eh bien, si vous êtes sincères, retirez-vous, et laissez-nous enterrer nos morts.»
Le camp s'éloigna environ d'un mille et les babis purent procéder à la funèbre opération. Puis ceci fait, Méchedi Mirza Housseïn et Mirza Ahmed suggérèrent qu'il valait mieux envoyer les femmes au jardin d'Asboran, et que tous les hommes vinssent se réunir au retranchement du même nom. Ils le firent, et envoyèrent prévenir les musulmans de leur détermination de se faire tuer jusqu'au dernier.
La situation n'était pas brillante cependant, et n'allait pas tarder à empirer : les provisions étaient presque épuisées ; il restait un peu de riz, des figues et quelques ânes. Chaque jour on tuait un âne qu'on partageait entre tous et l'on donnait des figues aux femmes seules. Il n'y avait là qu'une source d'eau qui ne suffisait pas à tous les besoins, les musulmans étant restés maîtres de la source Yaqouti.
La température était devenue très froide, et les compagnons manquaient de vêtements : la poudre se faisait très rare, et les ânes mouraient faute d'eau.
Loutf Ali Khan, avec ses fusiliers et du canon, vint établir un retranchement en face de celui des sectaires ; de l'autre côté vinrent s'établir les Baharlou, et l'on se battit pendant trois jours, sans désemparer.
Les musulmans fatigués, essayèrent de la ruse et invitèrent un chef à venir causer avec eux. Molla Ali alla les trouver et revint au camp porteur de propositions de paix. Les babis ne voulurent rien entendre, et ils protestaient encore quand soudain se leva le son du clairon qui appelait les impériaux aux armes.
Ils chargèrent avec rage, ayant caché un millier des leurs derrière les arbres. Un brouillard s'éleva qui troublait la vue. Les babis sortirent contre les assaillants qui s'étaient avancés d'environ 200 pas, mais qui s'enfuirent à l'approche de l'ennemi, jusqu'à ses retranchements. Les babis les poursuivirent, et ce fut à ce moment que les soldats cachés, sortirent de leurs repaires et tombèrent sur leurs derrières, les prenant entre deux feux.
Les babis, après mille difficultés et mille souffrances, rentrèrent chez eux laissant une cinquantaine des leurs sur le carreau.
La nuit fut atroce pour eux; ils ne purent allumer de feu, et les blessés réclamaient à grands cris de l'eau chaude. Au matin, les musulmans revinrent à l'assaut, et ce fut la dernière fois. La résistance fut énergique, mais les babis succombèrent sous le nombre.
La bataille n'était pas encore terminée que les Impériaux s'occupaient déjà à se saisir des femmes. Mirza Ahmed réunit quinze de ses compagnons pour tenter un assaut désespéré ; pas un seul n'en revint.
Chose curieuse on respecta les femmes qu'on rassembla et qu'on conduisit au mont Biaban. Il y avait parmi elles deux vieillards, sans force pour se battre: Molla Mohammed Mouça, foulon, et Méchedi Bagher, teinturier. On les tua.
Méchedi Bagher fut tué par Ali Bek, capitaine des soldats neirizis. Il lui coupa la tête et la remit à un enfant : puis il prit la nièce de sa victime, lui mit sur la tête un voile noir, et montant à cheval, il la poussa jusqu'auprès de Mirza Néïme. Celui-ci se trouvait au mont Biaban, dans un jardin, assis sur une pierre. Quand Ali Bek arriva auprès de lui il lui jeta la tête de Bagher, et poussant d'un brusque coup la fillette qui tomba la face contre terre il s’écria: «Nous avons fait ce que tu voulais, lés babi n'existent plus.»
Akhound Molla Abdoul Housseïn, sur l'ordre de Mirza Néïme, eut la bouche remplie de terre ; puis un ghoulam lui tira un coup de fusil dans la tête, mais sans le tuer.
Il y eut environ 603 femmes d'arrêtées. On se mit en route avec les prisonniers jusqu'au moulin appelé Takht qui est tout près de Neïriz.
Notre auteur raconte l'anecdote suivante comme preuve de la férocité des vainqueurs :
«J'étais bien jeune, alors, dit-il, et je suivais ma mère qui avait un autre fils plus jeune que moi. Un nommé Aced Oullah avait pris mon frère sur ses épaules et le portait. L'enfant avait un chapeau avec quelques ornements. Un cavalier qui nous accompagnait, vit le chapeau, s'approcha et l'arracha avec tant de brutalité qu'il saisit en même temps le bébé par les cheveux. L'enfant alla rouler à dix mètres de là. Ma pauvre mère le trouva évanoui.»
Je ne m'appesantirai pas sur les horreurs qui suivirent cette victoire. Qu'il nous suffise de savoir que Mirza Néïme monta à cheval, précédé et suivi d'hommes portant des piques au bout desquelles étaient fichées les têtes des martyrs. On poussait les prisonniers à coups de fouets ou de sabres. On poussait les femmes dans les fossés pleins d'eau.
La nuit se passa au caravansérail Chirazi.
Le matin on fit sortir les femmes toutes nues et l'on s'amusa à les frapper à coups de pied, de pierres, de bâton, on leur crachait dessus. .
Quand on fut fatigué de ce jeu, on les conduisit à l'école de l'endroit, où elles restèrent vingt jours au milieu des insultes et des outrages.
Quatre-vingt babi liés dix par dix furent confiés à 100 soldats pour être conduits à Chiraz. Seyyèd Mir Mohammed Abd mourut de froid à Khanéguird, d'autres moururent un peu plus loin. On leur coupait la tête au fur et à mesure.
Enfin, ils entrèrent à Chiraz par la porte de Saadi. On les promena dans toute la ville, puis on les enchaîna dans la prison. `~
Les femmes furent au bout de vingt jours sorties du collège où elles avaient été enfermées et divisées en deux groupes. Un groupe fut rendu à la liberté, l'autre fut dirigé sur Chiraz avec d'autres prisonniers, hommes qui avaient été arrêtés sur ces entrefaites. Arrivée à Chiraz, la caravane fut encore divisée en deux : les femmes furent dirigées vers le caravansérail Chah mir Ali Hamzé, et les hommes allèrent rejoindre en prison leurs coreligionnaires.
Le lendemain fut un jour de fête. Le Gouverneur, assisté de tout ce que Chiraz comptait de grands et de nobles, fit comparaître devant lui les prisonniers.
Un neïrizi nommé Djelal, et que Néïme avait surnommé Boulboul, se chargeait de dénoncer ses compatriotes.
Le premier qui comparut fut Molla Abdoul Housseïn: on lui ordonna de maudire le Bab; il s'y refusa et sa tête roula sur le sol. Hadji, fils d'Asker, Ali Guermsiri, Hosseïn fils de Hadi Kheïri, Sadeq fils de Saleh, Mohammed ibn Mohcen furent exécutés.
Les femmes furent relâchées et le restant des hommes fut conduit en prison.
Le Chah ayant réclamé l'envoi des prisonniers, soixante et treize furent expédiés sur Téhéran. Vingt-deux moururent en route et parmi eux Molla Abdoul Housseïn qui mourut à Seïdan, Ali fils de Kerbélahi Zéman, à Abadèh; Akber fils de Kerbélahi Mohammed à Qenaréh ; Hassan fils d'Abdoul Vahhab, Mollah Ali Akber, à Isfahan; Kerbélahi Bagher fils de Mohammed Zéman, Hassan et son frère Zoulfékhar, Kerbélahi Naghi et Ali son fils, Véli Khan, Molla Kérim, Akber Réïs, Ghoulam Ali, fils de Pir Mohammed, Naghi et Mohammed Ali, fils de Mohammed, encours de route.
Le reste parvint à Téhéran, et le jour même de leur arrivée, quinze d'entre eux furent exécutés, entr'autres A Seyyèd Ali, celui qui avait été laissé pour mort, Kerbélahi Redjeb,le barbier; Séif ed dine, Souleïman fils de K. Selman, Djaafer, Mourad Khéïri, Hosseïn, fils de K. Bagher, Mirza Aboul Hassan, fils de Mirza Taghi, Molla Moham.med Ali fils de Agha Mehdi.
Vingt-trois personnes moururent en prison, treize furent délivrées après trois ans, le seul qui resta à. Téhéran, pour y mourir peu de temps après fut Kerbélahi Zeïne el Abédine.
=====================================
X. ATTENTAT CONTRE 'NASR-ED-DINE CHAH QADJAR
«Molla Chéikh Ali Tourchizi était une des lettres de la vie de la nouvelle manifestation (241). Il fut, par ces coreligionniaires, surnommé Hazrét Azim. C'était un élève de Seyyèd Kazem Rechti qui, devenu Babi, chercha en l'an 1267 - avant la mort du Bab - à soulever Téhéran. Il ne put y parvenir car on était alors au début du règne de Nassr ed dine Chah.»
«J'avais à peine trente ans à cette époque et, curieux de ma nature, je réunissais chez moi le plus de savants que je pouvais. Parmi ces derniers se trouvaient Mirza Habib Oullah Hékim Qa'ani, Mirza Abd-oul-Véhhab Mah'rem, Mirza Taher Chèhra, le secrétaire, Mirza Ahmed tébib Qachani, Mirza Abd-our Rahim Hérévi, Mirza Zoouqi et bien d'autres.»
«Mirza Abd-our Rahim Hérévi était philosophe, de la secte de Molla Sadra. Il venait au coucher du soleil et m'expliquait les opinions de ce philosophe.»
«Puis, la leçon finie, nous causions avec tous les savants et tous les poètes qui se trouvaient réunis chez moi.»
«C'est à cette époque qu'éclata la révolte du Bab. Ce Mirza Abd-our Réhim, ayant appris que son frère s'était fait Babi, pencha intérieurement vers cette doctrine. Il allait souvent chez Molla Cheikh Ali Tourchizi et les autres chefs babi qui se trouvaient à Téhéran. Je l'ignorais profondément, seulement, souvent, en ma présence, il médisait des oulémas, et je lui conseillai d'être plus prudent!»
«Une seule fois il me dit : «La religion du Bâb s'est révélée et vous hésitez!» Je me suis mis à rire et lui dis : «De quelle manifestation parles-tu que je ne connais pas encore?» - «Mais ne savez-vous pas, me répondit-il, que Molla Housseïn Bouchrouyéhi vaincra ses ennemis et conquerra Reï et Qoum. Et n'est-ce pas là une des preuves admises par les hadis de Medjlissi lui-même?»
«En ce moment, lui dis-je, votre Housseïn est pris dans notre armée. S'il en réchappe et reconquiert Reï et Qoum, alors nous verrons ce que j'aurai à dire.»
«Un jour, quatre heures avant e coucher du soleil, on vint m'apporter une lettre de Mirza Taghi Khan Emir Nizam Atabek de l'Empire. Son Altesse me priait de passer soit au divan Khané, soit chez elle, deux heures avant la nuit pour affaire urgente.
Je me rendis à l'heure indiquée au divan Khané et l'y trouvais. Il éloigna tous les assistants, et, tirant un papier de sa poche, il me le tendit.
Je le lus. C'était un rapport expliquant que : Vendredi prochain les babis, tous armés, ont l'intention d'envahir la Mosquée du Chah, d'y tuer Mirza Aboul Cassem Imam Djoum'èh, et ensuite, au cri de Ya Sahab-ez-Zéman, de se jeter dans l'Ark et d'y mal-traiter le Chah et ses proches. Parmi les chefs de la secte, affiliés à ce complot se trouvent : 1° Molla Cheïkh Ali Tourchizi, qui change de nom et de vêtements tous les jours ; 2° Mirza Ahmed Tèbib Qachani; 3° Mirza Abd our Rahim, frère de Molla Mohammed Taghi Hérévi. Ces deux derniers sont plus particulièrement protégés par Ali Qouli Mirza E'tézad ès Saltanèh. Si on peut les arrêter on préviendra l'explosion du mouvement.
La lecture de ce rapport me rendit songeur : L'Emir m'interpella et me dit : «Non seulement vous êtes parent de S. M., mais de plus vous êtes fonctionnaire (Ministre de l'Instruction Publique). Je ne crois pas que vous ayiez une pensée quelconque de rébellion, mais qu'au contraire vous êtes tout prêt à servir le Gouvernement.
Je protestai dé la pureté de mes croyances religieuses et lui dis : «Voici mon histoire avec ces trois personnages. Le Tébib Qachani est un médecin sûr, et c'est d'ailleurs celui de la mère du Chah. Il est parmi les notables, et qui plus est, les oulémas de Qachan. Son père est Molla Riza Kétabi, et sa mère la nièce de Hadji Mollah Mohammed Poucht Méchhèdi. J'en jure par Dieu je ne l'ai jamais entendu prononcer le nom du Bab. Mirza Abd our Rahim Herévi parlait ou plutôt faisait allusion à la nouvelle religion. Quant à Molla Chéikh Ali, je ne le connais nullement et ne sais même qui il peut être.
Alors l'Atabek me regarda d'un air irrité et me dit: «Ce que vous dites n'est pas une réponse. Ce rapport ne ment pas et dit ce qu'il veut dire. Dans ces conditions j'exige que vous me livriez ces trois hommes.» Il dit et se leva.
Je l'accompagnai dehors pour me justifier en lui jurant que je ne connaissais pas Molla Cheikh Ali, mais il me laissa parler sans me répondre. Au moment où je le quittais il me dit seulement: «N'oubliez pas ce que j'exige de vous.»
Je rentrais chez moi fort irrité et mes réflexions m'empêchèrent de dormir. Le lendemain, de fort bonne heure je reçus une lettre de l'Atabek me disant : «Hâtez-vous de faire ce que je veux.» Obsédé par de tristes idées, je sortis de bon matin de mon lit et me rendis à mon appartement des hommes où je m'assis en silence. Mirza Taher, le secrétaire me demanda la cause de mon air mélancolique et je la lui dis. Il me réconforta en m'expliquant que Molla Cheikh Ali, Azim, était à Téhéran et même y prêchait. Mais il change, me dit-il, presque chaque jour de nom comme de vêtements. Pendant quelque temps il était de vos voisins ; mais il a disparu de sa maison et l'on ne sait où il demeure maintenant. Certainement Mirza Abd our Rahim le sait.
Nous étions ainsi en train de causer quand la porte s'ouvrit laissant passage à Mirza Abd our Rabim. Il voulut venir près de moi, mais comme je restais immobile, il s'assit dans un coin de la salle. A peine fut-il assis que je donnai l'ordre au secrétaire de le mettre en état d'arrestation. Je lui demandais alors la demeure de Azim mais il refusa de répondre et jura, en mentant, qu'il ne la connaissait pas. J'eus beau le couvrir d'injures, je ne pus rien tirer de lui. ,
Alors je tins conseil avec le secrétaire qui s'avisa d'une ruse. Il écrivit une lettre, en contrefaisant l'écriture du prisonnier, à Mirza Seyyèd Mohammed Isfahani, babi célèbre qui se trouvait à ce moment là à la Médressè Dar-ouch-Chéfa, en lui demandant l'adresse que nous désirions.
Mirza Seyyèd Mohammed répondit en s'étonnant d'une pareille question. Hier même, écrivait-il, Molla Chéikh Ali est allé avec vous chez Mirza Mohammed, sous-directeur de la poste, à Senguéledj. Vous savez bien que c'est-là qu'il demeure.
A la réception de cette lettre j'écrivis aussitôt à l'Atabek qui me répondit en m'excusant de ses soupçons, en pardonnant à Mirza Ahmed le tébib Kachani, mais en m'ordonnant de parfaire mon oeuvre».
«Donc, trois heures avant le coucher du soleil, j'envoyai le secrétaire avec vingt hommes à la maison du sous-directeur des postes. Il rencontra un homme monté sur un iabou (242). Il le fit arrêter, puis il entra dans la maison, mais ne put trouver trace de celui qu'il cherchait. Il ferma la maison, mit des sentinelles dans le couloir d'entrée, et vint me rendre compte de sa mission: Il m'annonça en même temps que l'individu qu'il avait arrêté était Mohammed Housseïn Tourk, serviteur de Chèikh Ali. Je le fis venir, nous le fouillâmes et le trouvâmes porteur d'une magnifique poustine, de souliers neufs, de divers ustensiles de cuivre, et de quelques écrits insanes du Bab. Nous eûmes beau l'interroger sur son maître, il ne voulut pas répondre. Je le torturais presque jusqu'au point de le tuer, cela ne servit de rien (243).
» J'envoyai des cavaliers de tous les côtés, j'écrivis entr'autres au Daroga de Chahzadè Abd oul Azim. Cette nuit même on arrêta et on m'amena un persan natif de Maragha qu'on avait trouvé porteur d'une lettre de Chèikh Ali pour Molla Mohammed Ali Zendjani. Je le fis mettre en prison et prévins l'Atabek de ce qui s'était passé.
» Mais ces arrestations et d'autres avaient jeté l'alarme parmi les babis. On exécuta tous ceux qui furent arrêtés sur la place de l'Ark et l'on me réclama Rahim, le Turc, et l'homme de Maragha. Je les remis aux fonctionnaires du Divan et me rendis auprès de l'Atabek pour intercéder auprès de lui en faveur de Rahim qui avait été mon professeur. J'allai même voir le Chah, ce qui fit que seuls l'homme de Maragha et Mohammed Housseïn le Turc furent exécutés.»
Comme on le voit, la persécution continuait acharnée et impitoyable. Je ne sais si le Gouvernement put trouver des preuves suffisantes de la culpabilité des malheureux suppliciés, mais cela ne l'empêcha pas de les mettre à mort. De tous les côtés, la haine, l'envie dépassant les bornes donnaient de l'ouvrage au bourreau.
En 1267, suivant le Nacikh et Tévarikh une troupe de babi se réunirent à Isfahan dans le but de «soulever la ville». Ils choisirent, dit l'auteur musulman, douze d'entre eux et leur donnèrent les noms des douze imams. Tchéragh Ali Khan, gouverneur intérimaire fut prévenu de ces menées. Il fit arrêter tous les babis qu'il put trouver, les fit comparaître devant les oulémas, et, comme ils refusaient de renier leurs idées, il les fit conduire sur la place Naqch-i-Djéhan et les fit -exécuter.
Cette justice sommaire eut les conséquences qu'elle devait avoir.
Molla Cheikh Ali qui avait fui de Tébéran, nous verrons ensuite dans quelles circonstances, revint dans la capitale après la destitution de l'Atabek. Il alla habiter la maison de Hadji Soléïman Khan Tébrizi, fils de Yahya Khan, le même que nous avons vu à Tauris [Tabriz] intervenir pour sauver le cadavre du Bab. Les sectaires habitant Téhéran prirent l'habitude de se réunir chez Soleïman Khan, et l'on y discutait les questions intéressant l'existence même de la doctrine. Les esprits échauffés n'avaient vraiment pas besoin de l'excitation que leur apportait chaque jour l'avis d'une nouvelle exaction ou d'une nouvelle injustice.
Tant il y a que bientôt on agita la question de tuer le Chah pour se venger tant de l'exécution du Bab que des massacres presque quotidiens des gens de sa religion. Si l'on réussissait, l'on pouvait tout attendre d'un changement de règne, au cas contraire, du moins aurait-on donné aux sphères gouvernementales une haute idée de la vitalité de la secte qu'on persécutait. Mollah Cheikh Ali demanda dès lors quels étaient ceux qui méprisaient suffisamment leur vie pour tenter cette grande oeuvre. Le premier qui se présenta fut son domestique, Mohammed Sadeq, puis Mirza Abd oul Vahhab Chirazi, Mollah Fath Oullah Qoumi, et enfin Mohainmed Bagher Nedjef Abadi. Douze autres jurèrent encore de se consacrer au voeu de la majorité.
Mollah Cheikh Ali les arma et ils sortirent de Téhéran, se dirigeant vers le Campement royal de Niavéran. Ils attendirent ainsi jusqu'au Dimanche 18 du mois de Chevval.
Ce jour-là Sa Majesté avait décidé d'aller à la chasse et dès le matin on tira le canon pour prévenir ceux qui avaient à accompagner le Chah. Deux heures et demie après le lever du soleil, celui-ci sortit de ses appartements. Aced Oullah Khan, Mir Akhor, saisit l'étrier et S. M. monta à cheval en s'appuyant légèrement sur lui. Le Sadr A'azam, Nizam el Moulk, Moustofi el Memalek, Mohammed Nacer Khan Ichèq Aghaci, Aced Oullah Khan Mir Akhor, accompagnèrent quelques pas le Souverain. Celui-ci se retournant permit au Sadr A'azam un peu souffrant de rentrer chez lui. Ce fut à ce moment que les babis apparurent : Ils étaient trois. L'un d'eux, qui étaient de Néïriz accourut vers le Chah en criant: «J'ai une supplique, ô Souverain !» Il y avait à ce moment fort peu de monde autour de Nassr-ed-dine ; les grands qui l'accompagnaient étaient dépourvus d'armes, les cavaliers de l'escorte étaient ou très avant ou très arrière. Les domestiques voyant que cet individu semblait ignorer les usages se précipitèrent vers lui et lui dirent : «Reste où tu es et dis ce que tu as à dire.» Celui-ci comprenant qu'on ne le laisserait pas avancer davantage mit la main dans sa poche, en sortit un revolver et tira clans la direction de son impériale victime. La balle s'égara mais le trouble s'empara des serviteurs stupéfaits. Juste à ce moment, le second babi se précipita et tira sur le Chah ; mais fort heureusement un des serviteurs le poussa à cet instant même et de nouveau la balle alla se perdre.
Un des domestiques, porteur par hasard d'un couteau, le sortit de sa gaine et frappa le premier agresseur à la bouche. Celui-ci laissa du coup tomber son arme, mais, se reprenant aussitôt il tira son poignard, se jetant dans la direction du Chah: il blessa plusieurs personnes dans sa route, qu'il ne put achever, succombant bientôt aux coups qui pleuvaient sur lui.
Pendant ce temps, un troisième babi se dressa devant le cheval du Roi, et visant Sa Majesté il tira. Le cheval fit un écart, tiré d'ailleurs par son cavalier. Celui-ci fut atteint d'une dizaine de chevrotines qui pénétrèrent à peine sous la peau, le reste de la charge passant par dessus l'épaule. Les gens de la suite se jetèrent sur l'agresseur et se saisirent de lui.
On arrêta ainsi deux assassins : quant au troisième qui avait été tué, on lui mit une corde au pied et on le traîna à travers la ville.
Le Sadr A'azam, aussitôt prévenu se précipita au milieu du tumulte et saisissant la bride de la monture royale, fit descendre S. M. qui rentra au Palais,
Dans un événement aussi considérable, dit l'auteur du Nacikh-et-Tévarikh, il était nécessaire que les grands du royaume abandonnassent leurs querelles et leur malveillance. Mais rien ne put prévaloir contre leur folie et ils s'en vinrent entourer le Chah de leurs doléances malveillantes. «Hier soir, disaient-ils, le Sadr s'est rencontré avec le Serdar Hassan Khan Irévani, sous le prétexte de parler des affaires de Yezd et de Kerman. Toute la nuit s'est passée en discussions secrètes, et il est hors de doute que ce qui s'est passé ne soit leur oeuvre. S'il n'en était pas ainsi, comment des gueux comme ceux que nous avons vus, pourraient-ils former le projet de tuer leur Sultan?»
Ces paroles influencèrent l'esprit du Chah qui se montra très froid vis-à-vis de son Premier Ministre. Celui-ci, prévenu de ces agissements, ne vit d'autre moyen que de s'occuper activement de l'affaire : c'est dire que tout ce qui était babi était voué à la mort.
En effet, le lendemain le Chah donna une audience publique à laquelle la foule accourut.
Ceci fait, on chargea Aziz Khan, adjudant bachi, le Kélanter de la ville et la police de faire partout des investigations sévères et de se saisir de quiconque serait suspect.
Vers la fin du mois, Hadji Ali Khan Adjaib ed Dowlèh fut prévenu que leur lieu de réunion était la maison de Souleïman Khan. Il en avisa Sa Majesté et le Sadr A'azam fit cerner l'endroit qui lui était indiqué. «Les babis étaient en train de boire du vin et la femme du maître de la maison était l'échanson du festin, disent tous les historiens musulmans sans se rendre compte de ce que leur mensonge a d'odieux.» Mais les précautions étaient bien prises et dès la première alerte la plupart des assistants s'étaient enfui par les toits et les terrasses. On arrêta seulement Souleïman Khan et douze babi, qui furent conduits enchaînés à Niaveran. Le Sadr A'azam interpella vivement le principal de ces personnages en ces termes : «Il faut que tu sois bâtard, et certes, tu mérites tous les supplices. N'est-ce donc pas toi, dont la chair et la peau, par ton père et ta mère, proviennent du pain et du sel de S. M. Que n'a-t-il dépensé pour ton père Yahya, pour ton frère Ferroukh! Et c'est ton frère que les babis ont tué à Zendjan! mais si tu étais son frère, si son père était ton père, pourquoi n'as-tu pas appliqué aux babi la loi du sang?»
Ce discours laissa Soleïman Khan parfaitement froid, et il fut emprisonné avec ses compagnons, qui torturés de diverses façons, finirent par dénoncer trente-six des leurs.
Molla Cheikh Ali fut arrêté à son tour à Evine, par les soins de l'Adjaib ed Dowlèh et conduit en présence du Sadr A'azam qui le reconnut pour le même individu qui était venu à Qachan afin de tâcher de l'attirer au babisme. Irrité, il ordonna à Hadjaib ed Dowlèh de lui couper les oreilles. Celui-ci exécuta l'ordre avec son canif. Alors le Sadr dit : «Et maintenant, ô maître de prodiges! recolle tes oreilles à leur place !»
«Il fut donc emprisonné dans l'une des chambres du palais de Niavéran, et enchaîné avec une chaîne dont le clou était planté dans le corridor. Or, il se trouva, dit l'auteur du Moutanabiyn, que je vins voir le Chah ce jour-là. En cours de route je rencontrai le Sadr qui me dit: «Votre ami est arrêté, n'avez-vous pas envie de le voir?» - «De qui voulez-vous parler, luis dis-je tout surpris». - «De Molla Cheikh Ali, Hâzret Azim.»
«Certes, dis-je, j'ai le plus vif désir de le voir.» Alors il commanda aux ferrachs ne me laisser approcher du prisonnier. Je priai Mirza Hachem et Ghoulam Hosseïn Khan de venir avec moi, ce qu'ils acceptèrent aussitôt. •
» Je vis un homme enchaîné, les oreilles coupées. Il salua et je répondis selon l'usage. Puis il me demanda: «Me connais-tu?»- «Non, mais moi je suis Ali Qouli Mirza.» - «Oui, me dit-il, je t'ai reconnu pour celui chez qui allait Mirza Rahim.» «- J'ai quelque chose à te demander devant ces deux témoins, mais je te prie de dire sincèrement la vérité». -»Si près de la mort, ce n'est plus le lieu de ruser ou de mentir.»-»Je lui dis alors : j'avais ordre de t'arrêter et j'ai fait tout au monde pour cela: j'ai même arrêté ton serviteur Housseïn, comment as-tu pu t'échapper?»
» Il me répondit: «Quand Mirza Taher et tes hommes ont arrêté Houssein, j'étais là, dans la rue. Je compris de quoi il s'agissait et tout tranquillement je pris la première rue qui s'offrait. J'allais ainsi à pied jusqu'à Chahzadé Abdoul Azim. Je me réfugiai dans la maison du Darogha Ismaïl. Un cavalier, porteur d'une lettre de votre part arriva. Ismaïl lui demanda :«Quelles nouvelles ?» Celui-ci répondit: «Le Prince sur l'ordre du Chah fait arrêter les Turcs, et c'est pour cela que je suis ici.» Votre, serviteur était un imbécile : voyant qu'on avait arrêté mon domestique qui était Turc, il en concluait qu'on allait arrêter tous les Turcs.
» Il se rencontra que le Darogha ne savait pas lire : il me passa la lettre et je la lus. Je vis que vous donniez l'ordre de m'arrêter si je me trouvais à Chahzadé Abdoul Azim. Je lus donc à haute voix tout autre chose que ce qu'il y avait dans la lettre et, quelque temps après, m'étant levé je me rendis à la maison de Mohammed Ali Nadjar. Mais, pensant que le Darogha mis au courant de la fraude dont j'avais usé à son égard, penserait immédiatement que c'était moi qu'il avait l'ordre d'arrêter, je rentrai à Téhéran où, pendant trois jours je me cachai chez un boulanger babi. De là je me rendis à l'imam Zadé Hassan où je restais cinq jours avant de me rendre en Azerbaidjan. Je ne revins à Téhéran qu'après la destitution de Mirza Taghi Khan.»
=====================================
XI. EXÉCUTIONS DE BABI APRÈS L’ATTENTAT CONTRE LE CHAH EN 1852
AMBASSADE DE France, Thérapia, le 25 oct. 1852,
CONSTANTINOPLE
Direction Politique
MONSIEUR LE MINISTRE,
J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint la traduction fidèle d'un article du Journal Officiel Persan, rendant compte des dernières exécutions qui ont eu lieu à Téhéran à la suite du dernier attentat commis contre la vie du Chah. Cet article peut avoir de l'intérêt pour V. E.; il lui donnera dans tous les cas, une idée de la barbarie dans laquelle se trouve encore plongé ce malheureux pays.
Veuillez agréer, etc.
Signé : LAVALETTE.
Traduction d'un article du Journal Officiel de Téhéran relatif à l'attentat commis sur la personne du Roi.
Dans notre précédent numéro, en rendant sommairement compte de l'attentat commis sur la personne du Roi, nous avons promis à nos lecteurs de les entretenir des suites de cette épouvantable affaire, et de leur faire connaître le résultat de l'enquête qui se préparait pour découvrir le moteur de cette vaste conspiration dirigée non seulement contre la vie de notre souverain bien-aimé, mais encore contre la tranquillité publique, contre la propriété, contre la vie des vrais musulmans, car, le véritable but de ces malfaiteurs était, en se débarrassant de la personne du Roi, de s'emparer du pouvoir, et, par ce moyen détestable, de faire enfin triompher leur abominable cause en forçant, par les armes et la dévastation, les bons musulmans à embrasser leur infâme religion qui est autre que celle descendue du Ciel et qui ne s'accorde ni avec la philosophie ni avec la raison humaine, qui est, enfin, la plus épouvantable hérésie dont on ait jamais entendu parler, ainsi qu'il appert de plusieurs de leurs ouvrages et écrits que nous avons pu nous procurer.
Le fondateur de cette abominable secte, qui a commencé à propager ses détestables doctrines il y a quelques années seulement, et qui, tombé entre les mains du pouvoir, fut immédiatement fusillé, s'appelait Ali Mohammed et s'était donné le surnom de Bab, voulant donner à entendre par là que les clefs du Paradis étaient entre ses mains. Après la mort du Bab, ses disciples se réunirent bientôt sous les ordres d'un autre chef, Cheikh de Tùrchiz, qui se faisait passer pour le Naïeb (vicaire) du Bab, et qui s'était imposé le devoir de vivre dans la plus complète solitude, ne se montrant à personne et n'accordant qu'à de rares intervalles quelques audiences aux principaux de ses sectateurs, qui regardaient cette faveur comme la plus grande que le Ciel pût leur accorder. Il s'était donné le surnom de Hazrèt Azim. Parmi les personnes qu'il s'était attachées nous citerons en première ligne Hadji Soleïman Khan, fils de feu Yahyah Khan de Tauris [Tabriz]. C'est dans la maison de ce Soleïman Khan, située à Téhéran, dans le quartier de Ser-è-Tchechmé que se réunissaient les principaux babi pour délibérer sur leurs détestables projets. Douze d'entre eux qui ont paru plus zélés et plus déterminés que les autres furent choisis par Hazrèt Azim qui leur fit donner les armes nécessaires pour exécuter le grand acte qu'il croyait immanquable. Pistolets, poignards, coutelas, rien ne fut épargné et, armés de la sorte, il leur semblait impossible de manquer leur coup.
Il leur fut recommandé de se tenir aux environs de Niavéran et d'attendre un moment favorable. Nous nous bornerons ici à renvoyer nos lecteurs à notre précédent numéro. Ils y verront comment trois de ces insensés ont profité de la circonstance qui s'est présentée le dimanche du 28 chavval, au moment où S. M. étant sortie de la ville se dirigeait avec sa suite ordinaire du côté du village où elle a l'habitude d'aller faire ses parties de chasse ; ils y verront comment ils se sont précipités sur le Roi, l'un après l'autre, en tirant chacun un coup de pistolet presque à bout portant sur S.M; comment l'un d'eux fut immédiatement massacré par des gens d'un zèle et d'un dévouement bien connus, tels que Assad-Oullad-Khan, premier écuyer du Roi, Moustofi el-Memalek, Nizam ol Molk, le Kéchitchi bachi et d'autres personnes qui se trouvaient auprès de S. M; comment enfin les deux autres furent saisis et jetés dans les prisons de la ville.
On procéda immédiatement à une enquête dont furent chargés l'adjudant bachi Hadjeb-ed-Dowléh, le Kelenter, ministre de la police, et les Ked Khodas de la ville.
Grâce au zèle et à l'activité qu'ils déployèrent dans leurs perquisitions ils ne tardèrent pas à apprendre que la maison de Soleïman Khan servait de lieu de réunion à ces misérables. Elle fut immédiatement cernée de tous côtés ; mais, soit négligence de la part des gens de Hadjeb-ed-Dowlèh, soit manque d'ensemble dans l'exécution de cette entreprise, on ne parvint à en saisir que douze, y compris Soleïman Khan. Les autres parvinrent à se sauver, on ne sait trop comment, mais leurs complices, en ayant nommé plusieurs, la police, il faut l'espérer, ne tardera pas à être sur leurs traces.
Du reste, il ne se passait pas un jour sans que l'adjudant bachi, ou le calenter, ou les ferraches du Roi ne se rendissent maîtres de trois, quatre et même cinq babi qu'ils s'empressaient de faire comparaître devant le divan Impérial, qui, en pareille occurrence, se tient en public. Ils étaient interrogés sur le champ et condamnés sur leurs propres dépositions ainsi que sur la dénonciation de leurs complices, qu'on avait également soin de faire comparaître en même temps qu'eux. On procéda à ces interrogatoires selon l'usage et d'après les formes exigées par la loi.
Nous ne devons pas omettre ici de rappeler l'immense service que Hadjeb-ed-Dowlèh a rendu à la Foi à l'État et à la religion en se rendant maître de Molla Cheikh Ali, malgré tous les soins que celui-ci prenait pour ne point se montrer en public, et malgré la vie retirée et presque inconnue qu'il n'a cessé de mener jusqu'au moment de son arrestation.
En s'enfuyant de la ville, il avait cru se mettre à l'abri de toute poursuite et s'était réfugié dans une petite maison à Evine (Chimran). Il y vivait, entouré de quelques-uns de ses fidèles disciples qui, comme lui, étaient parvenus à se sauver de la maison de Soleïman Khan au moment où on la cernait. C'est dans cette maison que Hadjeb-ed-Dowlèh, accompagné de ses gens alla les surprendre au moment où ils s'y attendaient le moins. Ils furent tous saisis, garottés et jetés dans les prisons de la ville. S. E. le premier Ministre, Mirza Agha Khan, voulut se donner la satisfaction d'interroger lui-même le chef d'une si détestable secte.
Il le fit donc comparaître devant lui ainsi que ses disciples pris en même temps que ce misérable et le questionna en leur présence. Molla Cheikh Ali n'essaya pas de se défendre. Il avoua qu'il était devenu le chef des babis depuis la mort Bab, que c'était lui qui avait donné l'ordre à ses disciples les plus dévoués de tuer le Roi. Il déclara même que le nommé Mohammed Sadeq, qui s'était précipité le premier sur le Roi, était son serviteur de confiance et qu'il lui avait donné lui-même les armes nécessaires pour exécuter ses projets régicides.
Le nombre de ces misérables tombés entre les mains de la justice ne s'élève qu'au chiffre de trente-deux ; quant aux autres, la police n'a pu les retrouver et l'on présume qu'ils auront franchi les frontières de la Perse pour aller traîner leur misérable vie à l'étranger.
Nous nous faisons un devoir de rendre compte à nos lecteurs de la conduite admirable de S. E. M. le Ministre de Russie dans cette circonstance. Un de ces misérables conspirateurs, Mirza Housseïn Ali, s'était réfugié à Zerguendèh, résidence d'été de la Légation de Russie. Le Prince Dolgorouki ayant appris que cet individu était au nombre des conspirateurs s'empressa de le faire saisir par ses propres gens et l'envoya aux Ministres de S. M. qui, touchés d'une action aussi conforme aux bonnes relations qui existent entre la Perse et la Russie, lui en témoignèrent leur profonde gratitude. S. M. elle-même lui en fit faire ses remerciements et donna des ordres pour que les personnes qui avaient été chargées d'amener le coupable, fussent dignement récompensées, ce qui fut fait sans aucun retard.
Parmi les babis tombés aux mains de la justice, il y en a six dont la culpabilité n'ayant pas été bien constatée, ont été condamnés aux galères à perpétuité. Les autres furent tous massacrés de la façon suivante
Molla Cheikh Ali, le principal moteur de cet épouvantable conspiration a été condamné à mort par les oulémas et par eux mis à mort. Séyyèd Housseïn Khoraçani fut tué par les Princes du Sang qui le massacrèrent à coups de pistolets, à coups de sabres, à coups de coutelas et à coups de poignards.
Moustofi el Memalek se chargea de l'exécution de Molla Zeïne el Abédine Yezdi, qu'il tua d'un coup de pistolet à bout portant. Après quoi les Moustofi du Divan; se précipitant sur le cadavre le hachèrent à coups de pistolets plusieurs fois répétés, à coups de sabres, de poignards et autres instruments tranchants.
Molla Housseïn Khoraçani fut tué par Mirza Kazem Nizam el Moulk et par Mirza Saïd Khan, ministre des Affaires Étrangères. Mirza Kazem s'approcha le premier du condamné, lui lâcha un coup de pistolet à bout portant, puis Mirza Saïd Khan s'approcha à son tour et lui tira un autre coup de pistolet. Enfin, les domestiques de ces deux hauts fonctionnaires se jetèrent sur le cadavre qu'ils mirent en pièces à coups de qamahs et à coups de poignards.
Mirza Abd-oul Véhhab de Chiraz, qui pendant son séjour à Kazemëin s’était déjà rendu coupable envers l'autorité en exhortant à la révolte les paisibles habitants de cette ville, a été mis à mort par Djaafer Kouli Khan, frère de S. E. le premier Ministre, par Zoulfékhar Khan, par Mouça Khan, par Mirza Ali Khan, tous les trois fils du premier Ministre, par leurs employés et leurs domestiques, par les fusiliers du Roi et par d'autres personnes présentes à cette exécution : les unes faisant usage de pistolets, d'autres de fusils, d'autres de qamahs, d'autres enfin de poignards de toute espèce. Le cadavre de ce misérable ne tarda pas à être réduit en petits morceaux.
Molla Fath Oullah fils de Molla Ali le relieur, celui qui, tirant sur le Roi avec un pistolet chargé à plomb avait légèrement blessé S. M., eut le corps garni de chandelles allumées. Puis Hadjèb ed Dowlèh reçut l'ordre de le tuer d'un coup de pistolet, ce qu'il fit en tirant juste à la partie du corps où S. M. avait été atteinte. Il tomba raide mort. Alors les ferraches du Roi, se précipitant à l'envie l'un de l'autre sur le cadavre le réduisirent bientôt en lambeaux qu'ils couvrirent ensuite d'une grêle de pierres.
Chèikh Abbas de Téhéran a été expédié au fond des enfers par les Khans et autres dignitaires de l'Empire qui le tuèrent à coups de pistolets et à coups de sabres.
Mohammed Bagher de Nedjef, qui avoua s'être trouvé dans tous les combats soutenus par les babis contre les troupes royales, fut mis à mort, à coups de qamahs et de poignards par les chambellans et les valets de chambre du Roi.
Mohammed Tamhi de Chiraz fut d'abord ferré comme un cheval par Aced Oullah Khan, premier écuyer de S. M. et par les employés des écuries impériales. Puis on le massacra à coups de massues, à coups de ces grands clous en fer dont on se sert dans les écuries pour fixer au sol les licous des chevaux.
Mohammed de Nedjef abad fut tué à coups de hache par le Ichiq Aghaci Bachi, par le chef des crieurs et par d'autres personnages de l'entourage du Roi.
Mirza Mohammed de Tauris [Tabriz] qui s'était, à plusieurs reprises battu avec les babis contre les troupes impériales et qui, dans ces batailles reçut plusieurs blessures fut fusillé par les goulams du Roi et le Serkéchiqtchi bachi. Puis son corps fut mis en bouillie à coups de massues et de pierres par les capitaines de l'armée et par les valets de pied de S. M.
Mohammed Ali de Nedjef Abad fut livré aux artilleurs qui lui arrachèrent d'abord un oeil. Ceci fait, ils l'attachèrent à la bouche d'un mortier chargé à mitraille et le «soufflèrent».
Quant à Hadji Soléïman Khan, fils de Yahya Khan de Tauris [Tabriz], et Hadji Cassem, également Tébrizi, ils furent promenés à travers toute la ville de Téhéran le corps garni de chandelles allumées, accompagnés de danseurs, de la musique du soir qui se compose de longues trompettes et d'immenses tambours, et suivis d'une foule de curieux tentés de les lapider, ce que le ferrach bachi eut beaucoup de peine à empêcher. (244) Une fois hors de la ville les ferraches, suivant l'ordre qui leur avait été donné, partagèrent ces deux misérables en quatre morceaux chacun, qu'ils suspendirent à chaque porte de la ville.
Séyyèd Houssein de Yezd fut mis à mort à coups de sabres par l'adjudant bachi et par les colonels de l'armée impériale.
Agha Mehdi de Qachan fut livré aux ferrachs qui le hachèrent à coups de poignards.
Le corps de Sadeq Zendjani qui fut tué le jour même de l'attentat, fut coupé en morceaux qu'on suspendit aux portes de la ville.
Mirza Nebi Démavendi fut tué à coups de lances et de sabres par les Professeurs de l'École des Sciences.
Mirza Réfi de Nour fut tué à coup de pistolet et de sabres par une compagnie de cavalerie régulière. Mirza Mahmoud de Casvne fut livré, aux Zembourektchis qui, après avoir tiré sur lui plusieurs coups de zemboureks le hachèrent à coups de sabres.
Housseïn de Milaun fut tué à coups de bayonnettes par un peloton d'infanterie.
Mollah Abd oul Kérim de Casvine fut tué à coups de sabres par les artilleurs commis à la, garde du Roi.
Loutf Ali de Chiraz, coureur du Roi, échut aux «chaters» qui le poignardèrent puis le lapidèrent.
Nedjef du Khamcèh fut livré à la fureur de la populace qui le mit en lambeaux à coups de poing, de pierres et de bâtons.
Hadji Mirza Djani, négociant de Qachan fut tué par le Prévôt des marchands de Téhéran, assisté des marchands et des boutiquiers de Téhhran.
Hassan du Khamcèh fut tué par Nassr Oullah Khan, chef de l'arsenal et par ses employés.
Mohammed Bagher fut tué à coups de sabres par les Kadjars.
Pour traduction conforme,
J.B NICOLAS
Constantinople, le 19 octobre 1852
=====================================
XII. EXECUTION DE QOURRET–OUL-AINE
Il est certain que Qourrèt-oul-Aïne était rentrée à Casvine (245), puisque ce fut là qu'on l'arrêta pour l'amener à Téhéran où elle fut emprisonnée dans la maison de Mahmoud Khan, Calenter.
Elle y resta longtemps, recevant de nombreuses visites tant d'hommes que de femmes : elle passionnait ces dernières en leur démontrant le rôle abject que l'islam leur assignait : elle les séduisait en leur démontrant la liberté et le respect que la nouvelle religion leur accordait, et il y eut bien des scènes de ménage dont les maris ne sortirent pas toujours vainqueurs.
Ces discussions eussent pu durer longtemps si Mirza Agha Khan Nouri n'avait pas été nommé Sadr A'azam. Le premier ministre, en effet, donna l'ordre à Hadji Molla Mirza Mohammed Endermani et à Hadji Molla Ali Kéni d'aller la voir pour examiner ses croyances. Il y eut sept conférences entre les deux hommes et la prisonnière : elle y discuta avec passion et affirma que le Bab était l'imam promis et attendu. Ses adversaires lui firent alors remarquer qu'en vertu des prophéties, l'imam promis devait venir de Djab oul Qa et de Djab oul Sa. Elle leur répondit violemment que cela était faux et inventé par de faux traditionnistes; que ces deux villes n'existaient pas et que ce ne pouvait être là qu'une superstition digne d'un cerveau maladif. Elle exposa la nouvelle doctrine, en fit ressortir la vérité, mais se heurtait toujours au même argument du Djab oul Qa. Impatientée, elle leur dit: «Les raisonnement que vous tenez sont d'un enfant ignare et stupide. Jusques à quand vous arrêterez-vous à ces insanités, à ces mensonges : Quand donc élèverez-vous vos regards jusqu'au Soleil de la Vérité.»
Outré du bIasphème, Hadji Molla Ali se leva et entraîna son compagnon en lui disant : «Quelles discussions plus longues pouvons-nous avoir avec une infidèle.» Ils se rendirent chez l'un d'eux et rédigèrent la sentence qui, constatant son apostasie et son refus d'en faire pénitence, la condamnait à mort au nom du Qoran !
Une des femmes, domestique musulmane de la maison du Qalenter raconte ainsi le séjour qu'y fit Qourrèt-oul-Aïne : «La prisonnière se levait au moment du Séhèr (un peu avant l'aube) alors que tous dormaient encore. Elle faisait ses ablutions tout en chantant à mi-voix des prières et des oraisons jaculatoires. Le jour elle ne sortait jamais de sa chambre qu'elle tenait dans une propreté scrupuleuse. Personne n'était admis auprès d'elle sans avoir d'abord obtenu sa permission. Seule, elle était toujours soigneusement vêtue et se tenait comme si elle se trouvait au milieu d'une assemblée sans jamais le moindre laisser-aller. Parfois elle se levait et marchait dans sa chambre en priant. Les femmes qui venaient la voir, après en avoir obtenu congé, subissaient toutes le charme de sa beauté et de son éloquence : elles restaient subjuguées et transportées d'admiration.»
Pendant qu'elle était prisonnière, eut lieu dans la maison le mariage du fils du Qalenter. Toutes les femmes des grands personnages s'y trouvèrent naturellement conviées. Mais, quoiqu'on eût fait de grandes dépenses pour réunir tous, les divertissements usités en la circonstance, elles réclamèrent à grands cris qu'on fit venir Qourrèt oul Aïne. A peine celle-ci se fut-elle présentée et eut-elle commencé à parler qu'on renvoya musiciennes et danseuses, et qu'oubliant toutes les sucreries dont elles sont si friandes, ces dames n'eurent plus de regards et d'attention que pour Qourrèt oul Aïne.»
«Enfin, une nuit elle sortit de sa chambre ainsi qu'elle faisait d'habitude. J'étais éveillée et je la vis aller dans la cour où elle se lava tout le corps, puis elle rentra dans sa chambre où elle revêtit des vêtements entièrement blancs. Elle se parfuma tout en chantant, de telle sorte que je ne l'avais jamais vue si contente et si joyeuse. Elle vit toutes les femmes qui habitaient la maison et les pria de lui pardonner les désagréments que sa présence avait pu leur occasionner et les fautes qu'elle aurait pu commettre envers elles : elle agit, en un mot, exactement comme quelqu'un qui va entreprendre un grand voyage. Nous étions toutes surprises, nous demandant ce que cela voulait dire. Le soir venu, elle s'enveloppa d'un tchadour qu'elle fixa à sa taille en se faisant une ceinture de son tcharqad, puis elle revêtit son tchagchour. Sa joie, en agissant ainsi était tellement étrange que nous nous mîmes à pleurer, car nous l'aimions pour sa bonté et son inépuisable bienveillance. Mais elle nous sourit et nous dit : «Je vais faire ce soir un grand, un bien grand voyage.» En ce moment on frappa à la porte de la rue: «Courez ouvrir, dit-elle, car c'est moi que l'on vient chercher.»
«Ce fut le Kélanter qui entra. Il pénétra jusqu'à sa chambre et lui dit: «Venez, Madame, car on vous demande.» - «Oui, dit-elle, je le sais. Je sais où l'on va me conduire, je sais ce que l'on va faire de moi. Mais, songes-y bien, un jour viendra où ton maître te fera tuer à ton tour.»
Cette prédiction devait se réaliser à bref délai.
«Elle sortit donc avec le Qélanter, vêtue comme elle l'était: nous ne savions où on la conduisait et n'apprîmes que le lendemain qu'on l'avait exécutée.»
L'un des neveux du qélanter donne les détails suivants sur la mort de Qourrèt-oul-Aïne : «Quand la sentence juridique de Hadji Molla Mirza Mohammed Endermani et de Hadji Molla Ali Kéni, condamnant l'apôtre babie à la peine de mort eut été remise au Chah, S. M. en ordonna l'exécution.
Le secret fut bien gardé et n'était connu que de deux fonctionnaires du Gouvernement. Déjà depuis quelques jours mon oncle m'avait donné l'ordre de surveiller attentivement la police et de m'assurer, par des patrouilles fréquentes que nos policiers étaient bien à leurs postes. On publia la défense expresse aux habitants de rester dans les rues plus tard que trois heures après le coucher du soleil, heure après laquelle il était interdit à quiconque de sortir de chez soi. Cette nuit-là je reçus l'ordre d'établir un cordon de policiers depuis la maison de Qalenter jusqu'au jardin d'Ilkhani. Je dissimulai mes hommes le mieux que je pus et leur ordonnais de tirer sur quiconque se présenterait et ne serait pas de notre administration. Quatre heures après le coucher du soleil le Qalenter me demanda si toutes mes mesures étaient prises et, sur les assurances que je lui donnais, il me conduisit dans sa maison. Il entra seul dans l'endéroun et en revint bientôt après, accompagné de Qourrèt-oul-Aïne. Il me remit un pli cacheté en me disant: «Tu conduiras cette femme au jardin d'Ilkhani et tu la remettras contre reçu à Aziz Khan Serdar.»
«On amena un cheval et je fis monter Qourrèt oul-Aïne. Mais, craignant que les babis fussent avisés de ce qui se passait, je jetai mon manteau sur elle de façon à ce qu'on la prit pour un homme. Avec une escorte bien armée nous nous mîmes en route à travers les rues. Malgré les précautions prises et les forces imposantes qui nous entouraient, je suis convaincu qu'en cas d'attaque tout mon monde aurait lâché pied, tant les babis inspiraient de terreur».
«Je poussai un soupir de soulagement en entrant dans le jardin. Je fis mettre ma prisonnière dans une chambre qui se trouvait sous le corridor de l'entrée, j'ordonnais à mes soldats de garder soigneusement la porte et je me rendis au premier étage pour y trouver le serdar.»
«Il était seul et m'attendait. Après avoir a lettre que je lui remis: «Personne n'a compris qui tu amenais? me demanda-t-il.» - «Personne, dis-je, et maintenant que j'ai rempli ma mission, délivrez-moi un reçu de ma prisonnière.»-»Non pas, dit-il, tu dois assister à l'exécution, je te donnerai ensuite» ton reçu.»
«Il appela un valet de chambre turc qu'il avait : c'était un homme tout jeune et de fort belle figure. Le serdar lui fit maintes flatteries et lui dit; «Il y a longtemps que tu es à mon service et j'ai eu tort de ne pas m'occuper de toi : je t'aime cependant bien et Je veux te récompenser. Prends ces vingt pièces d'or, dépense-les comme tu le voudras ; pendant ce temps je vais te chercher un bel emploi. Mais en attendant, prends ce mouchoir de soie et descends avec cet officier. Il te conduira dans une chambre où tu trouveras une jeune femme infidèle et qui détourne les croyants de la voie de Mohammed. Etrangle-la avec ce mouchoir : tu rendras ainsi un immense service à Dieu et je t'en récompenserai largement.»
«Le valet s'inclina et sortit avec moi. Je le conduisis dans la chambre où j'avais laissé ma prisonnière. Je la trouvai prosternée et priant. Le jeune homme s'approcha d'elle pour exécuter l'ordre qu'il avait reçu. Alors elle releva la tête, le regarda fixement et lui dit : «O jeune homme! il serait indigne que ta main se souille de ce meurtre.»
«Je ne sais ce qui se passa dans l'âme de ce domestique mais il s'enfuit comme un fou. Je courus après lui et nous arrivâmes ensemble chez le serdar à qui il déclara qu'il lui était impossible d'accomplir l'acte qui lui avait été ordonné. «Je perds votre protection, lui dit-il, je me perds moi-même; faites de moi ce que vous voudrez, mais je ne toucherai pas à cette femme.»
«Aziz Khan le chassa et réfléchit quelques minutes. Il fit alors mander un de ses cavaliers que, pour punir de sa mauvaise conduite, il avait envoyé servir aux cuisines. Quand cet homme entra, il le gronda amicalement : «Allons, fils de chien, bandit, coureur, j'espère que ton châtiment t'aura fait réfléchir et que tu seras plus sage à l'avenir : tu dois être dégoûté, maintenant, de faire des folies et je pense que tu es digne de reconquérir mon affection. Ça a vraiment dû te gêner de rester si longtemps sans boire de l'eau-de-vie, tiens, prends ce grand verre et avale, je te le permets. Il lui remit alors un nouveau mouchoir et lui renouvela l'ordre qu'il avait déjà donné au jeune Turc.»
«Nous arrivâmes ensemble dans la chambre, et dès qu'il fut entré, il se précipita sur Quourrèt oul Aïne : il lui mit le mouchoir autour du cou et le serra à plusieurs tours. La respiration lui manquant, la femme tomba à terre : alors il lui mit un genou sur le dos et tira de toutes ses forces sur le mouchoir.» Comme il était ému et qu'il avait peur, il ne lui laissa pas le temps d'expirer. Il l'enleva dans ses bras ainsi évanouie et la porta jusque derrière le mur de la glacière où il y avait un puits dans lequel il la précipita vivante. Nous appelâmes quelques hommes et nous comblâmes hâtivement le puits, car l'aube approchait.»
En face de la Légation d'Angleterre et de l'Ambassade de Turquie s'étendait une place assez vaste qui a disparu depuis 1893. Vers le milieu de cette place, mais rentrant dans l'alignement de la rue, s'élevaient cinq ou six arbres solitaires marquant l'endroit où mourut l'héroïne babie, car à cette époque le jardin d'Ilkhani s'étendait jusque-là.
A mon retour, en 1898, la place avait disparu, envahie par les constructions modernes, et je ne sais si l'acquéreur actuel a respecté ces arbres qu'une main pieuse avait plantés (246).
NOTES